
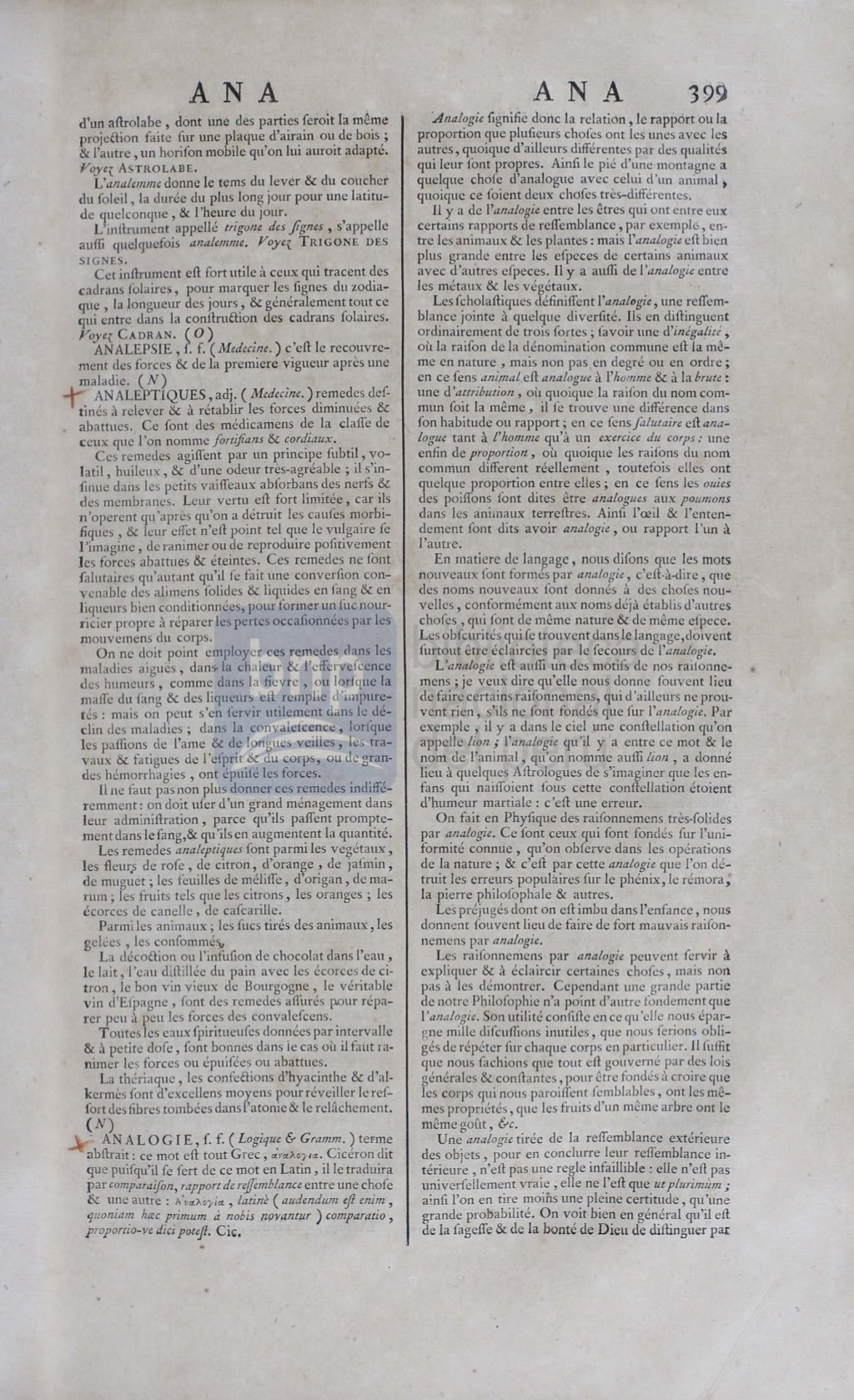
ANA
d'un all:rolabe, dont \.me des parties feroit la
m~me
projeilion faite fUT une plaque d'airain ou de bois ;
&
l'autre, un horifon mobile qu'on lui auroit adapté.
Voye{
ASTROLABE.
L'
anaLemme
donne le tems du lever
&
du coucher
du foleil, la durée du plus
lon~
jour pour une latitu–
de quelconque,
&
1'heme du JOur.
L'inItmment appellé
trigone des jignes
,
s'appell!!
auffi qllelquefois
analemme. roye{
TRIGONE DES
SIGNES.
Cet inltrument
ea
fort utile
a
ceux qui tracent des
cadrans (olaires, pour marquer les fignes du zodia–
que , la longuem des jours,
&
généralement
tOt.ltce
qui entre dans la conll:ruilion des cadrans folau·es.
Voye{
CADRAN.
(O)
ANALEPSIE ,
1.
f.
(Medecine.
)
c'ea
le recouvre–
ment des forces
&
de la premiere vigueur apres une
maladie.
(N)
ANALEPTIQUES, adj.
(Medecine.)
remedes def–
tinés a relever
&
a rétablir les forces diminuées
&
abattues. Ce font des médicamens de la claífe de
ceux (fue l'on nomme
fortijians
&
cordiaux.
Ces remedes agilrent par un principe fubtil, vo–
latil, huileux,
&
d'une odeur tres-agréable ; il s'in–
:finue dans les petits vaiífeaux abforbans des nerfs
&
des membranes. Leu!" vertu eít fort limitée, car ils
n'operent qu'apres qu'on a détn.lit les cauCes morbi–
hques ,
&
leur
e~et
n'eít point tel ql!e le
vu~gaire
(e
l 'imagine, de rammer ou de reprodwre pofiuvement
les forces abartues
&
éteintes. Ces remedes ne (ont
fall!taires qu'autant qu'il fe fait une converfion con–
venable des alimens folides
&
liquides en fang
&
en
liqueurs bien conditionnées, pom former un fue nour–
ricier propre a réparer les pertes occafionnées par les
mouvemens du corps.
On ne doit point employer ces remedes dans les
maladies aigues, dans-la chaleur
&
l'e/fervefcence
des humeurs, comme dans la fievre , ou lorfque la
maífe du ülng
&
des liqueurs eft remplie d'impme–
t~s
: mais on peut s'en fervir utilement dans le dé–
c1in des maladies; dans la convalefcence, lorfque
les paffions de l'ame
&
de longues veilles, les tra–
vaux
&
fatigues de l'efprit
&
du corps, Ol! de gran–
des hémorrhagies , ont épui1é les forces.
Il ne faut pasnon plus donner ces remedes indi/fé–
remment: on doit uCer d'un grand ménagement dans
leur adm!niítration, paree qu'ils paífent prompte–
ment dans lefang,& qu 'ilsen augmentent la quantité.
Les remedes
anaLeptiq/l<S
font parmi les vegétaux,
les flem,5 de rofe, de citron, d'orange , de jaíinin,
de muguet ; les feuilles de méliífe, d'origan, de ma–
nun ; les fruits te!s que les citrons, les oranges ; les
écorccs de canelle, de cafcarille.
Parmi les animaux ; les fucs tixés des animaux, les
ge!ées , les
confommé~
La décoélion ou [,infuúon de chocolat dans I'eau,
le lait, 1'eau difrillée du pain avec les écorces de
cí–
tron , le bon vin vieux de Bourgogne , le véritable
vin d·Eípagne, font des remedes aífurés p.our répa–
rer peu a peu les forces des convaleCcens.
Toutesles eaux fpiritueufes données par intervalle
& apetite dofe , font bonnes dans ie cas
011
il faut ra–
nimer les forces ou épllifées ou abattues.
La thériaque, les confeélions d'hyacinthe
&
d'al–
kermes font d'cxcellens moyens pour réveiller le ref–
fort des libres tombées dansl'atonie& le reHlchement.
(N)
. AN AL O G 1E,
f.
f.
(Logique
&
Gramm.
)
tefme
abíl:rait: ce mot eít tout Grec ,
d"
<l.Ao,!,,<1..
Cicéron dit
que puifqu'il fe (ert de ce mot en Latin, ille traduira
par
comparaifon, rapport de rif!embLance
entre une chole
&
u?e auu·e :
A'v
<l.Ao'!';<I.
,
Latine (audendwn ifl enim,
q/lomam I/lIJe primum
a
nobis ¡¡pvantur
)
comparatio,
proportio-ve diej potifl.
Cie.
A N
_~
399
AnaLogie
fignilie donc la relation, le rappórt ou la
proportion que plufieurs chofes ont les unes avec les
alItreS , quoique d'aiUeurs différentes par des qualités
qui leur font propres. Ainfi le pié d'une montagne a
quelque chofe d'analogue avec celui d'un animal.
quoic¡ue ce foient deux chofes tres-di/férentes.
Il
y
a de
l'analogie
entre les etres qui ontentre eux
certains rapports de reífemblance , par exemple, en–
tre les anim3ux
&
les plantes: mais l'
analogie
eít bien
plus grande entre
l~s
efpeces de certains animaux
avec d'autres eCpeces. Il
y
a au1Ii de
l'analogie
entre
les métaux
&
les végétaux.
Les fcholaítiques déliniífent l'
ana/ogie,
lille reífem–
blance jointe
a
quelque diverfité. Ils en diil:inguent
ordinairement de trois fortes ; favoir une
d'inégaLité ,
011
la raifon de la dénomination commune eil: la
m~me en nature , mais non pas en degré ou en ordre;
en ce fens
animal
eít
analogue
a l'
/¡omme
&
a la
brute
:
une d'
aetribmion,
011
quoique la raifon du nom com–
mun Coit la meme, il (e trouve une di/férence
d~ns
fon habitude ou rapport; en ce fens
folutaire
eít
ana–
logue
tant a
l'!zomme
qu'a un
exercice du corps:
une
enfin de
proportion
>
011
quoique les raifons du nonl
commun di/ferent réellement , toutefois elles ont
que!que propohion entre eUes; en ce fens les
ouies
des poiífons font dites etre
analogues
aux
poumons
dans les animaux terreil:res. AinCt l'reil & l'enten–
dement font dits avoir
analogie,
ou rapport ['un
a
l'autre.
En matiere de
lan~age,
nous difons que les mots
nouvcaux font formes par
analogie,
c'eít-a-dire , que
des noms nOllveaux font donnés
a
des chofes nou–
velles, conformément aux noms déja établis d'autres
chofes , qui font de meme natme
&
de meme efpece.
Les óbCcurités qui (e u·ouvent dansle langage,doivent
furtout etre éclaircies par le fecours de l'
analogie.
L'analogie
eíl: auffi un des motifs de nos railonne–
mens ; je veux dire qu'elle nous donne fouvent lieu
de faire certains raifonnemens, qui d 'aillcurs ne prou–
vent rien, s'ils ne font fondés que fur
l'anaLogie.
Par
exemple , il Y a dans le cie! une coníl:ellation '1u'on
appelle
!ion
j
l'analogie
qu'il
y
a entre ce mot & le
nom de l'animal, qu'on nomme auffi
Lion
,
a donné
lieu a quel'1l.Ies Aíl:rologues de s'imaginer que les en–
fans qui naiífoient fous cette conil:ellation étoient
d'humeur martiale : c'eít une eneur.
011
fait en Phyfique des raifonnemens tres-folides
par
anaLogie.
Ce font ceux qui font fondés fur l'uni–
formité connue, '1u'.on obferve dans les opérations
de la naulre ; & c'eít par cette
analogie
que l'on dé–
truit les erreurs populaires fur le phénix, le rémora,
la pierre philofophale & autres.
Les préjugés dont on eít imbu dans l'enfance, nous
donnent fouvent lieu de faire de fort mauvais rai[on–
nemens par
analogie.
Les raifonnemens par
analogie
peuvent fervir
a
expliquer
&
a éclaircir certaines chofes, mais non
pas a les démontrer. Cependant Ime grande parcie
de nou·c Philo(ophie n'a point d'autre fondement que
l'analogie.
Son utilité confiíte en ce qu'elle nous épar–
gne mille diCcuffions inutiles, que nous ferions obli–
gés de répéter fur chaque corps en particulier. Il (uffit
que nous fachions que tout eít gouverné par des lois
générales
&
conítantes, pour etre fondés
a
croire que
les corps qui nous paroiífent femblables , ont les me–
m;s
prop~iétés,
que les fruits d'un meme arbre ont le
meme gout,
&c.
Une
allaLogie
tirée de la reífemblance extérieure
des objets , pour en conclurre leur reífemblance in–
térieure , n'eít pas une regle infaillible : elle n'ea pas
univerCellement vraie , elle ne
l'ea
que
utplttrimúm;
a!nfi l'on en rire moiñs une pleine ceniulde , qu 'une
grande probabiliré. On voit bien en général qu'il eít
de la fageífe
&
de la bonté de Dieu de dillinguer par
















