
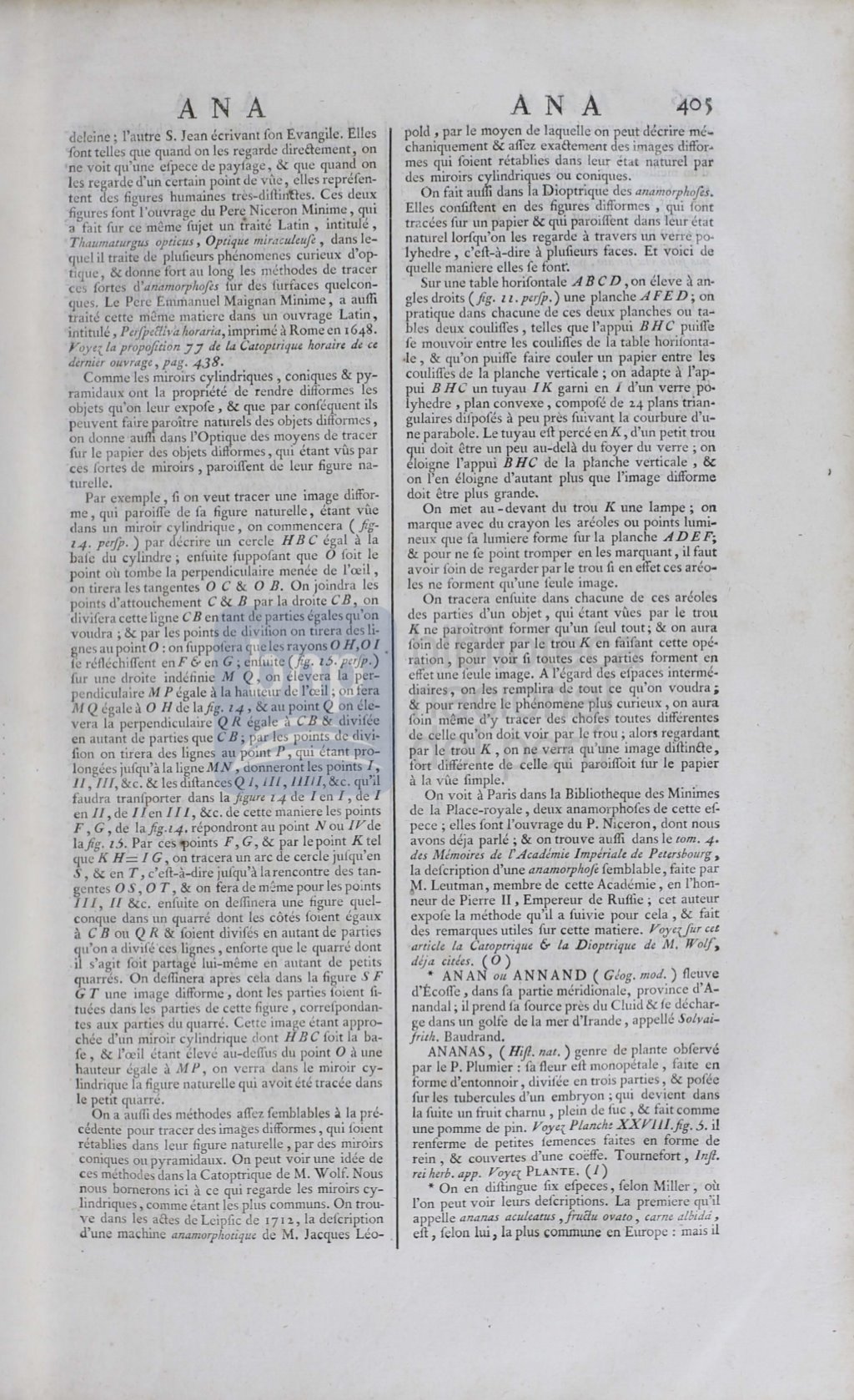
ANA
dcfcine; l'autre S. Jean écrivant ron Evangile. Elles
{ont telles que quand on les rcgardc direétement, on
ne voit qu'une cfpece de payíage, & que quand on
les rcgarde d'un certain point de vlle, elles repréfen–
tent des figures humaines tres-di1tinUes. Ces deux
figures font 1'ouvrage du Pere Niceron Minime, qui
a fait fuI' ce meme [ujet un traité Lacin , intittúé,
ThflumaLUrgus opticus>Optique miraculeuft,
dans Je–
quel il traite de plllfieurs phénomenes curieux d'op–
tique, & donne fort au 10nO' les méthodes de tracer
ces rones
d'aflflmorpluljes
Rlr des íilrfaces quelcon–
<jues. Le Pere Emmanuel Maignan Minime, a auffi
rraité cette meme matierc dans un ollvrage Latin,
incintlé,
PeifPeEllvahoraria,
imprimé
a
Rome en 1648.
raye{ la propcfitiofl
77
de
la
Catoptrique horaire de
ce
demier o/lvrage, pago 438.
Comme les miroirs cy'lindriques , coniques & py–
ramidaux ont la propnété de rendre difformes les
objets qu'on lem expo[e> & que par conféquent iJs
peuvent faire paroitre nattlrels des objets difformes,
on donne auffi d¡¡ns l'Optigue des moyens de tracer
[uc le papier des objets diftormes, qui étant vus par
ces lortes de miroirs, paroill'ent de leur figure na–
turelle.
Par exemple, fi on veut tracer une image di!for–
me, qui paroi{[e de fa figure naturelle, étant vlle
dans un miroir cylindrique, on commencera
( fig-
14. peifP·
)
par décrire un cercle
H B C
égal
a
la
bale du cylindre ; enfuite (uppofant que
°
foit le
point 011 tombe la perpendiculaire menée de l'reíl ,
on tirera les tangentes
°
C
&
°
B.
On joindra les
pomts d'attouchement
C
&
B
par la droite
CB,
on
divifera cette ligne
CB
en tant de parties égales qu'on
voudra ; & par les points de diviJion on mera des
lí–
gnesaupoint O : on fuppofera crueles rayonsO
H,OI •
fe
réfléchilfent en
F
&
en
G;
enfitite
(fig.
d.
perJP·)
[ur une droite indéfinie
M
Q,
on élevera la per–
pendiculaire
M P
égale
a
la hautenr de l'reil ; on fera
lI!
Q
égale
a
°
H
de
lafig.
Z4, & au point
Q
00 éle–
vera la perpendiculaire
Q
R
égale a
CB
& divifée
en autant de parties que
C B
;
par les points de divi–
[LOn on cirera des lignes au point
P,
qui étant pro–
longées jufqu'ida ligneMN, donneront les points 1,
11, lIJ,
&c. & les difrancesQ 1,
JI/,
11111,&c. qu'il
faudra tranfporter dans la
figure l4
de
1
en 1, de
1
en
I1
,
de
11
en
111,
&c. de cette maniere les points
F, G,
de
lafig.l4.
répondront au point
N
ou
IV
de
lafig.
zj.
Par ces 'floints
F, G,
& par le point
K
tel
que
K H= I G,
on tracera un arc de cercle jufqu'en
, & en
T,
c'efl:-a-dire jufqu'a larencontre des tan–
gentes
°
S,
°
T,
& on fera de méme pour les points
11I,
JI
&c. enCuite on deffinera une figure quel–
conque dans un quarré dont les cotés foient égaux
a
C B
ou
Q
R
& [oient divifés en autant de parties
qu'on a divifé ces lignes, enforte que le quarré dont
il s'agit foit partagé lui-meme en autant de petits
quarrés. On defI'mera apres cela dans la figure
S F
G Tune
image di!forme , dont les parries foient Ji–
tuées dans les parcies de c tte figure, correfpondan–
tes aux parcies du quarré. Cette image étant appro–
chée d'un miroir cylindrique dont
H B C
foit la ba–
[e,
&
l'reil étant élevé au-de{[us du point
°
a
lme
hautem ég¡¡le
a
M P,
on yerra dans le miroir cy–
lindrique la figure natur
lle
qui avoit 'té tracée dans
le petit quarré.
On a auffi de méthodes a{[ez femblables
a
la pré–
cédente pour tracer des irnages di!formes, qui loient
réta.blies dans leur figure nattlrelle , par des miroirs
cOl1lques ou pyramidaux. On peut voir une idée de
ces methode. dans la Catoptrique de M. Wolf. Nous
~ous
bomerons ici
a
ce qui regarde les miroirs cy–
lmdnques, comme étant les plus commul1S. On trou–
Y;
dans les.aétes de Leipfic de
J
712,
la defcriprion
d une ma hine
anamorphouque
de M. Jacques Léo-
ANA
pold , par le moyen de Iaquelle on peut décrire mé..
chaniquement & aíT'ez exaétement des irnages diffOl·.
mes qui foient rétablies dans leur état naturel par
des miroirs cylindriques ou coniques.
On fait auffi dans la L>ioptrique des
aflflmorplzojes.
Elles conflÍtent en des figures di!formes • quí iont
tracées fur un papier & qui paroiífent dans leur état
naturellorfqu'on les regarde a travers tm verre po–
lyhedre, c'efr-a-dire a plufieurs faces. Et voici de
qllelle maniere elles fe fonr.
Sur une table horifontale
A BCD,
on éleve
a
an–
gles droits
(fig.
z
l.
perJP.)
une planche
A FE D;
on
pratiqlle dans chacune de ces deux planches ou ta–
bIes dellx coulilfes , telles que I'appui
B H C
pllilfe
(e mouvoil' entre les coulilfes de la table horilonta–
.le, & qll'on puiíT'e faire couler un papier entre les
couli{[es de la planche verticale ; on adapte
a
I'ap~
pui
B H C
un tuyau 1
K
garni en 1 d'un verre po–
lyhedre , plan convexe , compofé de 24 plans trian–
gulaires difpofés
a
peu pn:s flúvant la courbure d'u–
ne parabole. Le tuyau eíl percé en
K,
d'un petit trou
'f!-tÍ
doit etre un peu au-dela du foyer du verre ; on
eloigne l'appui
B
HC
de la planche verticale ,
&
on l'en éloigne d'autant plus que l'image difforme
doit etre plus grande.
On met au-devant du trou
K
une lampe; on
marque avec du crayon les aréoles ou points lumi–
nellx que fa lumiere forme fm la planche
A D E F;
& pour ne fe point tromper en les marquant, il faut
avoir foin de regarder par le trou fi en effet ces aréo–
les ne fonnent qu'une feule image.
On tracera enfuite dans chacune de ces aréoles
des parties d'un objet, qui étant vúes par le U'Olt
K
ne paroitront former qu'un felú tout; & on aura
foin de regarder par le trou
K
en faifant cette opé–
ration , pour voir
fi
toutes ces parties forment en
e!fetune lelúe irnage. A l'égard des efpaces intermé·
diaires, on les remplira de tout ce qu'on voudra.
& pour rendre le phénomene plus curieux , on aura
[oin meme d'y tracer des chofes toutes différentes
de celle qu'on doit voir par le trOll; alor5 regardant
par le trou
K,
on ne yerra qu'une irnage dillinéte,
fort différente de celle qtú paroiíT'oit fm le papier
a
la TIle ftmple.
On voit
a
París dans la Bibliotheque des Minirnes
de la Place-royale , del1x anamorphofes de cette ef–
pece; elles font l'ouvrage du P. Niceron, dont nous
avons déja parlé; & on trouve auffi dans le
tomo
4-
des Mimoires de t'Acadimie Impiriale de Petersbourg ,
la defcription d'une
aflamorphoft
femblable, faite par
~.
Leutman, membre de cette Académie, en I'hon–
nem de Pierre 1I> Empereur de Ruílie; cet auteur
expofe la méthode qu'il a flú"ie pour cela, & fait
des remarques utiles [ur cette matiere.
Voye¡.Júr cee
anide la Catoptrique
&
la Dioptrique de M. JlTo/f.
déja cides. (O)
*
AN AN
ou
ANN AND (
Géog. mod.)
fleuve
d'Écoífe, dans fa partie méridionale, province d'A–
nandal; il prend fa fource pres du Cluid
&
fe
déchar.
ge dans un golfe de la mer d'Irande, appellé
Solyai–
frith.
Baudrand.
ANANAS,
(Hij!. nat. )
genre de plante obfervé
par le P. Plumier: fa fleur
dI:
monopétale , falte en
forme d'entonnoir, divifée en erois parcies , & pofée
[ur les tubercules d'un embryon; qui dev!ent dans
la fuite 1m fruit charnu , plein de fue, & fait comme
une pomme de pino
Voye{
PLanch~
XXV1Jl.fig.
j.
il
renferme de petites {emences faites en forme de
rein , & couvertes d'une coe!fe. Tournefort,
l flJ!.
rel herb. app. Voye{
PLANTE.
(1)
*
On en dillingue fix efpeces, felon Miller, 01!
l'on peut voir leurs defcriptions. La premiere c¡u'il
appelle
aflaflas aculeants
,jruau
ovalO, carne albidd>
eíl , felon lui, la plus ¡;ornmune en Eluope : mais il
















