
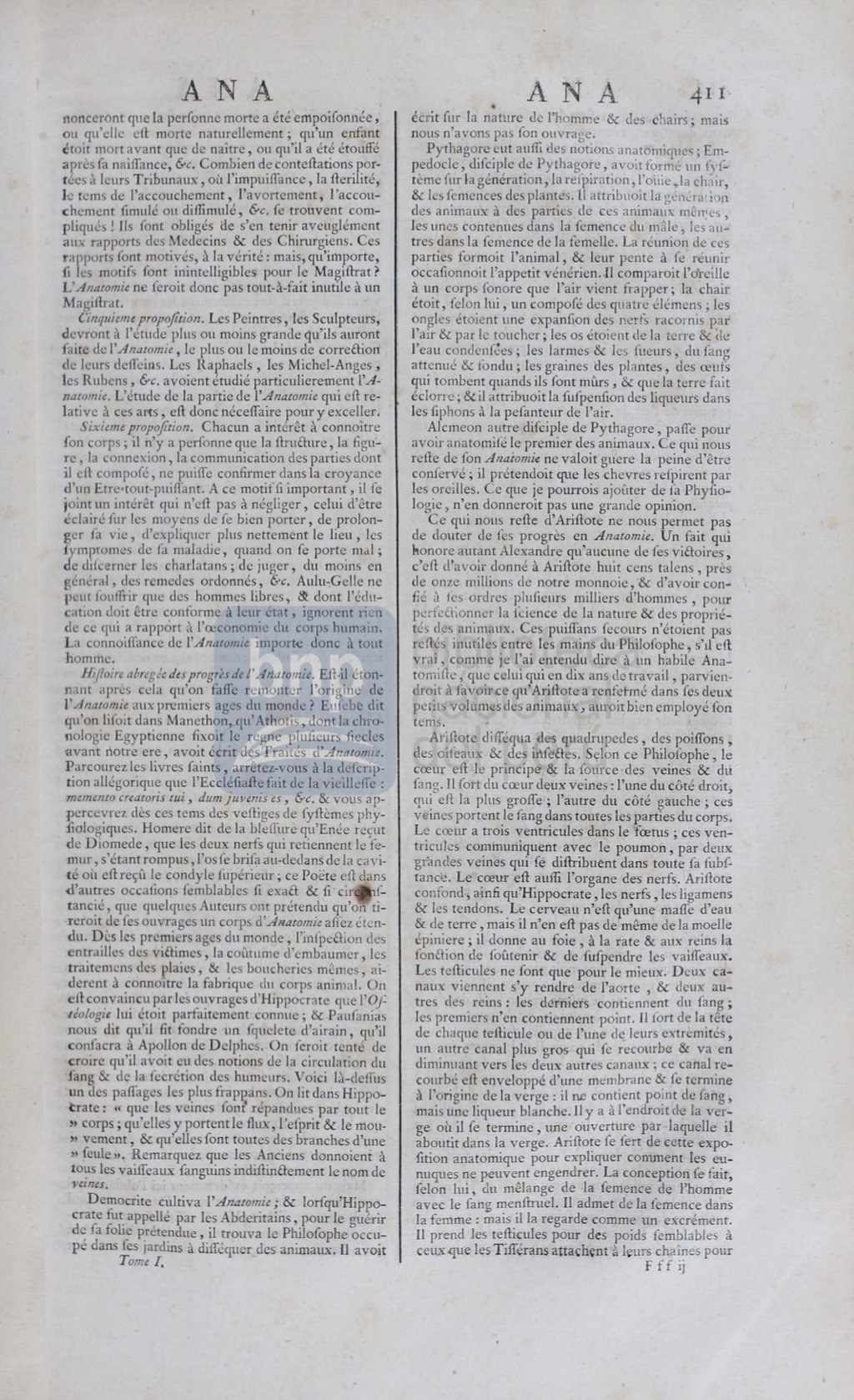
ANA
llonceront qlle la perfonne morte a été empoiConnée,
ou qtl'elle ell morte naturellement; qu'un enfant
étoit mon avant qlle de naitre ,
011
qtl'il a été étouffé
apres fa nRi(fance,
&c.
Combien de contefracions por–
tées
a
leurs Tribunaux, 011 I'impui(fance, la frerilité,
k
tems de l'accouchement, I'avortement ,
1
'accou–
chement fimulé ou diilimuIé,
&c.
fe trOllvent com–
pliqllés! lis font obligés de s'en tenir avellglément
aUA rapports des Medecins & des Chirurgiens. Ces
rapports font motivés,
a
la vérité: mais, qu'importe,
f¡
les motífs font ínintelligibles pour le Magifuat?
L'Allolomie
ne [eroit donc pas tout-a.-fait inutile
a
un
Magifuat.
Cil/lJuicme propt!ftlioll.
Les Peintres, les Sculpteurs,
devront
a
l'étude plus ou moins grande 1u'ils auront
faite de l'
Analomie
,
le plus ou le moins de correilion
de leurs de{lcins. Les Raphaels , les Michel-Anges ,
les Rubens ,
&c.
avoient etudié parciculíerement l'
A–
natomie.
L'énlde de la partie de
l'Allolomie
qui ell re–
lacive
a
ces arts , efr donc nécelfaire pour y exceller.
Sixieme propojilion.
Chacun a interet
a
connoltre
ron corps ; il n'y a perfonne que la fuuaure, la figu–
re, la connexion, la communicacion des parties dont
il ell compoCé, ne puilfe confirmer dans la croyance
d'un Etre·tout-puilrant. A ce motiffi important, il fe
joint un intéret 'luí n'efr pas
a
négliger, celui d'atre
éelairé filr les moyens de [e bien porter, de prolon–
ger [a Vle, d'expliquer plus nettement le lieu , les
iymptomes de fa maladie, quand on fe porte mdl;
de di{cerner les charlatans; de juger, du moins en
général, des remedes ordonnés,
&c.
Anlu-Gelle ne
pent fouffrir qtle des hommes libres)
&:
dont I'édn–
cation doit etre conforme
a
lem état, ignorent rien
de ce qui a rapport
a
I'reconomie du corps humain.
La connoilfance de
l'Analolllie
importe donc
a
tout
homme.
Hi(loire abregée desprogres de !'Anolomie.
Ea·il éton–
nant apres cela qu'on falfe remonte!" l'origine de
l'Analomie
3UX
prcmiers ages dn monde? Eufebe dit
'ju'on lifoit dans Manethon,..qu'Athotis, dontla chre–
nologie Egyptienne fixoit le rcgne plniieurs ficeles
-avant 110tre ere, avoit écrit desTraités
d'Analomie.
Parcourez.les livres faints, arretez.-VOl1S
a
la defcrip.
tion allégonque que l'Eccléfiafre fait de la vieillelfe :
memmw crealorÍJ mi, dum juvenis es, &c.
&
vous ap–
percevrez. di:s ces tems des velliges de fyfremes
phy–
íiolo~i'lues.
Homere dit de la ble(fme qu'Enée rcs;ut
de DlOmede , qtle les deux nerfs c¡ui retiennent le fe–
mur, s'étant rompu ,1'0s fe brifa all-dedans de la cavi–
té oh efr reC;ll le condyle lilpérieur; ce POete efi dans
d'autres occalions femblables fi exaa & fi cir {–
taneié, qtle quelqtles Auteurs ont prétendu qu'on
ti–
reroit de {es ouvrages un corps d'
Allalomie
alrez. éten–
au. D es les premi rs ages du monde, I'infpeaion des
entraille~
des viaimes, la coihllme d'embaumer , les
trajtemcns des plaies,
&
les boucheries m"mes, ai–
derent
a
connOltre la fabrique du corps animal. On
eHconvaincu par lesouvrages d'Hippocrate que
l'Of
-téologie
lui étoit parfaüement connue;
&
Paufanias
nous dit qtl'il fit fondre un {quelete d'airain, 9u'il
contacra
a
Apollon de Delphes. On {eroit tente de
croire qu il avoit eu des notions de la circularion du
tang
&
de la {ecrétion des humeurs. Voici UI-de(fus
un des palfages les plus
frap~ans.
On lit dans Hippo–
trate:
1<
que les veines (ont répandues par tout le
»
eorps; qu'elles yportenrle flux, I'e{prit & le mou–
" vement, & qu'elles {ont tomes des branches d'une
"(eule". R marquez. que les Anciens donnoienf
a
t0:C>
les vailfeaux fanguins indillinaem nr le nom de
'Hines.
De~ocrire
cultiva
l'
Anatomie;
& 10rfqu'Hippo–
erate fut. appellé par les Abderitains, pour le guérir
el •
fa folí:
p.Tt:tendue , il trouva le Philofophe occu–
pe daos les Jardins
a
dilféqtl r des animalLX.
U
avoit
Tome
l.
ANA
4
11
~~::~ ~!~~~n~~~!:~o~eo~I:~g~~
& des ehairs; mais
Pythagore eut auffi des norions anaromiques; Em–
pedocle, difciple de Pythagore, avoit forme un
("1:"
teme fUI" la génération, la refpiratjon, l'oiiie
~Ia ch~ir,
& les {emences des plantes. Il attribuoit la génera· ion
des animaux
a
des parties de ces animaux melT'es ,
les unes contenues dans la femenee du male, les
au~
tres dans la {emence de la femelle. La réunion de ces
parties formoit I'animal, & lem pente
a
{e réunir
occafionnoit l'appetit vénérien.
,Il
comparoit l'óreille
a
un corps (onore que l'air vient frapper; la chair
étoit, felon !tú, un compofé des quatre élémens; les
ongles étoient une expanfion des nerfs racornis par
]'air & par le toucher; les os étoient de la terre
&
<te
l'eau condenfées; les larmes & les (ueurs, du (ang
attenué
&
fo ndu; les graines des plantes, des reufs
qtú
tombent c¡uands ils {ont ITIUrs , & que la terre fait
éclorrc; &il attribuoít la (u[penfion des liqueurs dans
les fiphons
a
la pefantem de I'air.
Alcmeon autre dj[ciple de Pythagore, palfe pour
avoir anatomifé le prenüer des animaux. Ce 'lui nous
refre de [on
Analom¡~
ne valoit guere la peine d'etre
confervé ; iJ prétendoit qt1e les chenes refpirent par
les oreilles. Ce qtle je pourrois ajol!ter de
ÜI
Phyfio–
logie, n'en donneroit pas une grande opinion.
Ce c¡ui nous relle d'Arifrote ne nous permet pas
de douter de {es progres en
A ltalomie.
Un fait qui
Monore autant Alexandre qu'aucune de {es viaoires ,
c'efr d'avoir donné
a
Arifrote huit cens talens , pres
de OI1z.e millions de notre monnoie, & d'avoir con–
fié
a
les ordres plufieurs milliers d'hommes , pour
per[cfrionner la ¡t ience de la nature & des proprié–
tés des animaux. Ces puilfans [ecours n'étoient pas
refiés inutiles entre les mains du Phi]ofophe, s'tl efr
vrai , comme je ]'ai entendu dire
a
un habile Ana–
tomiíl:e, quc celui qui en dix ans de travail, parvien–
droit
a
favoir ce c¡u'Arifrote a renfctmé dans [es deux
petits volumes des animaux, amoit bien employé [on
tems.
Al-ifrote dilféC¡l1a des quadrupedes , des poilfons
>
des oileaux & des iMeaes.
S~lon
ce Philo{ophe, le
creur eíl: le principe
&
la fource des veines & du
f:tng.
11
[ort du creur deux veines :l'une du coté droit,
gui efr la plus grolfe; l'aurre du coté gauche ; ces
vsines portent le {;tng dans toutes les parties du corps.
Le creur a trois ventricules dans le fretus ; ces ven–
trindes communiquent avec le poumon, par deux
grandes veines c¡ui fe diftribuent dans toute [a fubf,.
tance. Le creur ell auili I'organe des nerfs. Arifrote
confond , a1nfi qtl'Hippocrate, les nerfs , les ligamens
&
les tendons. Le cerveau n'efr qu'une malfe d'eau
&
de terre , mais il n'en efr pas de meme de la moelle
épiniere; il donne au foie,
a
la rate
&
aux reins la
fonélion de [oLltenir & de {u[pendre les vailfeaux.
Les refiicules ne font que pour le mieux. Dellx ca–
naux viennent s'y rendre de l'aorte , & deux au–
tres des reins : les dcrniers contiennent du fang;
les premiers n'en contiennent point.
JI
iort
de la rete
de chac¡ue tefiicule on de I'une
d~
leurs extremités ,
un autre canal plus gros qui
fe
recourbe
&
va en
dimjnl1aot vers les deux autres canalLX ; ce canal re–
cOlU·bé eíl: enveloppé d'une membrane
~
fe termine
a
I origine de la verge : il
n.e
contient
po~nt
de fang,
mais une líqueur blanche.
Il
ya
a
l'endrOlt
de
la ver–
ge ou
il
fe termine, une .OUVerlll:e par laquelle il
aboutit dans la verge. Anfrote {e lert de cette expo–
fition anatornique pour expljquer comment les eu–
nuques ne peuvent engendrer. La concepcion fe faít,
felon lui, du melange de la femence de l'homme
avec le fang menfuuel.
II
admet de la femence daos
la femme : mais illa regarde comme un excrément.
II
prend les tefiicules pour des poids femblables
a
cel1X que les T ilférans attachent
~
leurs chaines ponr
F
f f ij
















