
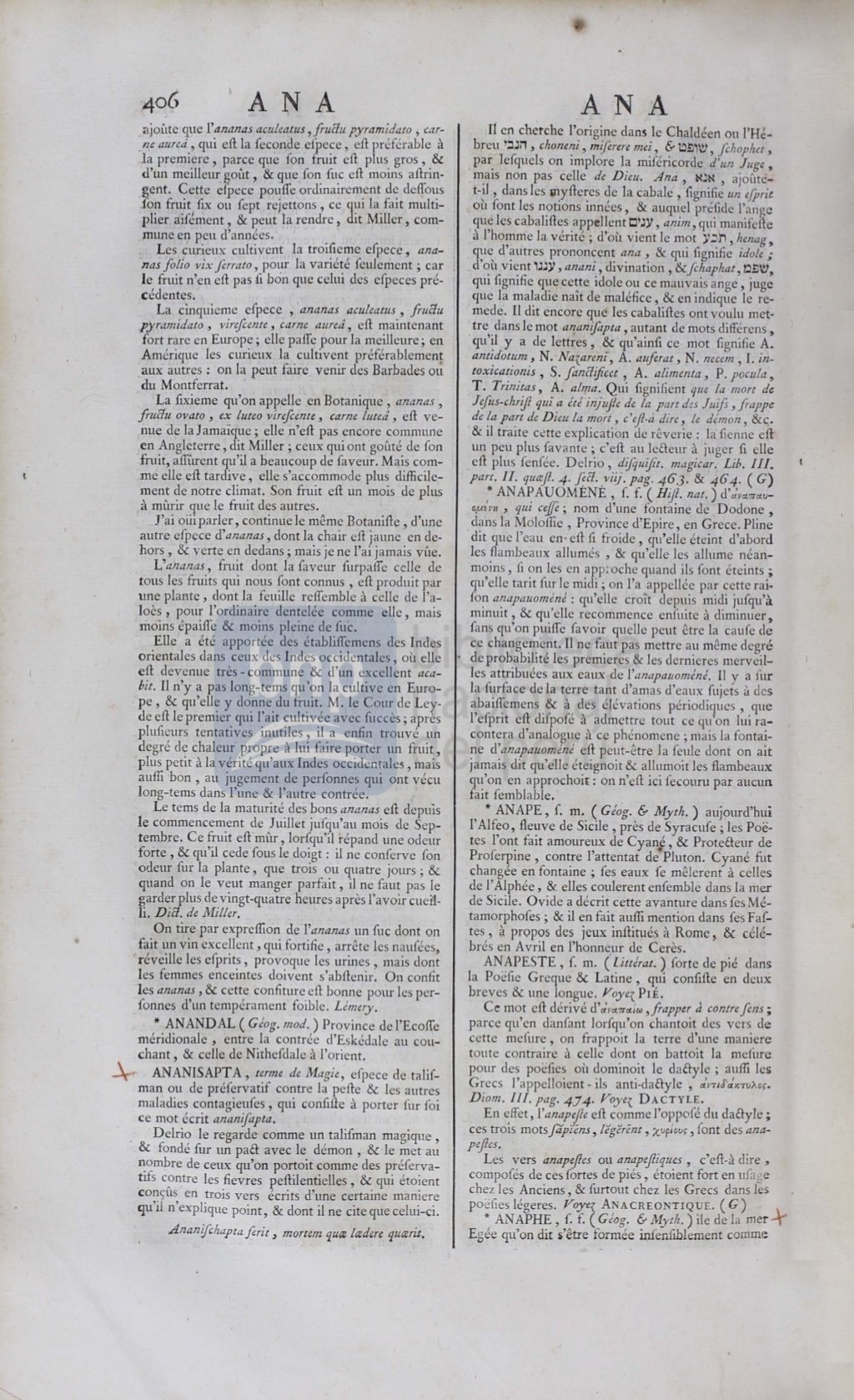
ANA
ajolltC que l'
ananas aculealUS ,fruan pyramidalo
,
car–
ne aureá
,
qui eílla feconde e(pece, eíl préférable a
la premiere, parce que fon fmit eíl plus. gros,
.&
d'un meilleur
~Ollt,
&
que fon fuc eíl moms aílnn–
gent. Cette elpece pouífe ordinairement de defious
fon huit fix ou fept rejettons, ce qui la fait multi–
plier aifement,
&
peut la rendre, dit Miller, com–
mune en peu d'années.
Les curieux cultivent la troilieme efpece,
ana–
nas folio 'Vix j erralo,
ponr la variété (eulement ; car
le huit n'en eíl pas fi bón que celui des efpeces pré–
cédentes.
La cinquieme efpece ,
ananas aculealU.s, fruau
pyramidalo, 'VirifcetUt , carne aureá,
eíl maintenant
fort rare en Enrope; elle paífe pour la meilleure; en
Amérique les cltrÍeux la cultivent préférablement
aux autres: on la peut faire venir des Barbades ou
du Montterrat.
La fixieme qu'on appelle en Botani'lue ,
ananas ,
fruau ovalO, ex luteo virifcentt, carn.e lutea ,
eíl ve–
nue de la Jamai'lue; elle n'eíl pas encore commune
en Angleterre, dit Miller ; ceux qui ont gOllté de (on
fruit, aíflITent 'lu'il a beaucoup de faveur. Mais com–
me elle eíl tardive, elle s'accommode plus difficile–
ment de notre climat. Son fntit eíl un mois de plus
a
mí'trir que le fruit des autres.
J'ai oiii parler, continue le m&me Botaniíle , d'une
autre ef¡)ece
d'ananas,
dont la chair eíl jaune en de–
hors ,
&
verte en dedans ; mais je ne l'ai jamais TIle.
L'ananas,
fntit dont la faveur filrpaífe celle de
tous les fnúts 'lui nous font connus , eíl produit par
une plaflte, dont la feuille reífemble a celle de l'a–
loes
~
pour l'ordinaire dentelée comme elle, mais
moins épaiífe
&
moins pleine de fuc.
Elle a été apportée des établiífemens des Indes
orientales dans ceux des Jndes occidentales, Ol! elle
eíl elevenue tres - commune
&
el'un excellent
aca–
bit.
Il n'y a pas long-tems qu'on la cultive en Euro–
pe,
&
qu'elle y elonne du truit. M. le Cour de Ley–
de eíl le premier qui l'ait cultivée avec fucces; apres
plufieurs tentatives inutiles, il a enfin trouvé un
degré de chaleur propre
a
lui faire porter un fruit,
plus petit
a
la vérité qu'aux Indes occidentales, mais
auili bon , au jugement de per(onnes qui ont vécu
long-tems dans l\ll1e
&
l'autre contrée.
Le tems ele la l1uturité des bons
ananas
eíl depllis
le commencement de Jllillet jll(qll'au mois de Sep–
tembre. Ce fruit eíl mllr , lorfqu'il répand une odeur
forte ,
&
qu'il cede fous le doigt: il ne conferve (on
odeur fur la plante, que trois ou 'luatre jours;
&
quand on le veut manger parfait, il ne faut pas le
garder plus devingt-'luatre heures apres l'avoir cuell–
li.
D ia. de Miller.
On tire par expreffion de
l'ananas
un (ue dont on
fait un vin excellent, 'llli fortifie , arr&te les naufées,
réveille les efprits, provoque les urines , mais dont
les femmes enceintes doivent s'abílenir. On confit
les
ananas
,
&
cette confiture eíl bonne pour les per–
(onnes d'un tempérament foible.
Lémery.
*
ANANDAL
(Géog. mod.)
Province del'Ecoífe
méridionale, entre la contrée d'Eskédale au cou–
chant,
&
celle de Nithefdale a l'orient.
ANANISAPTA,
terme de Magie,
ef¡)ece de talif–
man ou de pré(ervatif contre la peíle
&
les autres
maladies contagieufes , 'luí conúfre a porter (ur foi
ce mot écrit
ananifapta.
. D elrio le regarde comme un tali(man magi'lue ,
&
fondé fur un paél avee le démon,
&
le met au
~ombre
de ceux qu'on portoit eomme des préferva–
tifs contre les fievres peílilentielles,
&
qui étoient
conqlls en trois vers ecrits d'une certaine maniere
qu'il n'explique point,
&
dont il ne cite que cehú-ci.
Ananifc/¡apta firit
,
mortem 'lua l(lidere 'lu(lirit.
ANA
r!
en cherche l'origine dans le Chaldéen ou I'Hé.
breu ':lJil ,
c/¡oneni, miJerere mei,
&
~.~mv
,
fchophet,
par. lefque1s on implore la miféricorde
d'un Juge ,
m.als non pas celle
de D ieu. Ana,
NJN , ajollte–
t-ll , dans les ¡nyíleres de la cabale, fignifie
un efprie
011
font les notions innées,
&
auquel préúde l'ange
que les cabaliíles appellentC'JY, anim,qui manifcíle
a
l'homme la vérité ; d'ol! vient le mot
y;¡n,
henag.
que d'autres prononcent
ana
,
&
'Iui fignifie
idole;
d'oll vient
,;;y,
anani,
divination
,&fc/¡aphat,
Q~\IJ.
'lui fignifie que cerre idole ou ce mauvais ange , juge
que la maladie nait de maléfice ,
&
en indique le re–
mede. Il dit encore que les cabaliíles ont voulu met–
tre dans le mot
ananlfapta,
autant de mots différens.
qu'il y a de lettres,
&
qu'ainfi ce mot figniJie A.
amidotum,
N.
Na{areni,
A.
al/ferat,
N.
necem,
I.
in.–
toxicatiollis,
S.
fanaificel,
A.
alimenta,
P.
pocula,
T.
Trinitas ,
A.
alma.
Qui fignifient
que fa mort de
J
ifus-chrijl qui a été injujle de la pan
d~s
Juifs
,
frappe
de la part deD ieu la mon, c'ejl-a dire, le démon,
&c.
&
il traite c<!tte explication de rherie: la fienne eíl
un pen plus favante ; c'eíl an leéleur
a
juger fl elle
eíl plus fenfée. D elrio ,
diji¡uijit. magicar. Lib.
IJI_
parto
JI.
qurefl.
+
;ea. 'Viij. pago
463.
&
46+
(G)
*
ANAPAUOMÉNÉ,
f.
f.
(Hij!.
nat.)
d'd,a",,,,u–
op.""
,
qui
cef!e;
nom d'une fontaine de Dodone ,
dans la Moloffie , Provinee d'Epire, en Crece. Pline
dit que l'eau en' eíl fi froide, qu'elle éteint d'abord
les f1ambeaux allumés ,
&
qu'elle les allume néan–
moins, fi on les en appl'Oche 'luand ils (ont éteints ;
'lu'elle tarit (m le midi; on l'a appellée par cette rai–
fon
anapauoméné
:
'Iu'elle crolt depuis midi juf'lu'a
minuit,
&
CJLl'elle recommence enfllite 11 diminuer,
fans qn'on puiífe favoir quelle peut &tre la caufe de
ce changement. Il ne faut pas mettre au meme degré
de probabilité les premieres
&
les dernieres merveil–
les attribuées aux eaux de
l'anapauoméné.
Il y a fur
la furface de la terre tant d'amas d'eaux fujets
a
des
abaiífemens
&
a
des élévations périodiques , que
l'efprit eíl difpofé
a
admettre tout ce qll'on lui ra–
contera d'analopue
a
ce phénomene ; mais la (ontai–
ne
d'anapauomené
efr pellt-etre la feule dont on ait
jamais dit c¡u'eLle éteignoit
&
allumoit les flambeallx
qu'on en approchoi¡: on n'eíl ici (ecomu par aucun
fait femblable.
• ANAPE, (. m. (
Géog.
&
Myth.)
aujomd'hui
¡'Alfeo, fleuve de Sicile, pres de Syracufe; les Poe–
tes l'ont fait amoureux de Cyané,
&
Proteélellr de
Pro(erpine, contre l'attentat de"Pluton. Cyané nlt
changee en fontaine ; fes eaux fe melerent a celles
de l'Alphée,
&
elles coulerent en(emble daos la mer
de Sicile. Ovide a décrit cerre avanture dans fes Mé–
tamorphofes;
&
il en fait auffi mention dans fesFa(–
tes ,
a
propos des jeux inilirués aRome,
&
célé–
brés en Avril en l'honneur de Ceres.
ANAPESTE,
f.
m.
(Liuiral.)
forte de pié dans
la Poefle Creque
&
Latine, qui conúíle en delLX
breves
&
une longue.
r oyez.
PIÉ.
Ce mot eíl dérivé
d'd,a",,,,;,,,
,frapper
a
conlre fens;
paree qu'cn danfant lorfqu'on chantoit des vers de
cette mefure , on frappoit la terre d'une maniere
toute contraire
a
celle dont on battoit la mellITe
pom des poefies ou dominoit le daélyle; allffi les
Crees l'appelloient - ils anti-daélyle ,
dl"TuJ'dwruAof.
D iom.
llI.
pago
4.74.
royez.
DACTYLE.
En effet, l'
anap1!¿
eíl comme l'oppo(é du daélyle;
ces trois
motsfapLéns,
Legor.nt,
:x,UP"Uf,
font des
ana–
pejles.
Les vers
anapejles
on
anapejli'lues,
c'eíl-a dire ,
compofés de
ces
fortes de piés, étoient fort en llfage
chez les Anciens,
&
fllrtout chez les
Crecs
dans les
poefies légeres.
Voye{
ANACREONTIQUE.
(G)
L
*
ANAPHE , f. f.
(Géog.
&
Myth.
)
¡le de la roer .,..
Egée qu'on dit s'etre formée infenúblement comme
















