
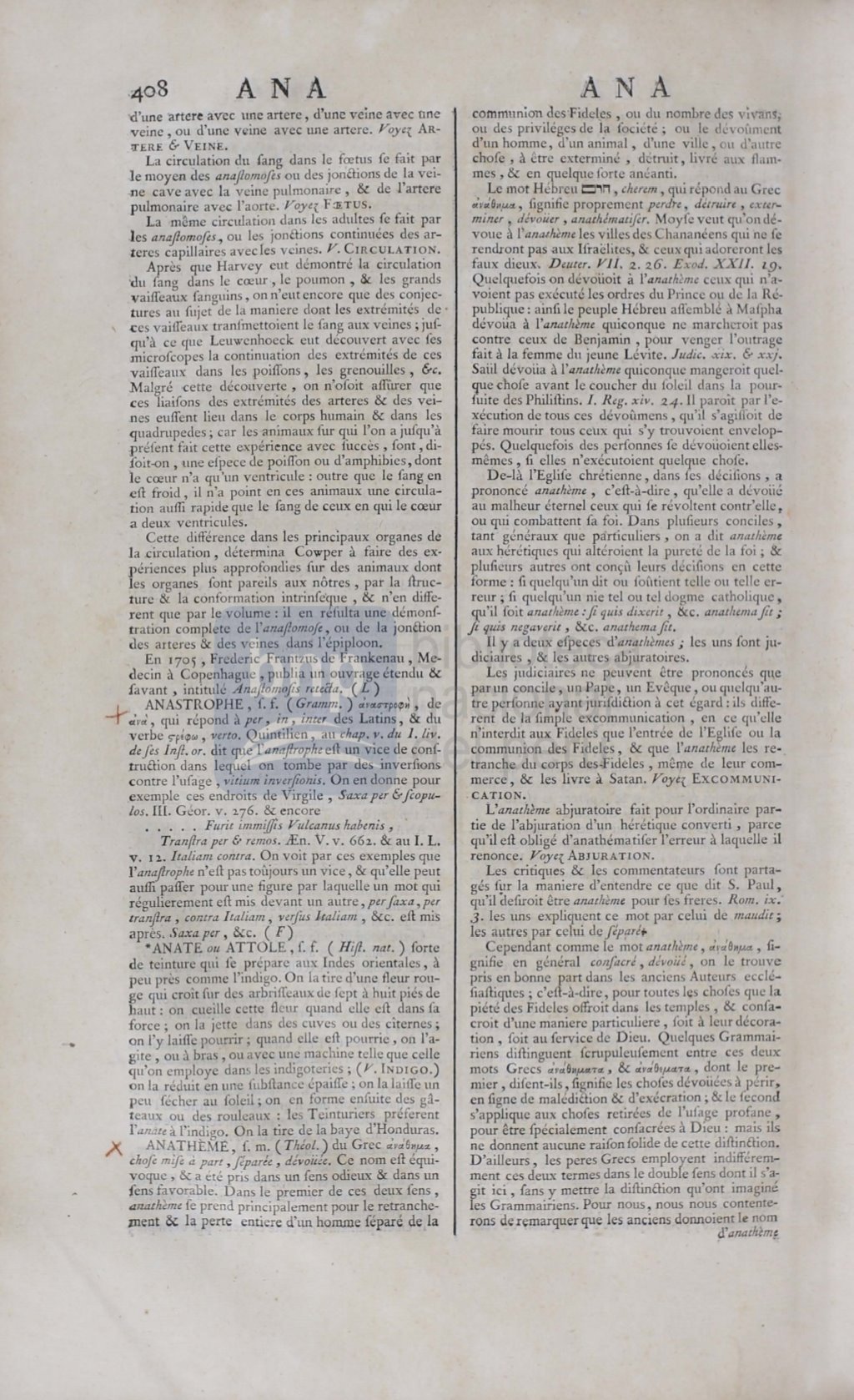
ANA
d'uneartcre aV'cc une artere, d'une veine avec one
veine, ou d'unc
v~ine
avec une artere.
Yoye{
AR–
'TERE &VEI E.
La circulation du fang dans le fretus fe fa}t par
le moyen des
anajlomofls
ou des jonfrions de la vei–
ne cave avec la veine pulmonaire, & de l'artere
Plllmonaire avec I'aone.
Yoye{
F:J!:TUS.
.
La mcme circtúation dans les adultes fe falt par
les
anajlomofls,
ou les jonE?ons contínuées des ar–
teres capillaires avedes vemes.
Y.
CIRCULATIO .
Apres que Harvey eut démontré la circulation
'du r,,1I1g dans le creur, le poumon ,
&
les grands
vailfeaux fanguins, on n'em encore que des conjec–
tures au fujet de la
man~ere
dont les
extré~irés.
de
ces vailfeaux tranfmettolent le fan
p
aux vemes ; ¡uf–
qu'a ce Cjue Leuwe?hoe<;k eut decouyen ,avec fes
microfcopes la cont1l1uatlon des extremltes de ces
vailfeaux dans les poilfons, les grenouilles,
&e.
Malaré cette découverte, on n'ofoit a{fflIer que
ces liaifol1s des extrémités des arteres & des vei–
nes eulfent lieu dans le corps humain & dans les
quadmpedes; car les animaux fur qui l'on a jlúqu'a
préfent fait cette expéríence avec fi.lcces, font, di–
[oit-on , une efpece de poilfon ou d'amphibies, dont
le creur n'a qu'un ventricule : Otltre que le fang en
eíl: froid, il n'a point en ces animaux une circula–
non auffi rapide que le fang de ceux en qui le crellI
a deux ventricules.
Cette différence dans les principaux organes de
la
circulation ,détermina Cowper a faire des ex·
jJériences plus approfondies fuI' des animaux dont
les organes font pareils aux notres , par la ftmc–
ture
&
la conformation intrinfe'cJ;le , & n'en diffe–
rent que par le volume : il en reflúta une démonf–
tration complete de
I'anajlomofi,
ou de la jonUion
des arteres
&
des veines dans l'épiploon.
En
'705,
Frederic Frantzus de Frankenau, Me–
decin a Copenhague, publia un ouvrage étendu &
[avant , intitulé
AnaJlomofis rmEla.
( L )
L.
ANASTROPHE, f. f.
( Gramm. )
avrJ.l1'Tpo~'; ,
de
'/
d"tI.' ,
qui répond a
per, in, intu
des Latins,
&
du
verbe
,p;~¡,¡,
verlO.
Quintilien , au
chapo
V .
du l. liv.
de fes lnjl. or.
dit que
l'
anajlrophe
eíl: un vice de conf–
truUion dans lequel on tombe par des inveríions
contre l'ufage ,
vitium invujionis.
On en donne pour
exemple ces endroits ele Virgile ,
S'axa per
&
¡COpll–
los.
[[L.
Géor.
V.
276.
&
encore
. . . . .
Furit imflliJIis Yulcanus habenis ,
Tranflra per
&
r?fIlos.
.;En.
V.
V.
662.
&
au
1.
L.
V. 12.
lltlliam contra.
On voit par ces exemples que
l'
anajlroplte
n'eíl: pas toújours lm vice,
&
qu'elle peut
auíli paffer pOtlI une figure par laquelle un mot 'lui
régulierement dI: mis elevant un autre,
perfaxa,
pu
tranjlra , contra llalitlm, vufus ltaliam
,
&c.
eíl: mis
apres.
SaXtl per,
&c.
(F)
*
ANATE
oa
ATTOLE,
f.
f.
(Hij!.
nat.)
forte
de teinture qui fe prépare aux Indes orientales,
a
peu pres comme I'índigo. On la tire d'une fleur rou–
ge qui croit fur des arbrilfeaux de fept a huit piés de
haut: on cueille cette fleur quanel elle eíl: dans fa
force; on la jette dans des cuves ou des citernes;
on I'y Iaiile pounir; quand elle eft pourrie,
011
I'a–
gite, ou abras, ou avec une machine telle que celle
qu'on employe dam les indigoteries;
(Y.
[
DIGO.)
on la réduit en une fi.lbfl:ance épailfe ; on la lailfe un
peu fécher au foleil; on en forme ecúuite des ga–
teaux ou des rouleaux : les Teinturiers préferent
1"",
llt
a
l'índigo. On la tire de la baye d'HondtlIas.
ANATHEME.,
f.
m. (
TMol.
)
du Grec
avdS.p." ,
chofo mifi a part ,¡¡parle, d.voiite.
Ce nom eíl: équi–
voqu~
,
&
a eré pns dans un fens odieux
&
dans un
fen tavorahle. Dans le premier de ces deux fens,
a1Ultlz~mt
fe prend principalement pour le retranche–
ment
&
la pecte enti ·re
d'un
homroe féparé de la
ANA
communion (les'Fidel-es , Ol! du nombre des
":\';lns,
ou des priviléges de la fo iété; ou le d..:, oümcnt
d'un homme, d'un animal, d'une villc,
(U
d'autrc
chofe,
a
etre exterminé, d ·tmit, li"r': au.
flilm–
me , & en quelque forte ancanti.
Le mot Hébreu
o ,n
,
chtrem
,
qui répol\d au Grec
a,'a6nf"1,
íignifie proprement
pudre, dúrui"
,
<xur–
miner
,
d¿voüer, anatMmatifir.
Moyle veut qu 'on dé–
voue
a
l'
analft¿mt
les villes des Chananéens qui nc fe
rendront pas alLX Ifraelite
,&
cellx qui aeloreront les
faux dieux,
D.uter. YJI.
2.26.
Exod.
XXll. 19'
Quelquefois on dévoüoit
a
I'anath~me
ceux 'lui n'a–
vojent pas exécuté les ordrcs elu Prince ou de la Ré·
publique: ainíi le peuple Hébreu alremble
a
Mafpha
dévoi¡a
a
I'anatlume
quiconque nc marchcroit pas
contre ceux de Benjamín, pour venger l'outrage
fait
a
la femme
du
jeune Lévite.
ludie. ,xlX.
&
xxj,
Saiil dévoiia
a
I'anal!teme
c¡uicon'lue mangeroit qucI–
~e
chofe avant le coucher du foleil dans la pOllr–
luite des Philiíl:ins.
l . Reg. xiv.
v¡..
11
paroit par l'e–
xécutlon de tous ces dévolllnens, qu'il s'agiíloit de
faire mourir tous cetlx qui s'y trouvoient envelop–
pés. Quelquefois des penonnes fe dévoiiojent
elles·
m&mes,
Ii
elles
n'exécutoient quelque chofe.
D e-la l'Eglife chrétienne, dans {es décitions , a
prononcé
analheme,
c'efl:-a-dire, qu'elle a
el~voii~
au malheur éternel ceux 'lui fe révoltent contr'elle,
ou qui combattent fa foi. Dans pluíieurs conciles,
tant généraux que pa:rticuliers, on a dit
aflatheme
3lLX hérétiqnes c¡ui altéroient la pllrcté de la foi ;
&
plufiellrs autres ont conC;ll leurs decifions en cette
forme: íi queIqu'un dit ou foíhient telle ou telle er–
reur;
Ii
quelqu'un nie tel ou tel dogme catholíque,
<lu'il foir
anatlume:Ji quis dixeri!,
&c.
anadltmaJi!;
fi
quis
negaveri!
,
&c.
anathemaJil,
II
Y
a deux efpeces
d'anat"~lfles
;
les uns [ont ju–
dici31res ,
&
les allttes abjuratoires.
Les judiciaires ne peuvent etre prononcés que
parun concile, un Pape, un
Eveql.le, ou qllelqu'au–
tre perfonne ayam jurifdiétion a cet égard : ils difFe–
rent ele la limpIe excommunicatlon , en ce qu'elle
n'interdit aux FideIes que I'entrée de l'Eglife ou la
communion des Fieleles, & que l'
analneme
les re–
tranche dl1 corps des.Fideles , mCl}1e de leur com–
merce, & les livre
a
Satan.
Yoyt{
EXCOMMU
I–
CATlON.
L'tlnallUme
abjuratoire fait pour l'ordinaire par–
tie de l'abjuration d'un héréti'lue converti, parce
qu'il efl: obligé d'anathématifer I'erreur
a
laquclle iI
renonce.
Yoye{
ABJURATION.
Les critiques & les commentateurs font
parta~
gés
1~r
la maniere d'entendre ce clue dit S. Paul,
qu'i1 deflIoit etre
analheme
pour fes freres.
Rom. ix.
3 .
les nns expliquent ce mot par celui de
maudit;
les autres par celui de
!<Pfl'Ü.
Cependant comme le mot
anat!zlme
,
a,dS.f"1
,
Ii–
gnifie en général
eonjacr¿, d¿vo;i.!,
on le trouve
pris en bonne part dans les anciens Auteurs ecclé–
íiaíl:iques ; c'eíl:-a-dire , pour toures les chofes que la
piété des Fideles oRToit dans les temples, & confa–
croit d'une maniere particuIiere , foit a leur décora–
tion , foit au fervice de Dieu. Quelques Grammai–
riens di1l:inguent fcmpuleu(ement entre ces deux
mot5 Grecs
a,dS.f"1TrJ.,
&
avdO.¡..utTa.,
dont le pre–
mier , difent-ils , úgnifie les chofes dévoiiées
a
pLrir,
en úane de malédillion & d'exécration ;
&
le fecond
s'applique aux chofes retirées de I'ufage profane,
pour
~tre
fpécialement confacrées a Dieu: mais ils
ne donnent aucune raifon folide de cette diíl:inétion.
D'ailleurs, les peres Grecs employenr
indiff~rem
ment ces deux termes dans le double fens dont il ·,'a·
git ici , fans y mettre la diíl:inUion qll'onr imaginl!
les Grammairiens. Pour nous, nous nous contente–
rons de remarquer que les anciens donnoient le nom
d'analh(me
















