
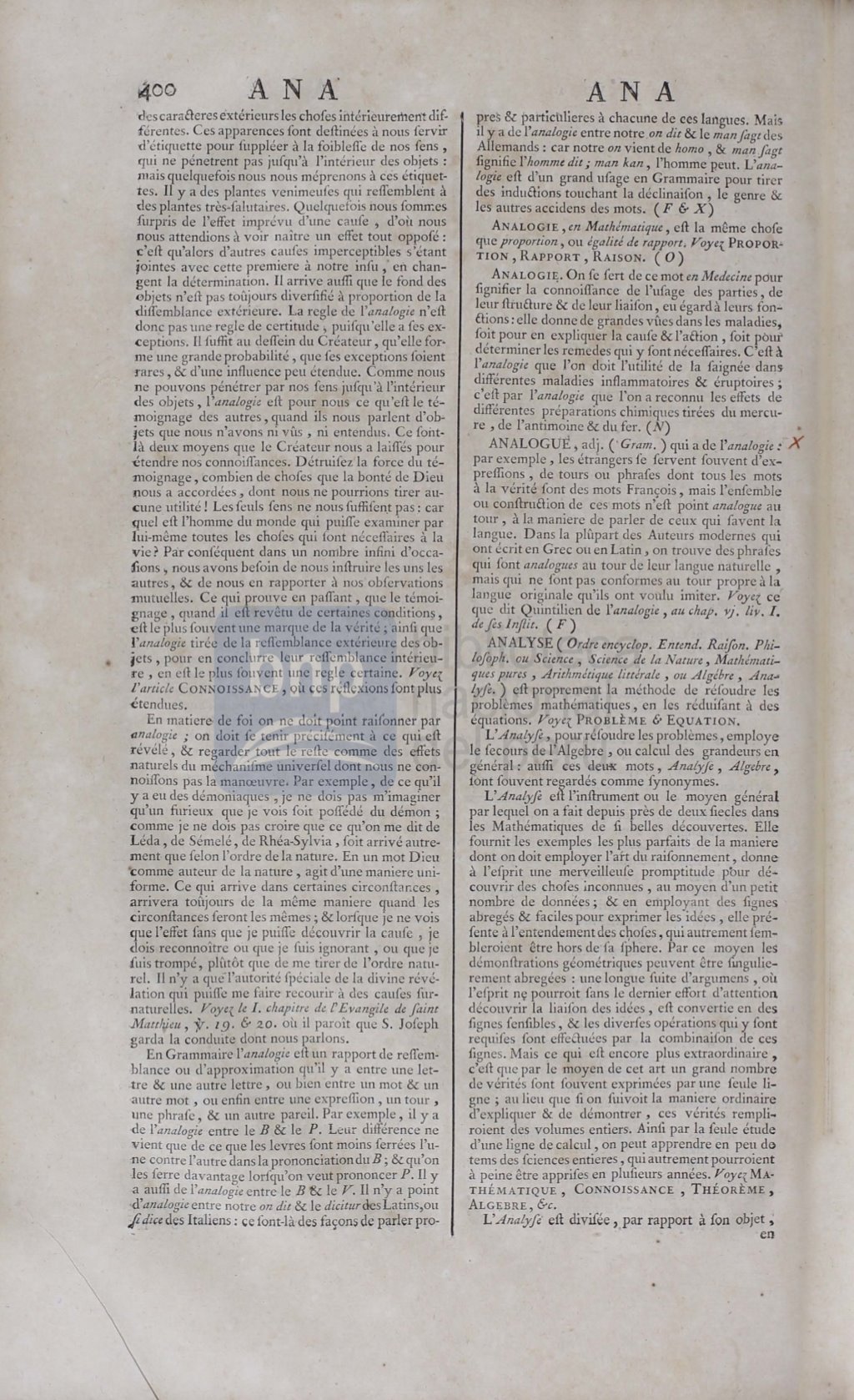
des caraéleres extérieurs les chofes intérieuremen'tdif..
férenres. Ces apparences {ont deftinées
a
nous {ervir
-d'étiquette pour {uppléer a la foibleífe de nos {ens ,
qui ne pénetrent pas ju{qu'a l'inrérieur des objets :
mais quelquefois nous nous méprenons
a
ces étiql1et–
tes. Il y a des plantes venimeu{es qui reífemblent a
des plantes rres·{alutaires. QucIquefois nous {omrr:es
furpris de l'elfet imprévu d'une cauCe , d'oh nous
nous attendions
1t
voir naitre un elfet tout oppo{é:
c'eíl: qu'alors d'autres cau{es imperceptibles s'étant
jointes avec cette premiere
a
notre in{u , en chan–
gent la détermination. 1I arrive auffi que le fond des
0bjets n'eíl: pas totIjours diveríifié
a
proportion de la
¿iífemblance extérieure. La regle de
I'ana/ogie
n'eíl:
donc pas une regle de certitude , puifqu 'elle a {es ex–
ceprions. Il iilffit au deflein du Créateur , qu'elle for–
me une grande probabilité , que {es exceptions {oient
rares,
&
d'une influence peu étendue. Comme nous
ne pouvons pénétrer par nos {ens ju{qu'a I'intérieur
des objets,
l'ana/ogie
eft pour nous ce qu'eft le té–
moignage des autres, quand ils nous parlent d'ob–
jets que nous n'avons ni vús , ni entendus. Ce {ont–
la
deux moyens que le Créateur nous a laiífés pour
-étendre nos connoiífances. Détruifez la force du té–
moignage, combien de chofes que la bonté de Dieu
nous a accordées, dont nous ne pourrions tirer au–
cune 11tiliré! Les {euls {ens ne nous {uffi{en.t pas : car
quel eft l'homme du monde qui puiífe examiner par
lui-meme toures les cho{es qui {ont néce/l.aires
a
la
vie? Par con{équent dans un nombre infini d'occa–
{¡ons
~
nous avons be{oin de nOllS iníl:mire les llns les
autres,
&
de nous en rapporter a nos ob{ervations
1l1utuelles. Ce qui prouve en paífant , que le témoi–
gnage , quand il eíl: reVehl de certaines
condition~,
eft le plus {ouvent une marque de la vérité ; ainíi que
l'ana/ogie
tirée de la rcífemblance cxtérieure des ob–
;ets , pour en concIurre leur reífemblance intérieu–
re, en eft le plus {ouvent une regle certaine.
Yoye{
l'artic!e
CONNOlSSANCE ,
Qlt
~es
réflexions {ont plus
-étendues.
En matiere de foi on ne doit point rai{onner par
ana/ogie
;
on doit {e tenir préci{ément
a
ce qui eft
révélé,
&
regarder tout le reíl:e comme des elfets
nahlrels du méchanifme univerfel dont nous ne con–
noiífons pas la manreuvre. Par exemple, de ce qu'il
y a eu des démoniaques ,je ne dois pas m'imaginer
qu'un filrieux que je vois {oit poífédé du
dén~on
;
comme je ne dois pas croire que ce qu'on me dit de
Léda , de Sémelé, de Rhéa-Sylvia , {oit arrivé autre–
ment que felon I'ordre de la. nahlre. En un mot Dieu
comme auteur de la nahlre , agit d'une maniere uni–
forme. Ce qui arrive dans certaines circonfrar.ces ,
arrivera tOfljOurS de la meme maniere quand les
circonfrances feront les memes ;
&
101{que je ne vois
que l'elfet fans que je puiífe découvrir la caufe , je
dois reconnoltre ou que je fuis ignorant , ou que je
[uis trompé, plútot que de me tirer de l'ordre
na.hl–
re!. Il n'y a qllél'autorité fpéciale de la divine révé–
latíon qui puiífe me faire recourir
a
des caufes {ur–
.nahlrelles.
Voye{
le
l .
chapitre de
f
Evangi/e de faint
Mattlzieu,
y .
z9.
&
20.
Oll il parolt que S. Jofeph
garda la conduite dont nous parlons.
En Grammaire l'
ana/ogie
eíl: un rapport de reífem–
blance ou el'approximation qu'il y a entre une let–
tre
&
une autre lettre, ou bien entre un mot
&
un
autre mot , ou enfin entre une expreffion , un tour,
une phra{e,
&
un autre pareil. Par exemple, il
Y
a
de
l'ana/ogie
entre le
B
&
le
P.
Len!" dilférence ne
vient que de ce que les levres {ont moins {errées l'u–
-ne contre l'autre dansla prononciationdu
B;
&
qu'on
les {erre davantage lorfqu'on veut prononcer
P.
II
Y
a auffi de
l'analogie
entre le
B
&
le
Y.
II n'ya point
·d'
ana/ogie
entre notre
on dit
&
le
diciturdes
Latins,ou
ji.
dice
des Italiens; ce{ont-lit des
fa~ons
de parler pro-
p!"e~
&
l)~rtictlli.eres
a
chacune de ces langues. Mais
II y a de 1
ana/ogle
entre not:e
on die
&
le
manfagtdes
Allemands : car notre
on
Vlent de
!tomo
&
man.fagt
figniñe
1'1IOmme dit; man kan,
l'homme'peut.
L'ana–
logie
eíl: d'un grand ufage en Grammaire pour tirer
des induélions touchant la déclinai{on , le genre
&
les autres accidens des mots.
( F
&
X)
ANALOGIE,
en Mathématique,
eft la meme chofe
que
proponion,
ou
égalité de rapport. Voye{
PROPOR–
TION, RAPPORT, RAISON.
(O )
l'I:NALOGlr,;.
OI!
{e fert de ce mOt
en Medecine
póur
figlllfier la connoIÍrance de l'trfage des parties, de
le~lf
íh-uélure
&
de leu!" liaifon, eu égard
a
Ieurs fon–
él~ons:
elle donne de grandes vúes dans les maladies,
{Olt pour en expliquer la caufe
&
I'aélion , {oit poui'
détenniner les remedes qui y {ont néceífaires. C'eft "–
l'ana/ogie
que l'on doit l'utilité de la (aignée dans
dilférentes maladies inflammatoires
&
énlptoires ;
c'eíl: par
l'ana/ogie
que ron a reconnu les elfets de
dilférentes préparatíons chimiques tirées du mercu–
re , de l'antimoine
&
du feL
(N)
ANALOGUE, adj.
("Gram.)
qui a de
l'ana/ogie:
X
par exemple, les étrimgers fe {ervent fouvent d'ex–
preffions, de tours ou phrafes dont tous les mots
a la. vérité font des mots Fran<;ois, mais l'enfemble
ou confl:ruélion de ces mots n'eíl: point
ana/o(me
an
tour,
a
la. maniere de parler de ceux qui {av"ent la
langue. Dans la plúpart des Auteurs modernes 'lui
ont écrit en Grec OH en Latín, on trollve des phra{es
quío
{on~
ana/ogues
au tour de leur langue naturelle ,
malS
C[111
ne .{ont pas conformes au tour propre
a
la
langue originale qu'ils ont voulu imiter.
Yoye{
ce
que dit Quintílien de
l'ana/ogie , au chapo
Y}.
liv.
l .
de fis lnjlit.
( F )
ANALYSE (
Ordre encyclop. Entend. Raifon. Phi–
lojOp!t.
OIt
Scimce, Science de /aNature, Matltémati.–
'lues pures
,
Aritlllnétique /ittérale
,
ou A/gébre,
Ana~
lyfi.
)
eíl: proprement la méthode de ré{oudre les
problemes mathématiques, en les rédllÍ{ant
a
des
équations.
Yoye{
PROllLtME
6>
EQUATION.
L'
Analyfi,
pour ré[oudre les problemes, employe
le fecours de l'Algebre , ou calcnl des grandeurs en
~énéral:
auffi ces delliC mots,
Analyfe, A/ge6re ,
iont {ouvent regardés comme {ynonyrnes.
L'Analyfi
eft l'infuument ou le moyen général
par lequel on a fait depuis pres de deux íiecIes dans
les Mathémati'lues de íi belles découvertes. Elle
fournit les exemples les plus parfaits de la maniere
dont on doit employer l'ah du raifonnement, donne
a
l'e{prit une merveilleufe promptitude pour dé–
couvrir eles cho{es inconnues , au moyen d'un petit
nombre de données ;
&
en employant eles fignes
abregés
&
facilespour exprimer les idées, elle pré–
{ente
a
I'entendementdes
c~ofes,
qui autrement [em–
bleroient etre hors de
fa
/phere. Par ce moyen leS
démonftrations géométri'lues peuvent etre {mgulie–
rement abregées : une
longl.le{uite d'argumens , Ol!
l'efprit
n~
pourroit fans le derruer elfort d'attention
décollvrir la ¡¡auon des idées , eft convertie en des
fignes feniibles,
&
les diver{es opératíons
c[1lÍ
y font
reqllues {ont elfeéluées par la combinaifon de ces
iignes. Mais ce c¡uí eft encore plus extraordinaire ,
c'eíl: que par le moyen de cet art un grand nombre
de vérités {ont [ouvent exprimées par
un~
{ellle li–
gne ; alllieu que íi
011
{uivoit la maniere ordinaire
d'explic¡uer
&
de démontrer, ces vérités
rempli~
roient des volumes entiers. Ainíi par la {eule étude
d'llne ligne de calcul , on peut apprendre en peu do
tems des {ciences entieres, qui autrement pourroient
a
peine etre apprifes en plufieurs années.
Voye{
MA·
THÉ1I1ATIQUE, CONNOISSANCE , THÉOREME,
ALG~llRE,
&c.
L'Analyje
efr divifée, par rapport
a
fon objet •
en
















