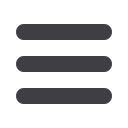
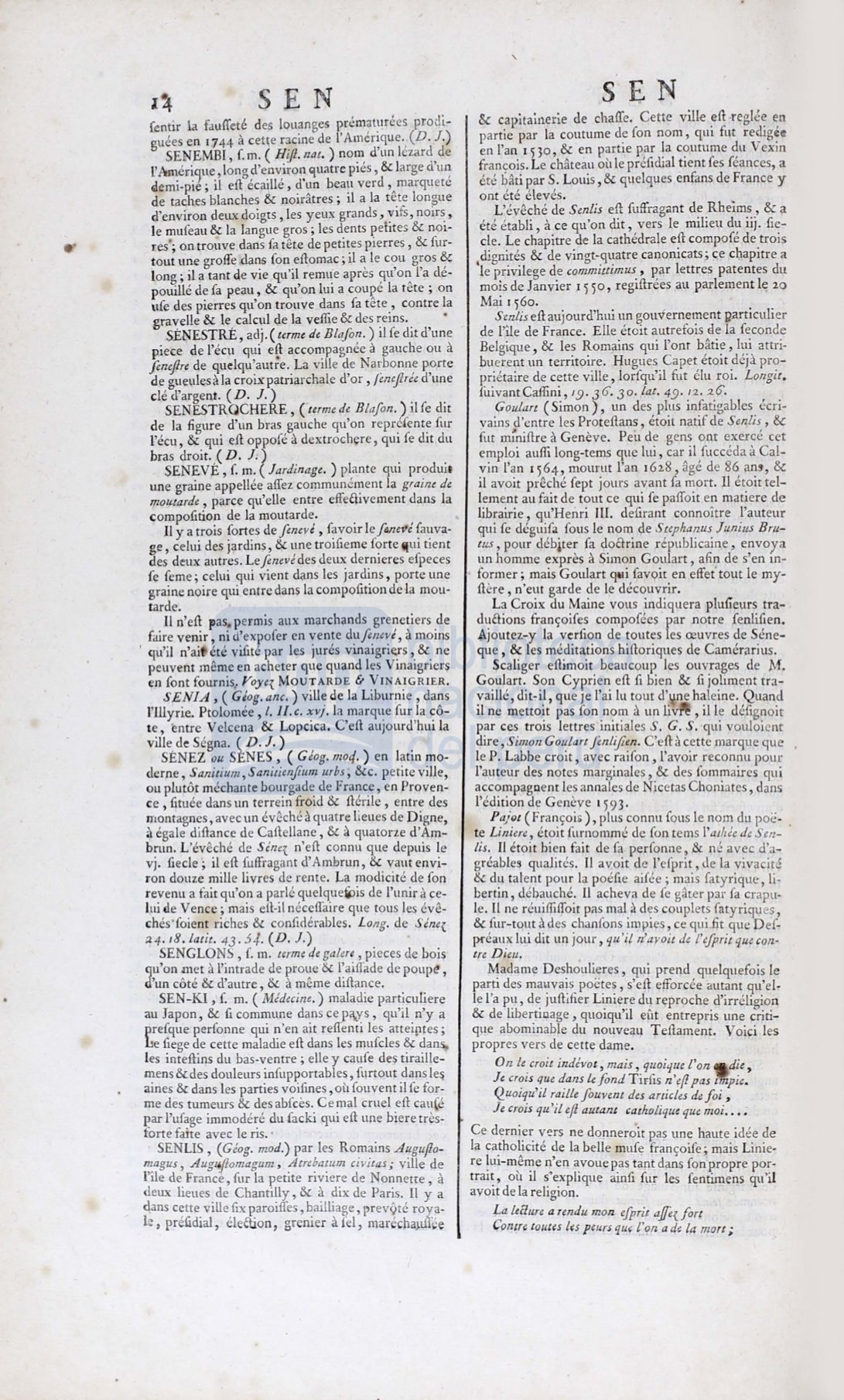
1%
S
E
N
[entir la faufi'eté des louanges prématurées p¡:odi–
guées en 1744
a
cet\e racine de l'Alnérique.
(D. l.)
SENEMBI,
f.
m. (
8,ifl.
/lato
)
no~
d' nn
lézar~,
d,e
l'Amériqt\e, long d'enVl(On 'luatre pies, & large
d
un
demi-pie; il eíl: écaillé , d'un beau verd , marqueté
de taches blanches & noiditres; il a la tete longue
d'envíron deux doigts , les y eux grands ,
~ifs ,
noirs ,
le mu(eau & la langue gros; les dents pentes & nOl–
res';
Qn,~rouve
dans fa tete de
peti~es
pierres , & fur–
tout une grofi'e dans fon eíl:omac;
11
a le cou gros &
long; il a tant de vie qu'il remue apres qu'on I'a
dé–
pouillé de fa peau, & qu'on lui a coupé la tete; on
\lee
des
p~erres
qu'on trouve dans fa tete , contre la
gravelle & le calcul de la veffie & des rei ns.
•
SÉl)IESTRÉ, adj .(
lerme de BlaJan.
)
il fe dit d'une
piece
d~
l'éctl qui eíl: accompagnée agauche ou
a
feneflre
de quelqu'aut;e. La ville de Narbonne po.rte
d.e gue,lles a la croixpatriarchale d'or,
feneflrJe
d'une
d é d'argent.
(D. l . )
SENESTRQCHERE, (
tumede B laJa/l .
)
il fe dit
de la figure d'un bras gauehe qu'on repréCente fur
l'éeu,
&
qui efr oppofé a dextroch¡;re, qui fe dit du
bras droit.
(D. l.)
SENEVÉ,
f.
m.
(lardinage.
)
plante qui prodt¡j$
une graine appellée aífez communément la
graine de
lflout,ar4e,
paree qu'eUe entre effetlivement dans la
coropoútion de la moutarde.
•
Il ya trois fortes de
feneve
,
favoir le
fl!Jlevé
(auva–
ge, celui des jarruns, & une troiíieme forte
~.ui
tient
des deux
autr~s .
Lefeneve des deux dernieres efp eees
fe (eme; celui qui vient d<,lns les jarruns , porte une
graine noire qui entredans la compoútion dela mou–
tarde.
11
n'eíl: pas pefmis aux marchílnds gl'enetiers de
faire venir, ni d'expofer en vente
dufeneve,
a moins
, qu'il n'ai été viúté par les jurés
vinaigri~s,
& ne
peuvent meme en acheter que quand les Vinaigriers
en font fournis,
roye{
MOUTARDE
t/
VINAIGRIER.
SENIA,
(
Glog. ane.
)
viUe de la Liburnie , dans
YIlIyrie. Ptolomée,
l.
11.
C.
xv}.
la marque (Llr la co–
te, entre Velcena
&
Lopcica, C'eíl: aujomd'Q.uila
ville de Ségna.
(D. l.)
SÉNEZ
ou
SÉNES, (
Géog. m04.
)
en latin mo–
derne,
S a/litium , S anitienjium urbs ,
&c. petite vil/e,
ou plulÓt méchante bourgade de Franee, en Proven–
ce , útuée dans un terrein freid & íl:érile , entre des
Itlontagnes, avec un év&ehé a quatre lieues de Digne,
~
égale diíl:ance de Caíl:ellane ,
&
a quatorze d'A¡¡l–
bnm. L'éveché de
S ene{
n'eíl: connu que depuis le
vj. úecle; il eíl: fulfragant d'Ambrun , & vaut envi–
ron douze mille liyres de rente. La modicité de (on
revenu a fait qu'on a parlé
quelque~is
de I'unir
a
ce–
ltti
c e Vence; mais eH-il néceífaire que tous les éve–
chés' foient riches & eonúdérables.
Long.
de
Séne{
il4·18 .latil.
43 . 34.
(D. l.)
SENGLONS, f. m.
m medegatere
,
pieees de bois
Cju'onmet
a
l'jntrade de proue'& l'aiírade de pOllpe ,
d'un coté
&
d'autre, &
a
meme diíl:ance.
SEN-K! ,f. m. (
Médecine.
)
maladie particllliere
au Japon, & ú commune dans ce pa,ys , qu'il n'y a
pre(qtte per[onne qui n'en ait reífenti les atteipres;
Le úege de cette malarue eíl: dans les mufcles & dan
les intefrins du bas-ventre ; elle y cau(e des tiraille–
mens&des doulelus infupportables, furtout dans
le~
aines
&
dans les parties voifines , on fouvent il fe for–
me des tumeurs & desabfces. Cemal cruel eíl: caueé
par t'ufage immodéré du fad ci qui eíl: une biere tres–
teme faite avec le riso•
SENLIS ,
(Géog. mod.)
par les Romains
Augllflo–
magUJ, Auguflomagum , Alrebatttm civÍtas;
ville de
!'ile de Franee, (m la petite riviere de Nonnette, a
deux tienes de Chantilly, &
a
dix de Paris. Il y a
dans cette ville úx paroiífes, bailliage, l'rev9té roya–
le.
préúdial, élefuo n, grenier a fel, mar ',ha}úrée
,
SEN
&
capitail~erie
de chaífe. Cette viHe
~í1: .reglé~ ~n
partie par la contume de fon nom, qm ftit redigett
en Pan 1530,
~
en
p~rtie
p,ar !a c?utume
~u
Vexin
fran~ois.
Le chateau ou le prefidlal bent fes feances, a
été batl par S. Louis , & quelques enfans de France
y
ont été étevés.
L'éveché de
Sentis
eíl: (ulfragant de Rheims , & a
été établi, a ce qu'on dit, vers le milieu du üj . úe–
de. Le chapitre de la cathédrale eíl: compofé de tJ:'oís
dignités & de vingt-quatre canonicats ; ce cpapitre a
'le privilege de
committirnus,
par lettres patentes dtI
mois de Janvier 1550, regiíl:rées an parlement le
20
Mai 1560.
S enlis
eíl: aujourd'hni un gouvernement g.articulier
de l'lle de Franee. Elle étcit autrefois Ele la feconde
Belgique ) & les Romains qui I'ont bihie , lui attri–
buer.e¡¡.t un territoire. Hugues Capet étoit déja pro–
priétaire de eette ville , lorfqu'il fut élu r oi.
Longie.
fuivantCaflini,
19 .3 6.
3o.lat.
49. 12. 26.
Goutarl
(Simon), un des plus infatigables écri–
vains p'entre les Proteílans , étoit natif de
S entís,
&
fut miniíl:re a Geneve. Peu de gens oot exercé cet
emploi auffi long-teros que lui, car il (uccéda
a
Cal–
vin I'an 1564, momut l'an 1628 , agé de 86 am, &
il avoit preché fept jours avant fa mort. II étoir tel–
lemept au fait de tout ce qui fe paífoit en matiere de
tibrairie, qu'Henri 1II. deúrant connoltre l'auteur
gui (e déguiCa (ous le noro de
Slepha/lus l UfIi/ls Bru–
lUS ,
pour déb¡ter (a doéhine Jépublicaine > envoya
un homme expres a Simon Goulart , afin de s'en in–
former; mais Goulart
q~ú
favoir en effei tout le my–
frere, n'eut garde de le découvrir.
La Croix du Maine vous ,indiquera pluíieurs tra–
du8:ions
fran~oi(es
compo(ées par n otre [enli.iien.
.¡\joutez-y la verúon de toutes les reuvres de Séne–
que, & les méditations hiíl:oriques de Camérarius.
Scaliger eíltmoit beaucoup les ouvrages de
M.
Goulart. Son Cyprien eíl: ú bien & ú joliment tra–
vaiUé, dit-il, que je l'ai lu tout d'ltne haleine. Quand
il ne mettoit pas fon 110m a un liv ,ille déügnoit
par ces trois lettres initiales
S. G. S.
'qui vouloient
rure
,Simon Goulart fe/llijim.
C'eíl:
a
cette marque que
le P. Labbe croit, avec rai[on, I'avoir reconnu pour
l'auteur des notes marginales , & des fommaires qui
accompageent les annales de Nicetas Choniates , dans
l'édition de Geneve 15 93.
PajQl
(Franc;ois ), plus connu fous le nom du poe–
te
Liniere,
étoit furnommé de fon tems l'
al"'e
de
Sen–
lis.
11
étoit bien fait de (a per(onne,
{!x.
n ' avec d'a–
gréabtes qualités. Il av,oit de l'efprit, de la yivacité
& du tal'ent pour la poéíie ai{ée; mais fatyríque li–
bertin, débauché.
11
aeheva de fe
g~ter
par fa crapu–
le. II ne réuiffiífoit pas mal
a
des couplets (atyriques
& fm-tout a des chan[ons impies , ce qui .fit que D ef–
pi'éaux lui dit un jour ,
qu'il n'ayoil de l'ifpril que con–
lre D ieu.
Madame D eshoulieres , qui prend quelquefoís le
par,ti des ma,,:,vais
poe~e~
, s'eíl: efforcée autantqu'el–
le
1
a pu, de juíl:lfier Lllllere du Hj!proche d'irréliaion
& de liber.tioage ,quOiqll'il eút entrepris une
~riti
que abonunable dll nouve;¡1J Teílament. Voici les
propres vers de cette da¡ne.
O
n
te.
eroil ind¿vot, maÍJ
,
quoique
l'
012-
die,
le
cr~'S
,que
~ans
lefond
T iFíis
n'efl pas lmpie.
QUOlqU Ll ralUe f ouvent des artÍcles de
foi ,
le erois qu'il
efl
autant catholi'fut que mai.•• ;
Ce der-nier vers ne dOflneroit pas une haute idée de
la
ca.tho~icité
de la belte mure
fr~nc;oi(e ;
mais Linie–
re
!lll-m,e~e ~'eq ~voue
p.astaqt dans (on propre por–
tr¡11~,
0 11
il s explIque amfi fur les fentimens qu'il
avolt dela religioQ.
~a
leRure a rendu mon efpril affi{ fort
C()nlr~
tO/lUS l,s peurs
qllf
l'
qn a d, la mOTt;
















