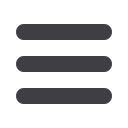
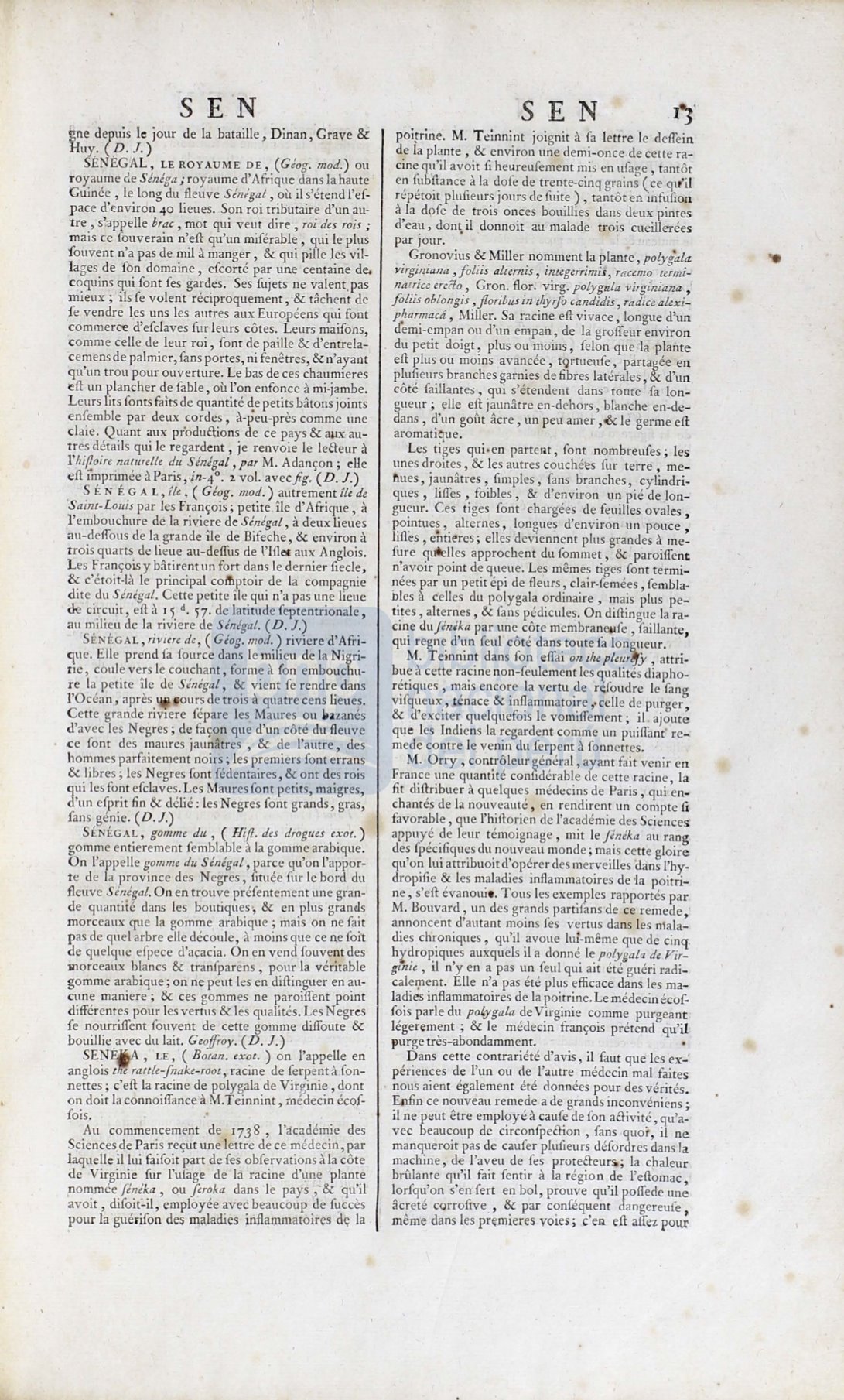
SEN
gne depuis
le
jour de la bataille, Dinan, Grave
Si
Huy.
(D.
J.)
SÉNÉG'AL, LE ROYAUME DE,
(G¿og. mod. )
ou
royaume de
Sénéga ;
royaume d'Afrique dans la haute
Guinée , le long du fl euve
Sin'gal
,
oll il s'étend I'e(–
pace d'environ 40 lieues. Son roi tributaire d'un au·
tre ,
s~appelle
brae
,
mot qui veut dire ,
roi des rois ;
mais ce fouverain n'efl: qu'un mi(érable , qui le plus
fouvem n'a pas de mü
a
manger,
&
qui pille les vil–
Iages de (on domaine, e[corcé par une centaine de.
coquins qui (ont (es gardes. Ses (ujets ne valent.¡>as
mieux; ils (e volent réciproquement, & tachent de
fe vendre les uns les autres aux Européens qlli tont
commerce d'e(cIaves (m leurs cotes. Leurs mai(ons,
comme celle de leur roi, (om de paille & d'entrela–
cemens de palmier, (ans portes, ni fenetres, &n'ayant
qu'un trOl! pour ouverture. Le bas de ces chaumieres
efl: un plancher de (able ,
Olt
l'on enfonce
a
mi-jambe.
Leurs lits [onts faits de quantité de petits batons joints
enfemble par deux cordes, a-p'eu-pres comme une
d aie. Quant
3UX
pr·oduaions de ce pays & allX au–
t res détails qui le regardent, je renvoie le leaeur a
1'lú(loire namreLLe du S énégal, par
M. Adan<;on; eHe
efl: ímpriméd
Paris,~n-4°.
1.
vol. avecfig.
(D.
J.)
S
E
N
É
G
AL,
tle
, (
Glog. mod.)
autrement
tle de
'Saint-Louis
par les Fran<;ois; petite ile d'Afrique,
a
l'embouchure de la riviere de
Sénégal,
a deux lieues
au-deífous de la grande tle de Bifeche, & environ
a
trois quarcs de lieue au-delfus de \'Iflor aux Anglois.
Les Fran<;ois y batirent un fort daDs le dernier íieele,
&
c'étoit·la le principal coiTlptoir de la compagnie
dite du
Sénigal.
Cette petite ¡le qui n'a pas une lieue
de
circuir, eít a
[5
d.
57.
de latitude feptentrionale,
au milieu de la riviere de
Sénégal. (D.
J.)
SÉ ÉGAL,
riviere de, (Glog. mod.)
riviere d' Afri–
que. Elle prend (a (ource dans le milieu de la Nigri–
tie, coule vers le couchant, forme a (on embouchu–
r e la perite ile de
S énégal,
& vient fe rendre dans
1'0céan, apres
ours de trois
a
quatre cens lieues.
C ette grande riviere (épare les Maures ou »azanés
d'avec les Negres ; de fa<;on que d'un coté du flellve
ce (ont des maures jallnatres , & de I'atltre, des
hommes parfairement noirs; les premiers (ont errans
&
libres; les Negres [ont (édentaires, & ont des rois
qui les font efelaves. Les Maures font petíts, maigres,
d'un
e~rit
fin & délié: les Negres font grands, gras,
fans genie.
(D.f.)
SÉNÉGAL ,
gomme da
, (
Rif!.
des drogues exot. )
"omme entierement femblable -a la gomme arabique.
On I'appelle
gomme du S énégal,
paree qu'on l'appor–
t e de la province des Negres, íituée fur le bord du
f1euve
S énégal.
On en trollve préfentement une gran–
de quantiié dans les boutiques; & en plus grands
morceaux que la gomme arabiqlle; mais on ne fair
pas de quel arbre elle découle,
a
moins que ce n.e foir
de quelque efpece d'acacia. On en vend (ollvent des
lllorceaux blancs & tranfparens , pour la véritable
gomme arabique; on ne peut les en difiinguer en alt–
cune maniere;
&
ces gommes ne paroiifent point
différentes pour les vertus & les qualités. Les Negres
fe nourrilfent fouvent de cetre gomme diífoute &
bouillie.avec dulair.
Geo.froy. (D.
J.)
SEN~,
LE,
(Botan. exol.
)
on l'appelle en
anulois
t1!l
raule-Jnake-root,
racine de ferpenta (on–
ne~es;
c'eít la racine de polygala de Virpinie , dont
on doir la
connoiífanc~
a
M.Teinoint, medecin éco[–
[ois.
Au commencement de
[738 ,
l'¡tcadémie des
Sciences.deParis re<;ut une lenre de ce médecin, par
laqueLle il hú fuifoit pan de (es obfervations
a
la cote
de Virginie (ur l'u(age de la racine d\llle plante
nornrnée
f¿nika,
ou
flroka
dans le pays ;& qu'il
avoit, difoit:'il, cmployée avec beaucoup de fucces
pOUI la guériCon des tnaJadies inflammatoires d<: la
SEN
. I~\
poifrine. M. T einnint joignit 11 (a lettre le deífein
de la plante, & environ une demi-once de cene ra–
cin~ q~l'il
avoit íi heureufemem mis en ufage , tantor
en íubCral,ce
a
la dofe de trente-cinq graios ( ce qLl'il
répétoit pluíieurs jours de (uite ) , tamot en infufion
¡\
la d\>fe de tI·ois onces bouillies dans deux pintes
d'eau, dont
Ü
donnoit au malade erois cm:illerées
par
JOUf. •
Gronovius & MiUer nomment la plante,
polyg'ala
virginiana , foLiis alternis, integerrimis , raUIIlQ u rmi–
Ilfwice ereao,
Gron. flor. virgo
polygala vilginiana ,
joliis oblongis , jloribus
in
t¡'yrfo candidis, radie. alexi–
pharrnacá ,
Miller. 5a racine eít vivace, longue d'un
demi-empan ou d'un empan, de la groífeur environ
du petit doigt, plus ou moins, (elon que la plante
eít plus ou moins avancée, t9rtueufe , partagée en
pluíieurs branches garnies de fibres latérales , & d'un
coté (aillantes, qui s'étendent dans toure fa lon–
gueur ; elle eíl: jaunatre en-dehors, blanche en-de–
dans , d'un goí'tt ¡¡cre, un peu amer ,
&
le germe efl:
aromatique.
Les tiges qui .en parteut, font nombreu(es ; les
unes droites , & les autres couchées fur terre , me–
I'lues, jaunatres, fimples , fans branches, cylindri–
ques, liífes, foibles,
&
d'environ un pié de lon–
gueur. Ces tiges font chargées de feuilles ovales ,
pointues, alternes , longues d'environ un pouce ,
liíles ,
e~tieres;
elles deviennent plus grandes a me–
(ure ql¡jelles approchem du fornmet, & paroilfent
n'avoir point de queue. Les memes tiges font termi–
nées par un petit épi de fleurs, elair-femées , fembla–
bies
a
celles du polygala ordinaire, mais plus pe–
tites, alternes, & (ans pédicules. On difringue la ra–
cine du
Jé"ika
par une cote membran(lj;¡fe , faillante,
qui
regn~ d'~n
feul coté dans.toute (a
lon&.~eur.
M. Tell1ntnt dans fon elfal
on the
pleur~j
,
attri–
bue a cette racine non-felllement les qualités diapho–
rétiques , mais encore la vertu de r¿[oudre le fang
vifqueux , ténace & inflammatoire " celle de puruer
&
d'exciter quelquefois le vomilfement; il
ajgut~
que les Indiens la regardent comme un puiífanf re–
mede contre le venin du ferpent
a
fonnettes. .
M. Orry , controleur général , ayant fait venir en
France une quantité wníidérable ele cen e racine, la
fit difrribuer 11 quelques médecins de Paris, qui en–
chantés de la nouveauté, en rendirent un compte
fi
favorable , que l'hiíl:orien de I'académie des Sciences–
appuyé de leur témoignage , mit le
Jénéka
au rang
des fpécifiques du nouveau monde; mais cette gloire
qu'0I?- lui attribuoitd:opérer des mer.veilles üa'ns I'hy–
droptíie
&
les maladies Il1flammatOlres de ·Ia poitri–
ne, s'eít évanoui• . Tous les exemples rapportés par
M. Bouvard , un des grands partifa ns de ce remede '
annoncent d'aucant moins fes vertus dans les
n1ala~
dies chroniques , qu'il avoue !tú-meme que de cinq,
hydropiques auxquels
il
a donné le
p olygala de Vir–
glñi.
,
il n'yen a pas un feul qui ait été guéri radi–
calery¡em. Elle n'a pas été plus efficace dans les ma–
ladies inflammatoires de la poirrine. Le médecin écof–
(ois parle du
pol¡ygala
de Virginie comme purgeant
légerement ; & le médecin fran<;ois prétend qu'i!
purge tres-abondamment.
'
Dans cette contrariété d'avis, il faut que les ex-'
périences de I'un ou de I'autre médecin mal faites
nous aient également été données pour des vérités_
Enfin ce nouveau remede a de grands inconvéniens ;
il ne peut etre employéa caufe de fon aaivité, qu'a–
vec beaucoup de circonfpefrion , fans quo;, il ne
manqueroit pas de caufer pluíieurs défordr es dans la
machine , de I'aveu de fes proteaeurs.; la chaleur
bñtlante qu'ü fait fentír
a
la régio n de l'efiomac,
lorfqu'on s'en fert en bol, prouve qu'il poífede une
¡¡creté corrofive. , & par conféq\lent dangereu(e ,
meme dans les
pr~nlieres
voiei ;
,'en efi
aí[ez PO\U'
















