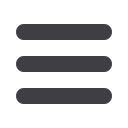
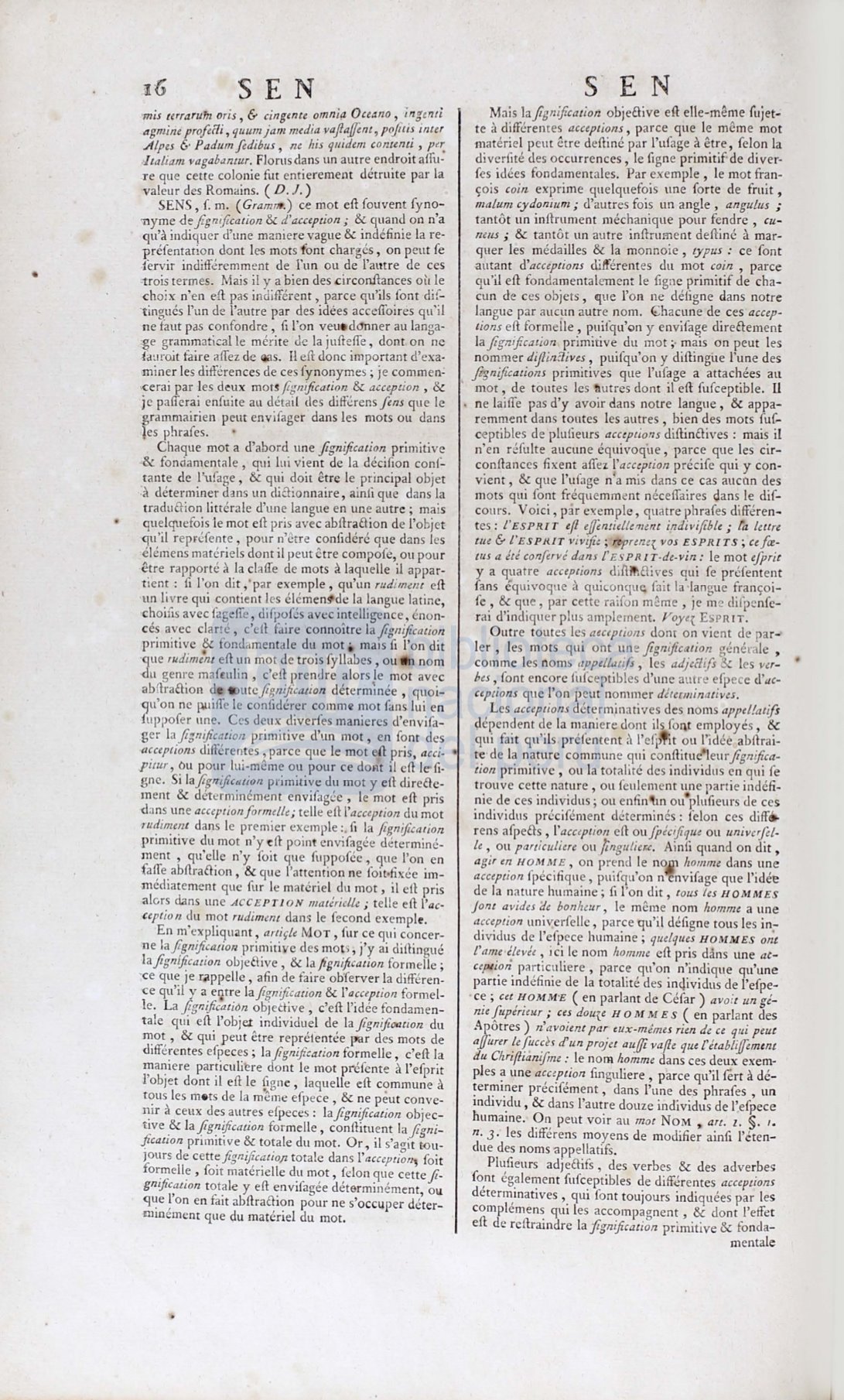
SEN
'mis terraruln oris ,
&
cingente omnl{l G.ceano,
l~genti
agmine profeflj , t¡uum jam media
vQjI~J1ent, PoJill~
mter
A lpes
6·
Padumfidiblls , ne Izis q/lldem
COntW~', p(.~
.Italiam vagabantur.
Florns dans un alltre endr01t alfu–
re que cetre colonie fut entieremem dérruite par la
valeur des Romains. (
D.
J.)
SENS , f. m.
(Gramrlf.)
ce mot efi fouvent fyno–
lI1yme
dejignificalion
&
1'accepúoll;
~ ql~an~
on n'a
qu'a indiquer d'une mamere vague
&
,~defime
la re–
préfentation dont les mots fom charges , on peut fe
fervir indifféremment de l'un ou de l'alltre de ces
-trois termes. Mais il y a bien des c ireon.fiances 01' le
choi x n'en efi: pas inditrérent , paree qu'ils font di{–
·tingués l'un de l'mltre par des idées acceífoires qu'il
ne faut pas confondre, íi l'on veu donner au langa–
~e
grammaticalle mérite de la jufie.ífe , dom on ne
laaro.itfaire aífez de
QaS.
11
eíl: done Important d'exa–
miner les diiférences de ce fynonymes ; je commen–
,cerai par les
d~ux
mou
p¡;nification
&
accep úon
,
&
jc
paíferai enfui te al! détai[ des différens
¡ens
que le
grammairien peLlt envifager dans les mots ou dans
les phrafes.
.
, Chaque mot a d'abord une
jigllificalion
primitive
&
fonciamenta le, qui lui vient de la déeifion eon(–
tante de l'l¡(age,
&
qui doit erre le principal objet
.;¡¡
déterminer dans un diéhonnaire , ainfi que dans la
tradu Etion littérale d'une langue en une autre; mais
quelquefois 1e mot efi pris avec abfi:raEtion de l'objet
qu 'il repréfente, pour 1'etre eoníidéré que dans les
élémens matériels dont il peutetre eompofe, ou pour
erre rapporté
a
la cla[e de mots
a
laquelle
il
appar–
tient : fi I'on dit, ' par exemple, qu'un
rudimelll
efi:
'un livre qui eontient les élémen de la langue latine,
'choifis avee fageífe ,
difpo~'
s avec intelligenee, énon–
cés avee clarté , c'eíl faire eonnoltre la
jignijication
primitive
&
fonclament;,¡le du mot. mais
Ji
l'on dit
'que
rudim/nt
efi un mot de trois fyllabes, ou.-n nom
-<lu genre mafw lin, c'ea prendre alors le mot avec
abfiraEtioR de ute
jignijication
déterminée , quoi–
-<ju'on ne
~.\iífe
le confidérer eomme mot fans lui en
fuppofer une. Ces deux diverfes manieres d'envifa–
gel' la
jignijicdtion
primitive d'un mot, en {om des
(Icceptions
différentes , paree que le mot ell: pris,
acci–
.}Jitur ,
Ou pour lui-meme ou pour ce doflt il efi le fi–
gne. Si la
jignijicotion
primitive du mot y efi direEte–
ment
&
déterminément envifagée , le mot efl: pris
-dans une
acceplioTlformell. ;
telle efi
l'acception
du mot
1'udimenl
dans le premi er exemple:. íi la
jignijica/ion
primitive du mot n'y eíl: point envi fagée déterIlÚné–
ment , qu'eUe n'y foit que fuppofée, que l'on en
faífe abfiraEtion,
&
que Pattcmioo ne foit·fixée im–
médiatement que fur le matériel du mot, il en pris
alcrs dans une
ACCEPTI ON lIlalérielle ;
telle eíl:
l'ac–
&eption
du mot
rudiment
dans le fecond exemple.
En m'expliquant,
arti~t.
MOT,
fur ce qui eoneer–
ne
la jigllificatioTl
primitive des mot5, j'y ai difiingué
la
jignlfication
objeEtive ,
&
la
fign ification
formelle ;
'ce que je r¡¡ppelle, afin de faire obferver la différen–
ce qu'il y a e2rre
lajignificacion
&
l'occeplion
formel–
le. La
jignificalion
objeéJive , c'efi I'idée fondamen–
tale qui eíl: l'obje.t individuel de la
jigniji()(/tion
du
mot ,
&
qui peut etre reprét"entée l"ar des mots de
différentes efpeees; la
fignijication
formelle, c'efi la
maniere partieulicre dont le mot préfente
a
l'efprir
robjet dont il efi le íigne , laquelle efl: commune
a
rous les
m~ts
de la
m~me
efpeee ,
&
ne peut conve–
nir
a
ceux des autres efpeees : la
jigllijication
objee–
tive
&
la
jignifiCl1liOTl
formeHe , eoníl:ituent la
jigni–
jication
primitive
&
totale du moto
01',
il s'aait t<lU–
jours de eette
fign ifica liofl
rotale dans l'
nccepti~lJ)
{oit
formelle, foit matérielle du mor, felon que eette
ji_
gnification
totale y eíl: envifagée déterminément, ou
<J~e
l'on en fait abfiraEtion pour ne s'oecuper déter–
f1l1oément que du matériel du mot.
s
EN
Mais
Jafgnijicalion
objeEtive efi elle-meme (ujet–
te
a
différentes
acceptions,
paree que le meme mot
111atériel pellt erre defiiné par l'ufage
.a
e.t~e ,
fel? n la
diveríité des oceurrenees, le íigne pnmlt1fde dlver–
fes idées fondamentales. Par exemple, le mot rran–
¡,:ois
coin
exprime quelquefois une forte de fmit,
lIIalum cydonium;
d'autres fois un angle,
angulus ;
tantot un infirument méehanique pour fendre,
Cll–
ne/lS ;
&
tantot un atltre infirument defiiné
a
mar–
quer les médailles
&
la monnoie,
o/pus:
ce font
autant
d'accepúons
clitférentes du mot
coin
,
paree
qu'il efi: fondamentalcment le íigne primitif de eha–
eun de ces objets, que 1'011 ne déligne dans notre
langue par aucun autre nom, G:hacune de ces
accep–
liolls
eíl: formelle , puifq u'on y envifage dircEtement
la
jignijicatioTl
primitive du mot;' mais on peut les
nommer
diftinaives ,
puifqu'on y diíl:ingue l'une des
.!8nificalions
primirives que l'ufage a attaehées au
mot, de toLltes les !tutres dont il efi fufeeptible. II
ne laiífe pas d'y avoir dans notre langue ,
&
appa–
remment dans toutes les aun'es , bien des mots fuf–
cepribles de plutieurs
accepúons
dillinEtives : mais iI
n'en réfu lte aueune équivoqlle, paree que les eir–
coníl:anees fixe nt aífez
l'accepúon
préeife qui
y
eon–
vient,
&
que l'ufage n'a mis dans ce eas aueon des
mots qllÍ font fréquemment néeeífaires dans le dif–
cours. Voiei, par e"emple, quatre phrafes différen–
tes:
l'ESPR fT efl e1!enlÍellemertt indivifible ; la ¡eure
tlU
&
l'ESPRIT vivijic; reprene{ 'Vos ESPRfTS; cef!E–
tllS a
éLé
confirvé dam I'EsPRIT·de-vin:
le mot
efprlt
y a ql1atre
accepliol1J
dill Etives qui fe préfentent
fans équivoque
a
quieonque. fait la 'Iangue fran¡,:oi–
fe,
&
q\1e, par eette raifon meme , je me difpenfe–
rai d'indiquer plus amplement.
Voye{
ESPRIT.
Ourre toutes les
aectptions
dem on vient de par–
ler, les mots qui ent une
jignificlltioll
générale ,
eomme les noms
appellatifs ,
les
adjeaifs
&
les
v<r–
bes,
font eneore fufe eptibles d'une aUlre efpece d'
tlC–
ceptions
que I'on peut nommer
déterlllinatives.
Les
acceptiolls
déterminatives des noms
appd!alifs
dépendent de la maniere dont ils font employés ,
&
qui fait qu'ils pré(entent
a
l'eI'p it ou l'idéé abfirai–
te'de la natme eommune qu i eonfiitue'leurjign!fica–
tion
primilive , ou la totalité des individus en qui fe
trouve cette nature, 0\1 feulemenr une partie indéfi–
nie de ces individus; ou enfin n ou·pluíieurs de ces
individus préeifément déterminés: (elon ces diff$o.
rens afpeEts ,
l'amptioll
efi
ou fp écijique
0\1
univcrfel–
le,
ou
paflicllliere
011
Jillglllier.c.
Ainfi qlland on dit •
agir <n HOMME ,
on prend le no
1
/¡olTlme
dans une
aaepúon
fpécifiqu e , puifqu'oll n envifage que l'idée
de la nature humaine; íi I'on dit,
IOUS
tes JlOMMES
j onl avides (fe bonlzeur ,
le meme nom
Izomme
a une
acception
univerfelle, paree qu'il
déíign~
tous les in;–
dividus de I'e(pcee humaine ;
t¡uelques JlOMMES Olle
l'
ame ¿¡evi,
,
ici le nom
ItOlTlllle
efi pris dáns une
aC–
"púo';
particuliere , paree qu'on n'indique qu'une
partie indéfinie de la totalité des
in~ividus
de I'efpe–
ce;
ca
HOMM'E
(
en parlant de Céfar )
avo;! un
gé–
nie fupérieur
;
ces douze
JI
OMMES
(
en parlant des
Ap'0tres )
,,'avoi<nl par eux-melTles rien de
ce
t¡ui pcut
aJ/arer lefucces d'un projet allJli vafle que l'élablijJement
da Cltrifliánijine:
le nom
Izomme
dans ces deux exem–
pies
~
une
a~cef~ion
fll1guliere , paree qu'il rert
a
dé–
~er':'l1.ner
pree,fement, dans l'une des phrafes , un
IndiVldu,
&
dans l'autre douze individus de ¡'efpece
humaine. On peut voir au
mOL
NOM •
arto
; ,
§.
l.
11.
3 · les différens moy ens de modifier ainfi I'éten–
due des noms
~ppellatifs.
Pluíiellrs adjeEtifs, des verbes
&
des adverbes
fom éga lement fufe eptibles de différentes
acceptions
dérerminatives , qui fom toujours indiquées par les
eomplémens qui les aeeompaanent,
&
dont l'effet
efi: de rcíl:raindre la
jigniJicalign
primitive
&
fonda-
mentale
















