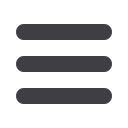
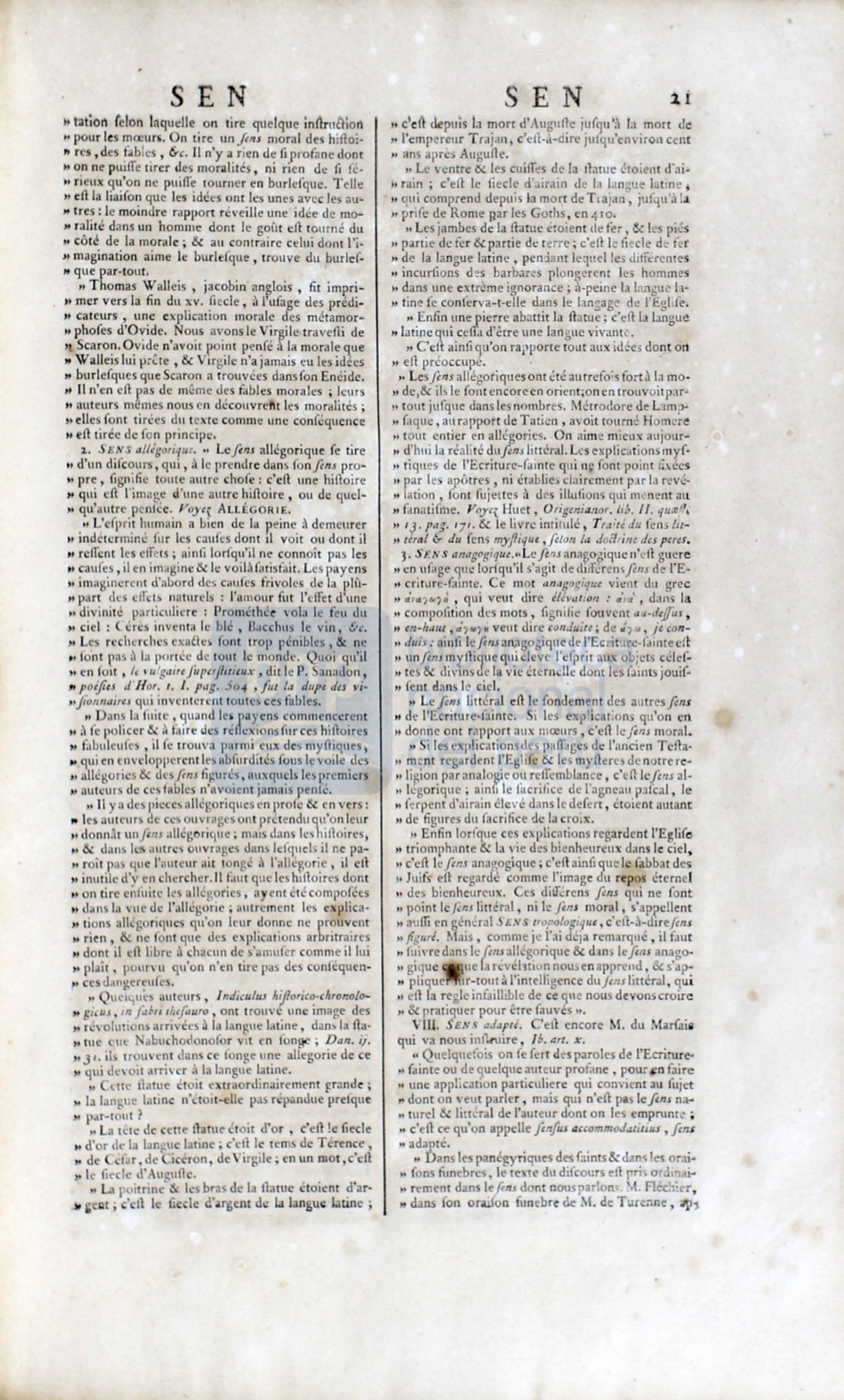
SEN
11
tation relon lnqu elle on lire quelquc infuu ion
.. pour les m m. o tire uo
fins
moral de hiftoi-
1>
res , des fablcs ,
&c.
II
o'y a rien de fi profa ne dool
.. 00 oc plú{[e lirer de moralilés , oi rien do: fi
(e–
.. rieux qu'oo oc puifle 10Urller en bu rle(quc. Telle
., en la liai(on que le idées 001 les une ave le 3U–
.. lres : le moindre rapport réveille une idee de mo–
"ralil dans uo homl11 e dom le gOllt
el1
lourné du
"colé de la morale ; &
3U
coolrdirc ctdui donl I'i–
., maginarion aime le burldque , lrouve du blUlef–
.. que par-lout.
"Thoma \Vallei , jacobin anglois , fil impri–
" mer vers la fin du xv. fiecle ,
~
l'u(age
des
prédi–
" carcur
une expü alion mora lc
des
méramor–
"pho(es d'Ovide. Nous nvoos le irgile Ira
eai
de
'1
caron.Ovidc n'avoit poinl penré
a
la morale qll e
"Wallei lui prtle ,
&
IrSil n a jamais eu
les
idées
" burle(qucs que ca r n a rrouvées dans (on Enéide.
" [I n'en en pa de
m~me
de fub les
mora l~
; lell rs
" nuteurs mames nous n découvrelll les moralilés;
"elle (001 IÍrée du texle comme une conCéqucnce
)1
e[l
LÍrée de (on principc.
2. E
ill/(cori'lIl<. "
Le
flns
allégorique
(e
lire
" d'un difcours , qui ,
¡\
le prendre
dan~
(o nfins
pro–
" prc, fi nifi c toute aune chofe : c'en une hiHoire
" qui en I'imase d'un e alllre hinoire, ou de quel–
.. qu aUlre pcnfcc.
Y o)'ti.
ALL ÉGORI
E.
II L'"Cpri t humain a bieo de la r.eine
a
demeurer
ti
ind termine (u r
le~
au(es don! JI voit ou dom il
.. reflent les effclS ; ai ofi loríqu'ilne connoit pas les
.. cau(es , il en imagine '
k
voilHmisfait. Le payens
" imagincr n! d'abord de callfes frivoles d la plCt–
"parl de
drct~
nOlurelb : I'amour flll I'errel d IIne
I di inité p. rticulicrc : Promélhée \'ola le feu du
.' ci el: érc invenla le ble , Bac hu le vin, {/ .
" Les re hc r he exaflc 1'001 trop pénibles ,
&
ne
.,
~
ot pa :, la pOrt ee de tom le monde. Quoi qu'il
" n
1011 ,
h , " lgair.jiIP<rj/ttim.T ,
dit le
P.
'anadon,
1>
poiji<J d·Hor.
t ,
l. p"g.
.50-1
fill
111
dllpt dts vi·
" Iollllui"s
qui invenlCrcnllOlllc ces obles.
" nn 1, fui le, qU3nd les payen commcnccrem
.. a
fe policer
&;,
faire de rellexions
(m
ces hinoires
"
,buleu (~
, il (e IrOllva pnrmi ell des myfiiqucs!
.. '1ui en
t
11
d oppercnt le abl¡udil f'ous le oile de
"
¡¡lléBorie~
&
de
fins
figurés , nllxqll l le premiers
., OUlcurs de ce fable n'nvoient jamai
pcnf~.
" Il
3
des ¡¡iece
alié
oriqlles en \,rofe
&
n vers:
.. les :Jlllcur de
I!
ou r.lgt! on! prcteodu qu'onleur
, doonnt ullfins
allég
riquc; mais dan le' hifl ire
1
" , d;¡n& I amr' IIvragc dnn Idqud il nc pa–
" r It pa que l.alllem ail
IOng~ , l'allé~ori
,
il
ell:
»
inuti l.., d'y en hcrcher. ll t:llIt que le hlfioircs dom
ti
n lire
~\fllite
I alle
'oric~,
n
eOl etc compofé
.. dan la vlle de l'allJSorie ; 3utremeO! les explica–
" tion ' allégQriqllc qu'on leu r donoe ne pr uvem
I rien '
ne
fon! que de e"pli ation arbrilraire
" doO! il efi librt! :, chncun de
~'ilmu{er
comme illui
)1
plail, pOllC\ u qu'on n'en lire
pa~
de onfcquen–
" e
ddll¡:ereu
fe .
, uct<¡lIt , Uleuc
I
l ndiculus hi{lof¡to'c!lfollolo–
" ghu.f .
In
j '.lb" '¡/tf lUfO,
001 trouvé' une
im~ge
des
, r~ \
lUIl n :lrri él'
~
la I
O~"(!
1,ltine dD", In
n~.
>.
tue
Ul
"bu h
nof r
\' 1\
n n ;
DUII. lJ.
, ',. il
trOU
en l dun
ce
lon~e
Illle a11egori... de
e
, qui uc\'oit ,Irri, cr ; In langu!)
1
lint'.
"
lile
¡tuue el il
é
Ira
rdinairement F-randc ;
, la hlnF-uc 1.¡lin
11'~t
II-dle
p,lS
r~p
ndue prefqut
, p,lr-IOU(
?
.. 3
lelC de
cw
nallle
lt
il d'or
en !e fi e le
.. d'
r
11 .. 1 ..
IJn~ue
l.ltine:
'dl
le tcm., de crenee,
de d :lr, de i
I1r
n de \ ir¡;ilc ; en un mOL
\ :JI
, l.
lie
l '
d'
lI~ul1'.
" I
IIrine' . 1 ...
bra'
de la
II
lue Lloienr d'ar·
r; . ,(\ ll!
Ú'
le '
rgent
do.:
la
lan ue laline .
EN
11
" cle clepuis
la
mon d'Augufte
ju(qu'~
la mon de
" I'cmperellf
Traj~n,
c'cft-,i-dirc juJqu'cnvir oc
Ilt
" ans apre Augulle.
" Le ventre
&
le eui{[cs de la ftame \roient d'ai-
1>
rain; c'en le lieele d'airain de
h
lan uc lallne
,, (:"i comprend depuis la mOr! de TlaJdn juJqu'a
I
" pnfe de
ROOle
llar les orh , en
4
J
O.
" Les jambes de la [lame 'Ioient de (er , & le piés
"partie de fcr
&
parlie de rerr,,; c'eH 1 fi ecle d
f
f
" de la langue laline I pcnd;lnt lequc1lcs ditferente
" incudions des barbares plongercnr le hummc
.. dans une ext me ignorance . a-peine la Ifln
Ui'
h–
" tin fe conferva-t-tdle dans le langage ele rEgl
fe.
.. Enfin une pierre aballit la ftatue' c'elll langue
n
lalinequ i ce{fd d'erre uoe langlle ivantlé.
" 'efl ai nfi qu'on ra porte
tOut
aux id (es dont olÍ
" eft pr occupé.
'o
l e fl nsallégoriqucs ontétéau rrefoi forta la mo·
" de,& il le f'onrencore en orienl'onen lrou oitpar.
, rO\ll juCque dans le nombre.
M'
Irodore de L:tm' •
" (aque, au rapport de Taticn , a oit tourné Hom re
"tout cntier en allégoric . n aime mieux aujour–
" d'hui la réalilc
dufons
li!téral. Les explicarion myf·
, liques de l'Ecritu re-(ainte qui
lIe
(001 poiO!
,lÍes
" par le apemes , ni établie dairement p,lr la
rev~·
" lation , l'oor fujel te
a
de illulion qui rneneOl all
" frt naLÍCme.
Voy<{
Huet
Orig<nianor. lib.
/1 .
11l11J•• ,
" ' 3,
PIlIJ·
' 7"
&
le livre inti!Ulé
1
Tr.,it¿
di
len"
lu–
" "ral
&
du
(cm
m)'jliqut ,folOIl l" dofl,ine dts p<rtS•
3.
S EN (ulIl!Jogi'lue...
Le
fins
aoa~ooique
lI'el1
guere
" en ufi,ge que lorlqu
il
s'agil
ele
dilfércmfil/s d I'E–
" criwre·f.'lOtc. e mOt
allllgor;i'lUt
viellt du grec
" .;,....,..., ,; , qll i veut dire
¿¡¿Vtll/M
"
,¡"i
, dan la
ti
compol11ion des rnOIS, fi niti!: (OUVCnt
oll·,úffIlS ,
" tn-htllU
' ';'''''1"
veut dire
on./ui,. ;
de .:,..
j.
COII–
" d/lis ,'
ainli
lefill.fanp~ogiquede
l'Ecriturc-l;tintedl:
" lInfons
myílique qui lev I'dprit aullO objcts
célel~
" tes & divin de la vie lern
ll~
donr les lainrs joui(.
" fem
dan
le ciclo
" Le
flm
lilléra l en le fondement des mltres
flns
" de l'Ecriture·faime. t le ex¡>li at ;ons qu'on en
ji
donne 001 rap pon aux mamrs , c'eft le
fln!
moral.
" i les explic31ions de paflages de I'ancien Tefta·
" meO! regardent l'Egli(e
&
le
mynere~
de notre re–
ti
lipion paranalogie ou rcflemblaoce , c'cn
lefins
al–
, legorique ; ainfi le facrifice de l'agneau p3(cal I le
ti
Cerpent d airain élev dans le defert , élOient aUlant
ti
de figure du (acrifiee de la croix.
I Enlin lorlque ces
e~pücations
regardent I'EgliCo
" Iriomphante
&
la \'ie des bienheurelLx daos le cíel,
, c'cft
lefills
anagogiquc ; c'en ainúque l abbat de
" Juifi en regardé comme l'image du repos éternel
l '
de bienhcurcux. e
dilf~rens
flns
qui /le (ont
" point le
fins
lilléral ni le
flns
moral, s'appeUent
, ouffi
en
gén~ral
EN s tropologiqut, e'cn-3-dtrejéns
"hurt.
lais, comme je l'ai déja remarqué il fuur
" fuinedaos le {tnsallégoriquc & d.J1l
lefins
3nago–
" gique
ue fa
rcvc!htiun nous en apprend
I
'
s'ap–
" plique Ir-tout
a
l'intel1igcnce
dujws
li([.lral, qu i
I ellla regle infaillible de ce
lIe
nous de on> roire
, &
praliqller pOllr rre (auv SI.
'111.
EN
s
"J"'pl
•
efi encor
1.
du anai
qui va nous infintire I
l b,
"rl. x.
" uelqll foi on fe ferl des paroles de
1
Ecrirure–
" (ainte ou de quelquc allleur
prof.mepour o faire
" une appl' .lIion parti uliere qui COI\\.j nt au (ujel
,. dont on "eut parler ma' q\ll n' fi pll51efin.s na–
Ilmel li
I~ral
de l'auteur don! on le emprunt · ;
" c'
11
ce qu'on app
Ue
finfus a"ommoJollítius
fl
, :Idapré.
, Daos le pan 'gyriqut' des(¡¡inls& daM cs orm–
.. fo n I\lOebre , le te
e
du diJeours
ell
¡rri; or, .
~
" remenr dan 1
f ns
d
nI nOlls parlon . .
Fléc.
i r,
daos
ion
or.won fun bre
de
M, d
T urenne
óIll
















