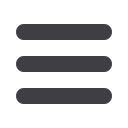
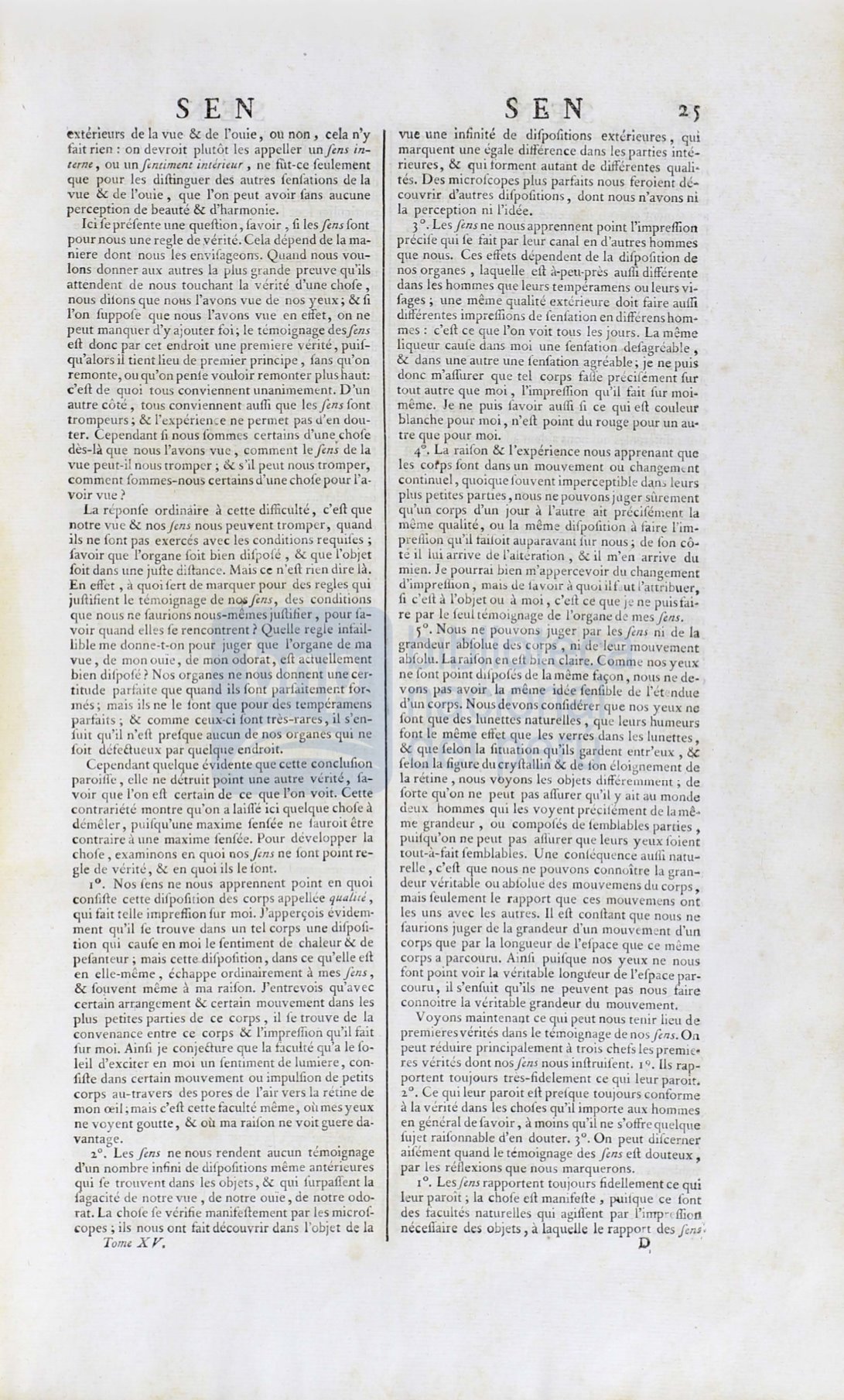
SEN
exterieuts de la vue
&
de l'ouie, oH non, cela n'y
fait rien : on devroít plutot les appeller
unfins in–
tune ,
ou
un fintiment imérieur
,
ne Ita -ce feulement
qtle pour les diftinguer des auo'es fen{ations de la
vue
&
de l'ouie, que I'on peut avoir fans aucune
perception de beauté
&
d'harmonie.
Ici fe préfente une queíEon , favoir , fi les
fins
font
pour nous une regle de .vérité. Cela dépend de la ma–
niere dont nous les envifageoHS. Quand nous VOtt–
lons donner aux autres la plus grande preuve qu'ils
attendent de nous touchant la vérité d'une chofe,
nous difons que nOI1S I'avons vue de nos yeux ;
&
fi
l'on fuppo(e que nous l'avons vue en effet, on ne
p eut manquer d'y ajourer foi; le témoignage des
fins
eí!: donc par cet endroit un e premiere vérité, puif–
qu'alors il tient lieu de prernier principe , fans qu'on
remonte, ou qu'on penle vouloir remonter plus haut:
e'eí!: de quoi tous conviennent unanimement. D 'un
autre coté , tous convienn ent aufli que les
fins
font
trompeurs ;
&
l'expérien e ne permet pas d'en dou–
ter. Cependant
íi
nous fommes certains d'une chofe
des-la que nous l'avons vue , comment lefln; de la
vue peut-il nous ¡romper ;
&
s'il peut nous tromper,
eomment
fommes-nou~
certains d'une chofe pour l'a–
voir vue?
La réponfe ordináire
a
cette difficulté , c'eí!: que
nptre
\fU
e
&
nos
¡ens
nous peuvent tromper, quand
ils ne font pas exercés avec les conditions requifes ;
favoir que l'organe foil bien difpofé ,
&
que l'objet
foil dans une juí!:e diHance. Mais ce n'eí!: rien dire la..
En
eRet
,
a
quoi
lert
de marquer pour des regles qtll
jufiiñent le témoignage de no,s
fins ,
des conditíons
que nous ne faurions nous-memes juí!:ifier , pour fa–
voir quand elles fe rencontrent? Quelle regle infail–
lible me donne-t-on pour juger que l'organe de ma
vue , de mon ouie, de man odora!, efi a luellement
bien di{pofé? Nos organes ne nous donnent une cero
titude parf.l ite que quand ils font parfaitemer.t for_
més; mais ils r.e le lont que pour des tempéramens
parfaits;
&
comme ceux-ci font tres-rares , il s'en–
fuit qu'il n'eít prefque aucun de nos organes qui ne
foit défe.:tueux par quelqne endroit.
Cependant quel9ue évidente que cette co,:clufion
paroiífe, elle ne detruit point une autre
vé~té ,
fa–
voir que I'on eí!: certain de ce que I'on VOlt. Cette
contrariété montre qu'on a laiíle ici quelque chofe
a
démeler, puifqu'une maxime fenfée ne {amoit etre
contraire
a
une maxime fenfée. Pour developper la
chofe, examinons en quoi
nosJ ens
ne (ont point re–
gle de vérité ,
&
en quoi ils le {om.
.
.
1°.
Nos fens ne nous apprennent pOlflt en quol
confifie cette difpofi rion des corps appellée
quaufé,
qui fai t telle impreffion fu r moi. J'apperc;:ois
é~idem
ment qll'il fe trouve dans un tel corps une difpofi–
lion qui caufe en moi le fentiment de chaleur
&
de
pefanteur; mais cette..difpofition, dans ce qu'elle eí!:
en elle-m@me, échappe ordinairement
a
mes
fens,
&
fopven t meme
a
ma raifon. l 'entrevois qu'avec
eertain arr,angcment
&
certain mouvement dans les
plus petites parties de ce corps, il (e trouve de la
convenance entre ce corps
&
l'impreflion qu'il fait
(ur moi. Ainfi je conje.:tttre que la flculté qu'a le
(0-
leíl d'exciter en moi un femiment de IUlIliere, con–
fií!:e dans certain mouvemem ou impulfion de petirs
corps au-travers des pores de l'air vers la rétine de
mon ceil ;mais c'efi cette faculté meme, ollmesyeux
ne voyent goutte,
&
Ol!
ma raifon ne voit guere da·
vantage.
2°.
Les
fins
ne nous rendent aucun témoignage
d'un nombre infini de difpofirions meme antérieures
qui fe trouvent dans les objets,
&
qui (urpaíl'ent la
{agacité de notre vue , de notre otúe, de notre odo–
rar. La chofe fe vériñe manifeítement par les microf–
copes; ils nous ont faít découvrir dans l'ohjet de la
Tome XI'.
SEN
vue une infi nit,é de dif¡Jofitions extérieures, qui
n:arquent une .egale dltférence dans les parties inté–
n eures ,
&
qudorment auta¡;¡t de différentes quali.
tés. D es microfcopes plus parfd its nous feroient d
'~
couvrir d'autres difpofitions , dont nous n'avons ni
la perception ni l'idée.
t·
Les
¡ens
n~
nous apprennem point l'imprefli on
p reclfe qUl (e falt par leur canal en d'autres hommes
que nous. Ces effets dépendent de la difpofirion de
nos organes , laquelIe eí!: ¡j·peu·pres aufli différente
dans les hommes que lems tempéramens ou leurs vi–
fages ; une meme qualité extérieure doit fai re auíIi
différentes impreflions de fenfarion en différens hom>
':les : c'eí!: ce que l'on vOlt tous les jours. La meme
liqueur caufe dans moi une fenfation defagréable ,
&
dans une autre une fenfation agréable ; je ne llUis
donc m'a{[urer que tel corps falle précifément fur
tout autre que moi , l'impreflion qu'il fait fur moi–
meme.
l e
ne puis favoir auffi fi ce qui eO: couleu!'
blanche pour moi, n'eíl: point du rOllge pour un au–
tre que pour mOl.
4"· La rai(on
&
l'expérience nous apprenant que
les cofps (ont dans un mouvement ou chano:emlnt
continuel, quoique fouvent imperceptible
da;~
leurs
plus petites parries , nous ne pouvons juger sl'irement
qu'un corps d'un jour
a
l'autre ait précifément la
meme qualité , ou la meme difpofition
a
faire l'im–
preflion qu'il faifoÍt auparavam litr nous ; de fon co–
té il lui arrive de l'altérarion ,
&
il m'en arrive du
mien.
l e
pourrai bien m'appercevoir du chanaement
d'impreffion, mais de
la
vOlr 11 quoi il f:Out
l'art~'ibuer
íi
c'el1
a
l'objet ou
a
moi , c'eíl: ce que je ne puisfai:
re par le (eul témoignage de l'organe de mes
fins.
5°· Nous ne pouvons juger par lesfens ni de la
grandellr abfol ue des corps , ni de leur mouvement
abfolu. La raifon en eH bien cIaire. Comme nos yeux
ne font point difpofés de la meme fac;:on , nous ne de–
vons pas avoir .la meme idée fenfible de l'étendue
d'un corps. Nous devons confidérer que nos yeux ne
(ont que des lunettes naturelles , que leurs humeurs
fo nt le meme effet que les verres dans les lunettes
&
que (elon la fi[Hation qu'ils gardent entr'eux ,
&.
feJon la figure du cryí!:allin
&
de Ion éloignement de
la rétine , nous vbyons les objets différemment ; de
fO'rte qu'on ne peut pas a(furer qu'i l y ait <}lt monde
deux hommes qlli les voyent précifement de la me.
m~ ~r~ndeur,
ou compofés de {emblables parries ,
pUlÍqu on ne peut pas aífurer que leurs y eux foient
tout-a-fait (emblables. Une conféquence auffi natu–
relle , c'eO: que nous ne pouvons con nOltre la gran–
deu r véritable ou abfolue des mouvemens du corps
mais (eulement le rapport que ces mouvemens
on~
les
~ns
a.vec les autres.
11
eO: conítant que nous ne
faunons Juger de la grandeur d'un mouv ment d'un
corps que par la longuem de l'efpace que ce meme
corps a parcouru. Ainfi puifque nos yeux ne nous
font poi?t
~oir ~a vé~~table
longtfeur de l'efpace par.
couru ,
11
s enfll1t qUlls ne peuve nt pas nous faire
connoitre la véritable grandellr du mouvement.
Voyons maintenant ce
~ui
peut nous tenir lieu de
premieresvérités dans le temoignage de
nosfins.
On
peut réduire principalement
a
trois chefs les premie–
res vérités dont nosfim no
liS
infiruifent.
1° .
Ils
rap–
ponent toujours tres-fi delement ce qui lem paroit.
2°.
Ce qui leur paroit eH pre(que toujours conforme
a
la vérité dans les chofes qll'il importe aux hornmes
e~ gén~ral
defavo:r,
a
moins qu'il ne s'offreqllelque
fUJet riufonnable d en douter. 3°. On peut difcerner
ai(ément
,qua~d
le témoignage des
flns
eí!: douteux ,
par les reflexlOns que nous marquerons.
1°.
Lesfens
rapportent toujours fidellement ce qui
leur paroit ; la chofe eí!: manifefie , pu ifque ce font
des fucultés naturelles qui agiílent par l'imprc fliOIl
néceíTaire des objets ,
a
laquelle le rapport des
fens :
0 ,
'
















