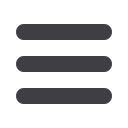
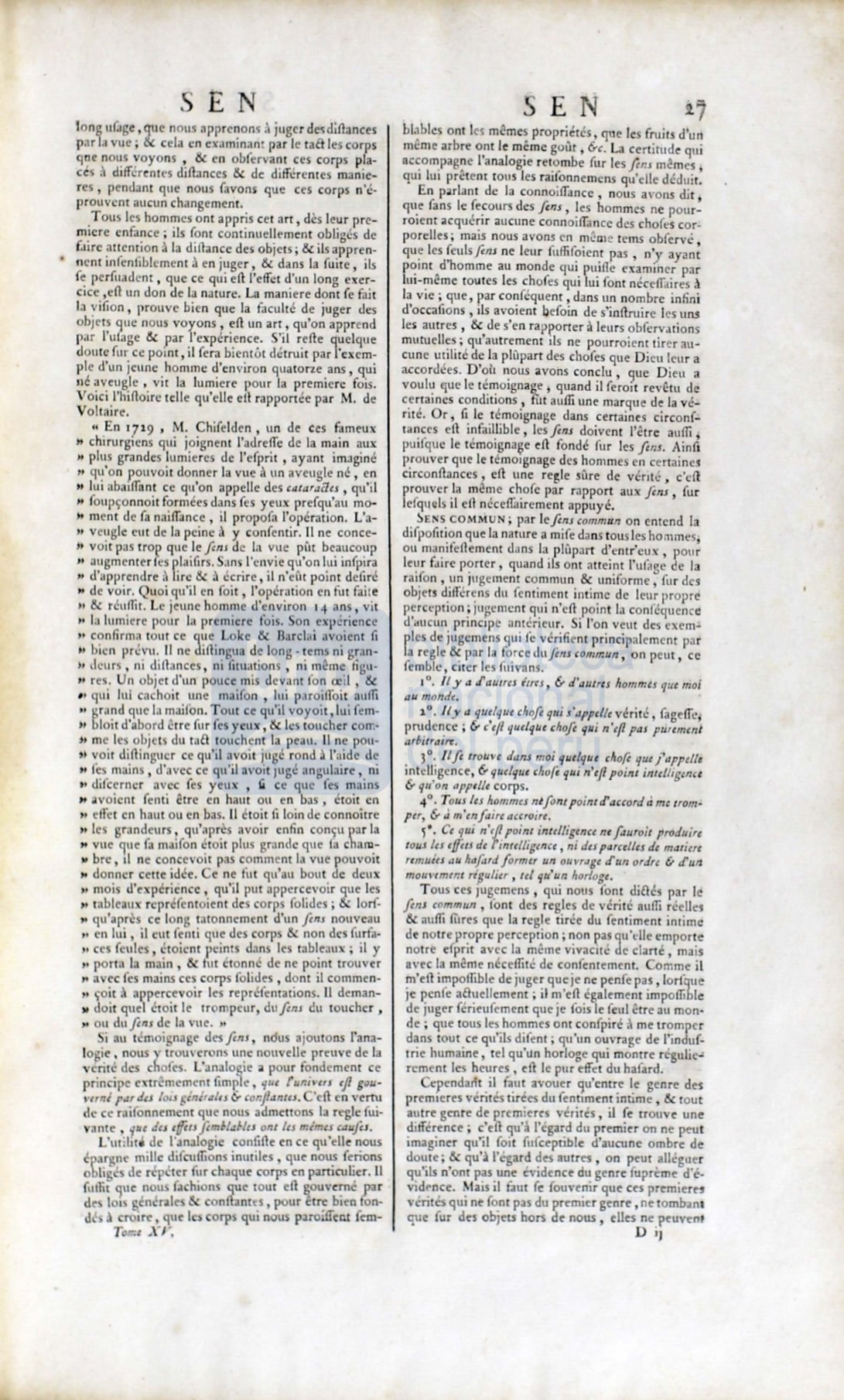
E
long uf.lge,
qu<!
nou
~pprcnon5 ~
jugcr
de~dla3nces
par
la
vue;
&
cela en examinan par le ta les corps
qae nous voyons ,
&
en obferva01 ces corp pla–
cé , différen[('s diltanccs
&
de dilfére01es manie–
res, penda01 que nous (avon que ces corps n
'é–
prou vcnt :lucun changemcnt.
Tous les hommes 001 appris Ce[ 3rt, d
S
leur pre–
miere en(ance ; il (ont eo01inuell('mcn[ obligés de
f.lire auemion la diOance des obje[ ;
&
il appren–
nen[ in (cn{iblcmc01
~
en juger ,
&
dans la (ui[e, ils
(e
pcr(uad~nt
, que ce qui en I'e!fe[ d'un long )Cer-
ice ,en un don de la natu re.
La
maniere do01 {e jt
la
vilion , prouve bi n que la facul[é de juger des
bjc[s que nous voyons en un ar[ , qu'on apprend
p.lrI'u(; ge
&
par I'cxp ricnce. 'il rene quelque
dOllle
(111
ce pOlm, il {era bie01ó[ dé[rui[ par I'cxem–
pie d'un jcune homme d'cO\liron qU3tOne ans qui
né
aveuglc , Vil la lumiere pour la premierc fois.
Voici I'hinoire [elle qu'elle eH
rappon~e
par
M.
de
Voltairc.
.. En
[719 , M.
Chi(elden, un de ces fameux
" ch,rurg,cns qui joigne01 I'adreffe de la mai n aux
" plus grande lumiere de I'c{pri[ , aya01 imaginé
, qu'on pouvoi[ donner la vue
a
un aveugle nc! , en
" lui abal ffa01 ce qu'on appelle des
CillaraatS
,
qu'iI
"
(oup~onnoi[
formée dans (¡
yeux pre(qu'3u mo-
.. ment de
fa
naiffanee , il propo(a I'opéra[ion. L'a-
.. vcugle eu t de la peine y eon{entir,
11
ne conce-
,. voit pas
[ro~
que le
flns
de la vue prH beaucoup
" augmenter tes plaili rs. Jn I'ellvie qu'on lui in(pira
" d'apprendre. lire
& :\
écrire, il n'el\[ point deliré
" de voir. uoi qu'il en (oi[ • I'op ra[ion en
111
faite
1>
'
r u/Tit. Le jeune homme d'environ 14 ans , Vil
.. la
hllniere pour In premierc foi. on e perience
.. confirma
10111
ce que Loke
&
Barclai avoien[ /i
j,
bien prevu.
11
ne difiingua de long - tems ni gran–
".Icm ,ni dinanccs , ni Ii[ui\[ions , ni
m~me
¡¡gu–
ti
re . n objel d'un pouce mis dcvant fon il,
&
" qui luí
a
hoit une mai(on, lui paroilloit aufli
JI
grand que la mrufon. Tou[ ce qu'il oyoi[ ,Iui fem–
). bloit d' bord [re fur fe yeu ,
&
le [oucher com–
j .
me le objet du
lUél
[ollchent la peau.
11
ne pou–
)1
oi[ diningucr ce qu'il a oit jllg rond I'"ide de
.. {es
main ,d'avee ce qu'il avoit )ugé angulaire, ni
)' dilcerner ave fe yeu.· . ¡¡ ce que fe mai ns
" \'oiem fenti I!lre en hallt ou en bas
[oi[ en
ti
elTe[ en halll ou en bas.
11
toi[ /i loin de conno\[re
). le grandeur , ql1'aprcs avoir enfin
con~u
par la
,. vue 9ue la m i(on c;[oi[ plu grande que fa charu–
.. brc II nc conee oi[ pas comme01
1,
vue POUVOil
" donncr ccue id e.
e
ne
tin
qu'uu bom de dcux
"moi d'e 'p rienee qu'il put apperccvoir que les
.. table3ux rcpr rentoient de orp tolide ; , 10rC–
.. qu'aprc; ce I ng [3[onncment d'un
flns
nOIlVe~l1
.. en
lui
a
cut rCllli que de corp
non de {urta–
• ce
(~ule
':[oient peint dans le rablcaux' il
, POrt,1 la m3in
hit
Ctonnc de ne poim [rou r
;¡
ec te mains ce corp (¡ lide , don[ il commen–
, I/oit. apper evoir le repréfema[ion.
11
deman–
" doit quel étoit le [r mpcur du
flns
du tou h r
, ou
dufons
de la \'ue. ..
i au lémoi. nage de
flns
nóu ajou[on l'ana–
logie ,nOU5 • [r
11
\'er
n unl! nouvelJe preu e de I
" 'me de
(i.
'JnJlo&ie ;¡ p ur fondement e
prin ipe
e :tr
memen[ timple: ,
'l/U
ur.;vt/J
<JI
CilU–
,'1m fllr
da
/01 ¡;.ln¿'ll/ts
6-
Oflj1anltJ,
'n
l
n
\'e~
de
c: miro nnement que nou ldmeuons la
r~¡;le
U1-
,'a nte ,
j_'
Ji
t
tU
fiml-!,.I-/cs ont
ItJ
mtr.usCJ
tju,
'¡lIal[ de l"analogic: online en e qu'elle nO\lS
~ J~nc
millc: di!' IIli n inmile ,que nO\lS (erions
h ' de r ' ter filr h que orp en p;miculier.
11
uHit
~uc
n u
J
ni n que tOut en uveme p;! r
de I I g ncr.lle';' nflJnt s, pour ilu'e bi n fon-
d
-ire , que I orp qui n
u~
puoilli
nt
fem-
ro
--:1 .\
r,
E
l'
blablc5 ont 1<.'5 m mes propriél s q e le frui[ d'un
m Ole arbre Ont le méme goih •
6-c.
La
certitude qlú
accompagne I'analogie re[ombc (ur les
flr.s
m2m s
qui lui pré[em [OU5 les raifonnemcns qu'elle d dui[,
En p rlan[ de la connoiffancc , nous 3vons dit.
que (an le (ecour de
flns
les homm ne pou r–
roient acquérir 3UCllne connoiffance
d
's cho(es cor–
porelle ; mais nous avons en
'!I~D1e
[cms ob(ervé ,
qu~
les ;<,uls
flns
ne leur
!iIIliC~>reOl
pas , n' ayant
p~lnt
d homme au monde qUI. pu.ille exammer par
hll-meme tou[es les hoCes qUI IUI foOl néceffdires
~
la vil' ; que,
r.arcon(¡ que01 , dans un nombre infin i
d'occa/ion
lis
IIvoien[ befoin de s'inllruire les
UIU
les aUlres ,
&
de s'en rapponer leurs obCcrva[ion
mutuell ; qu'autrement lis ne pourroient [irer au·
cune mililé de la plOpart des chofes que D ieu Icur a
accordo.:es. D'ou nOIlS ;¡vons conclu , qlle Dieu a
voulu que le [émoignage • quand il (eroil re tu d
cenaine condi[ions , HIt au lli une marque de la ve–
rilé. r,
Ii
le témoignage dans certrune circonf.:.
lances en infaillible , le
flns
doivent I aire au/Ti ,
puifque le [émoignase en fondé Cur les
flr¡j.
Ainft
prouver que le lémolgnage des homme n cen aine
circonnances • en une regle sure de vérné , c'en
prouver la meme chofe par rapport aux
flns ,
(ur
le(ql\els il en néceffairemeOl appuyé.
!> E
o
1/1IU ;
par
lefons commun
on eOlend (
di{pO(lIion que la nature a mife dans tous les hommes
ou manifellemen[ dans la pll'par[ d'eOlr'cux , pour
leu r fdire porter quand ils on[ ;llIei nt I'u{age de la
raifon , un jugelllent commun
&
uniforme, (ur d
s
objel5 difii!ren du (emiment intime de leur propre
percl'plion; jupement qui n'en point la conféquence
d'~ucun
princ'pe aOlcrieur. ¡ I'on veur des exem–
pie de jugemens qui fe vérifient principalemen par
la regle
&
par la force du
fins commun,
on peUl , ce
(emble c¡ter le fuivans.
10.
!l
ya d'aulfts
tun
6-
d'l1utrts hommes 'lUt mol
au mondé.
lo
o.
fI
a '1lulqUt drofo 'lit; s'l1ppdle
véritc , (ageffe¡
pnldence ;
6-
c'tfl '1ud'ltu chofo '1ui n'tfl pas pÚICfmnl
arb;tra;,...
3
o,
/1 fo trouve daM moi '1utlque cho{t que
J
I1pptllc
inteUigence,
6-
'1utl'lue e/1O{t '1ui n'tJl po;nl inu/licen
e
6-
'1u'on I1pptllt
corps.
4
0
•
Tous
les
Irommu nlfont point d'accord
a
me trom–
ptr
~
ti
m'tnfoirt accroirt.
5·.
t
'1
ui n'tjI poinl ;nul/igtnct m fauroil ¡Jrodll;re
IOUS les eU((s dt frnttll;gtn t, ni des pared/u dt maliue
"mula aU hafard formtr un OIlVT<1Ce d'un ordu
{/
d'uII
moUl'tmtnl "pul;u
,
ul
'111'
un horloge.
Tous ces )ugemens • qlú nous {onl
diélé
par le
flns commlffl
tont des regles de v rilé nu/Ti rcelles
&
3ulli ures que la regle
ur~e
du fen[iment inlime
de no[re proprc percep[ion; non
~as
qu\·Ue emporte
no[re c{prit a cc la meme vivacllé de clan ,mais
avec la m2me n ceflité de con(entement, omme il
m'ell imponible de juger que je ne pen(e pas lortqu
je peo(e a uellement; il m'ell gBlement impo/Tible
de juger ferieuCement que je ois le (cul t!tre au mon–
de; que 10U le hommes 001 confpir , me trompcr
dan t Ul
e
qu'iLs di(en[ ; qu\1O ouvrage de I'induf–
[rie humaine [el qu'un horloge qui montre rcguLi
rement le heures, ellle pur elfel du haf: rd.
'pendarlt il faut avouer <¡u entre le eore des
premlcres" 'ri[ \irées dulenllment intime
[out
autre genre de prcmierc verites
il
(e trou e une
drffi
rence; c'en qu' I'egard du premier on ne peut
imaginer qu'il (011 (ufceptlble d'aucune ombre de
dou[; qu';} l'egard
d~
autres on peut alleguer
qu'iLs n'on[ pas une
~'idence
du genre upreme d'é–
"idrnce, Mal$ iI
U[
(e ou\'enir que ces premiere,
" .ri[és qw ne (on[ pas du premier genre ne [ombant
qu
ur des ObjClS hors de nous
\les nc peuvent
D
J)
















