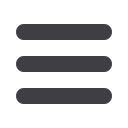
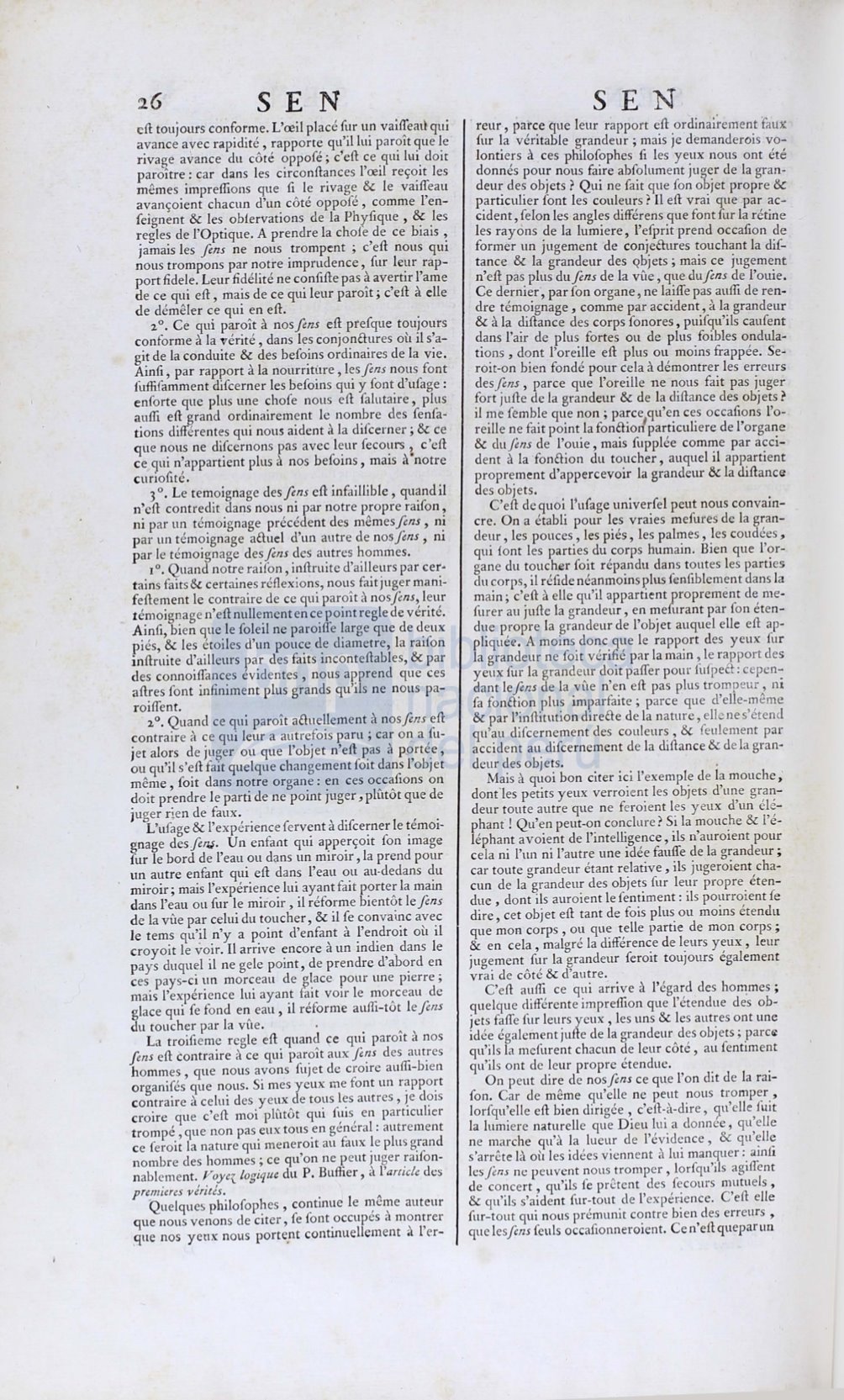
S E N
dI:
toujours conforme. L'ceil placé (ur un vailfeatl qui
avance ayec rapidité , rapporte qu'illui paroit que le
rivage avance du coté oppo(é; c'eft ce qui hti doit
paroltre: car dans les circonftances I'ceil re<foit les
memes impreffions que
íi
le rivage
&
le vailfeau
avan<foient chacun d'un coté oppo(é, comme l'en–
(eignent
&
les obiervations de la Phylique ,
&
les
regles de l'Optique. A prendre la chofe de ce biais ,
jamais les
fens
ne nous trompent ; c'efl: nous qui
nous trompons par notre imprudence, (ur leur rap–
port fidele. Leur fidélité ne conlifl:e pas
a
avertir I'ame
de ce qui efl:, mais de ce qui leur paroit; c'efl: ;\ elle
de démeler ce qui en
efl:.
2°.
Ce qui parolt
a
nosfens
eft pre(que toujours
conforme
a
la vérité , dans les conjonéhlres Olt il s'a–
git de la conduite
&
des be(oins ordinaires de la vie.
Ainli, par rapport
a
la nourritüre , les
fens
nous font
fuffi(amment difcerner les be(oins qui y font d'u(age :
enCorte que plus une chofe nous eft (alutaire, plus
auffi eft grand ordinairement le nombre des fenCa–
tions différentes qui nous aident
a
la diCcerner;
&
ce
que nous ne diCcernons pas avec leur (ecours, c'e{l:
ce qui n'appartient plus
a
nos be(oins , mais
a'
notre
curioíité.
3°,
Le temoignage des
fens
efl: infaillible, quandil
n'c{l: contredit dans noas ni par notre propre rauon,
ni par un témoignage précédent des
memesfens, ni
par un témoignage aél:uel d'un autre de
nosfens ,
ni
par le témoignage des
fens
des autres hommes.
l°.
Quand notre rai(on, infl:ruite d'ailleurs par cer'
tains faits
&
certaines réflexions, nous fait juger mani–
fefl:emenr le contraire de ce qui parolt a nos
fens,
leur
témoignage n'efl: nullement en ce point regle de vérité.
Ainli, bien que le (oleil ne paroiífe large que de deux
p iés,
&
les étoiles d'un pouce de diametre, la raiCon
in1l:ruite d'ailleurs par des faits incontefl:ables,
&
par
des connoiífances evidentes, nous apprend que ces
afl:res font innnimenr plus grands qu'ils ne nous pa–
roiífent.
2°.
Quand ce qui paroit aél:uellement a
nosfem
efl:
contraire a ce qui leur a autrefois partl ; car on a Cu–
jet
alors de juger ou que I'objet n'eíl: pas
a
portée,
ou qu'il
s'efl:
fait quelque changement (oit dans I'objet
meme, (oit dans notre organe : en ces occalions on
doir prendre le parti de ne point juger , plutot que de
juger rien de faux.
L'u(age
&
l'expérience Cervent
a
di(cerner le témoi–
gnage des
fin.¡.
Un enfa nt qui apper<foit (on imag€
fur le bord de l'eau ou dans un miroir, la prend pour
un autre enfant qui eft dans l'eau ou au·dedans dll
miroir; mais I'expérience lui ayant fait porter la main
dans l'eau Oll (ur le miroir , il réforme bientot le
fens
de la vue par celui du toucher ,
&
il (e conva,nc avec
le tems qll'il n'y a point d'enfant
a
I'endroit
011
il
croyoit le voir. II arrive encore
a
un indien dans le
pays duquel il ne gele point, de prendre d'abord en
ces pays-ci un morceau de O"lace pour une pierre;
mais I'expérience lui ayant fui t voir le morceall de
glace qui (e fond en eau , il réforme auffi-tor le
fens
du toucher par la vfte.
.
La troilieme regle eft quand ce qui parolt a nos
fens
eíl: contraire a ce qui parolt aux
flns
des amres
hommes, que nous avons (uj et de croire auffi-bien
organi(és que nous. Si mes yeux me font un
r~ppo~t
conrraire ;\ celui des y eux de tous [es autres , le dOls
croire que c'eíl: moi plLlror qui Cuis en particulier
t rompé , que non pas eux tous .en général : autrement
ce Ceroit la nature qui menerOlt au faux le plus g.rand
nombre des hommes ; ce qu'on ne peur Juger ralfon–
nablement.
Voye{ logi'lue
du P. Buffier, a l'
anide
des
.
,.
,
prenueres ventes.
Quelques philo(oph es , continue le meme auteur
que nous venons de citer, (e (oot occupés
a
monrrer
.que nos yenx nmls
porte.ntcontinuellement a ¡'er-
S E N
renr , parce que [eur rapport efl:
ordinai~ement
faúx
(ur la véritable grandeur; maís je demanderois vo–
lontiers
a
ces philo(ophes
li
les yeux nous ont été
donnés pour nous faire ab(olument juO"er de la gran–
deu~ de~
objets ? QlU ne (ait que (on objet propre
&
p.arUC\Úler (ont les couleurs? Il eíl: vrai que par ac–
cldent, (elon les angles différens que font (ur la rétine
les rayons de la lumiere, l'e(prit prend occalion de
former un jugement de conjeél:ures touchant la di(–
tance
&
la grandeur des Qbjets ; mais ce jugement
n'eíl: pas plus
dufens
de la vlte, que
dufens
de l'ouie.
Ce dernier, par (on organe, ne laiífe pas auffi de ren–
dre témoignage , comme par accident ,
a
la grandelLr
&
a
la diíl:ance des corps fonores, pui(qu'ils cauCent
dans I'air de plus fortes ou de plus foibles ondula–
tions , dont l'oreille eíl: plus ou moins frappée. Se–
roit·on bien fondé pour cela
a
démontrer les erreurs
desfens,
paree que l'oreille l1e nous fait pas juger
fort juíl:e de la grandeur
&
de la difiance des objets?
il me (emble que non; paree qu'en ces oceafions
1'0-
reille ne fai t point la fonél:iorlpartÍclúíere de l'organe
&
duJens
de I'ouíe, mais fupplée comme par aeci–
dent
a
la fonél:ion du toucher, auquel il appartient
proprement d'appercevoir la grandeur
&
la diíl:ance
des objets.
C'eíl: de quoi l'uCage llniver(e! peut nous convain–
ere.
00
a établi pour les vraies mefutes de la gran–
deur, les pouces , les piés, les palmes, les coudées ,
qui {ont les parries du corps humain. Bien que 1'0r–
gane du toucher (oit répandu dans toutes les parries
du corps, il rélide néanmoins plus (ef.lliblement dans la
main; c'eíl:
a
elle qu'il apparrient proprement de me–
furer au juíl:e la grandeur , en me(urant par (on éten–
due propre la grandeur de l'objet auquel elle eíl: ap–
pliqué~.
A moins donc que le rapport des yeux (ur
la grandeur ne (oit vérifié par la main , le rapport des
yeux (ur la grandenr doit pa{fer pou r (u(peél: : cepen–
dant
leflns
de la vlle n'en eíl: pas plus trompeur , ni
(a fonél:ion plus imparfaite; paree que d'elle-meme
&
par l'infiitution direél:e de la nature, ellcnes'étend
qu'au diCcernement des couleurs,
&
(eulement par
accident au di(cernement de la difiance
&
de la gran-
deur des obj ets.
.
Mais
a
quoi bon citer ici l'exemple de la mouche;
dont"les petits yeux verroient les objets d'une gran–
deur tome autre que ne feroient les y eux d'un élé–
phant! Qu'en peut-on conclure ? Si la mouehe
&
l'é–
léphant avoient de l'intelligence, ils n'auroient pour
cela ni l'un ni l'autre une idée faulfe de la grandeur ;
car toute O"randeur étant relative, ils jugeroient cha–
cun de la"grandeur des objets (ur leur propre éten–
due, dont ils auroient le (entiment : ils pourroient fe
dire, cet objet efi tant de fois plus ou moins étendll
que mOA corps , ou que telle partie de mon corps;
&
en cela, malgré la différence de leurs yeux, leur
jugement (ur la grandeur (eroit toujOlLrS également
vrai de coté
&
d'autre.
C'eíl: auffi ce qui arrive a l'égard des hOl1"!mes ;
quelqu e rlifférente impreffion que l'étendue des ob–
jets fa{fe (ur leurs yeux , les uns
&
les alltres ont une
idée également juite de la grandeur des objets; pare",
qu'i ls la me(urent chacun de leur coté, au fentiment
qu'ils ont de leur propre étendue.
On peut dire de
nosfens
ce que l'on dit de la rai–
(on. Car de meme qu'elle ne peut nous tromper,
lor(qu'elle eíl: bien dirigée , c'eíl:·a-dire, 9u'elle (uit
la lumiere naturelle que Dieu lui a donn ee, qu'elle
ne marche qu'a la lueur de l'évideoce ,
&
qu'elle
s'arrete la Otl les idées viennent
a
lui manquer: ainfi
les
fens
ne peuvent nous tromper , lor(qu'ils agilfent
de concert , qu'ils (e pretent des (ecours mutuels ,
&
qll'ils s'aident (ur-tout de l'expér.ience. C'eíl: elle
fur-tout qui nous prémurut contre bien des erreurs ,
que
lesflns
(euls ocealionneroient. Cen'eíl:queparuu
















