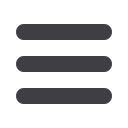
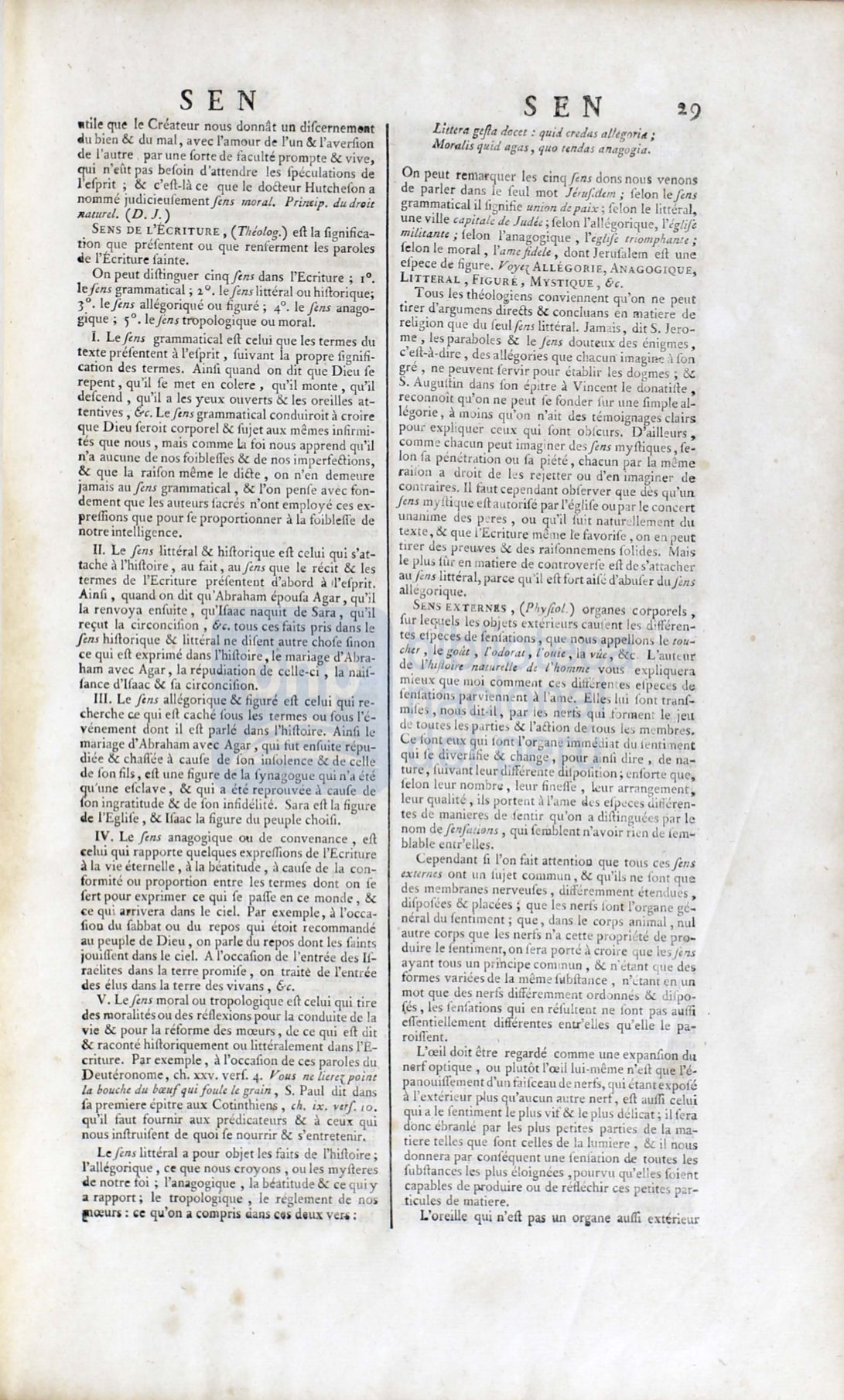
S EN
" tile que le Créateur nous donnat un di(cernem8l1t
«u bien
&
du mal, avec I'amour de I'un
&
I'averúon
de l'autTe par une (one de faculté prompte
&
vive,
qui n'ellt pas befoin d'attendre les fp culations de
l'e:fprit ;
&
c'efi-Ia ce que le doéleur Hutchefon a
nommé judicieufementfins
moral. Princip. du droÍl
Ralllrel.
(D . l .
)
SENS DE L'ÉCRITURE,
(Tlzlolog. )
efi la lignifica–
tion que préfenrenr Oll que renfe rment les paroles
ele
l'Écriture Cainte.
On peut difiinguer cinq
fins
dans l'Ecriture ;
1°.
lefens
grarnmatical ;
2
(J.
le
fins
linéral ou hit1orique;
3°. lefins
allégoriqué ou figuré; 4°. le
fins
anago–
gique; 5o. le
¡ens
tropologique ou moral.
1.
Le
fillS
grammatical efi celuí que les termes du
texte préfentent
¡\
l'eCprit, fuivane la propre lignifi–
carion des termes. Ainli quand on dit que D ieu fe
repent, qu
'il
fe met en colere:, qu'il monte , qu'il
de[cend , qll'il a Ie:s y eux ouverts
&
les oreilles at–
t entives,
&c.
Lefin s
grammatical condlliroit
a
croire
que DiclI feroit corporel
&
fujet aux mames infirmi –
tés que nous , mais comme
la
foi nOlls apprend qu'il
n'a aucune de nos foible/les
&
de nos imperfeélions,
&
que la raifon mame le diéle , on n'en demeure
jamais au
fins
grammatical ,
&
l'on pen(e avec fon–
dement que les aureurs lacrés n'ont employé ces ex–
prellions que pour fe proponionner
a
la foibldfe de
notre intelligence .
n.
Le
fins
littéral
&
hifiorique efi celui qui s'at–
tache
¡\
I'hifioire, au fait, aufins que
le
récit
&
les
termes de l'Ecriture préfentellt d'abord
a
¡I'efprit.
Ainli , quand on dit qu'Abraham époufa Agar, qu'il
la renvoya en(uite, qu'Ifaac naquit de Sara, qu'il
r es;ut la circoncilion ,
t;.c.
touS ces fairs pri dans le
fins
hifiorique
&
littéral ne difent autre chofe finon
ce qui efi exprimé dans l'hiHoire , le mariage d'Abra–
ham avec Agar , la répudiation de celle-ci , la naif–
{ance d'[(aac
&
fa circoncilion.
m.
Le
¡<ns
allégorique
&
figuré efi celui qui re–
cherche ce qlli efi caché lous les termes ou fous I'é–
vénement dont il efi parlé dans 1'lUfioire. Ainfi le
mariage d'Abraham avec Agar , qui fut enCuite répu–
diée
&
chafi'ée a cauCe de Ion inlolence
&
de celle
de
Con
fils, efi une figure de la fyna gogue qui n'a été
qu'une efclave,
&
qui a été reprouvée a cauCe de
Con
ingratitude
&
de (on infidélité.
ara efi la figure
de l'EgliCe ,
&
ICaac la figure du peuple ch(}ifi.
IV. Le
fins
anagogique Otl de convenance.' efi
ce
hu
qui rapporte quelques exprellions de l'Ecnrure
a
la vie éternelle ,
11
la béatitude ,
a
cauCe de la con–
formité ou proportion entre les termes dont on (e
Cert pour exprimer ce qui fe palfe en ce monde,
&
ce qui aHivera dans le
cielo
Par exemple ,
a
I'occa–
fioD du (abbat ou du cepos qui étoit recommandé
au peuple de DiclI, on parle du repos dont le raines
jouiíI'cnt dans le cielo A
l'o~ca(¡on
de I:enerée ,de
lr–
raélites dans la terre proml(e , on traite de I ntree
des élus dans la terre des vivans,
&c.
V.
Lefins
moral ou tropologique efi celui qui ti re
des moralités ou des réflexions pour la conduite de la
vie
&
pour la réforme des mreurs, de ce qlU efi dit
&
raconté hifioriquement Olllittéralement dans I'E–
criture. Par excmple,
11
l'occJlion de ces paroles du
D elltéronome:, ch.
n.'v.
verr. 4.
Y ous
fIt
li'''(poinl
la.
bouc¡'. dll hallf
'l"i
[ollt.legrain
,
.
Paul dit dans
fa premiere
épit~e
allX
Co~in.thiens,
ch. ix.
v.if.
10:
qll'il faut foumlr aux .pr
dicate~tr5 ~
a ceux. qlU
nous infulllCent de quol (e oouenr
&
s entreterur.
Le
fi
ns
lin ral a pour objet les faits de l'hi11:oire;
l'allégorique, ce que n?us ro ons
~
oules
myfie~es
de: notre foi ; I'anagoglque , la béautude
&
ce qUl
y
a rappon; le tropologlque, le r 'glement de no
~reurs
; ce qu'on a compris
Q
n e
s
deu;
v
r.:
SEN
liuera
gifla dom
..
qllid cred'ls aLlegoritt;
Moralis quid agas,
'1"0
,endas anagogia.
On peut remarque\' les
cinqfins
dons nouGvenol1S
de parler dans le (eul mot
}érllj.dcm ;
lelon
lefins
gramr:natical il lignifie
ufllon d. paix;
(clon le littéral,
une vllle
capita/~
d. llldé.;
(elon l'allégorique,
I'¿glije
militante;
(elon I'anagogique ,
I'.gb¡e
lriomphafllt ;
felon le moral,
l'anzcJideü ,
dont Jeru[alem efi une
erpece de figure.
Yoye{
AllÉGORIE, ANAGOGIQUE,
LlTTERAl, FIGURÉ, MYSTIQUE,
t;.c.
. Tous les théologiens eonvi ennent qu'on ne peut
ttrer d'argumens direéh
&
concluans en matiere de
religion que du (eul
fens
littéral. Jamais , dit S.
Jero~
me , les paraboles
&
le
¡ ens
domeux des énigllles ,
c'efi-a-dire , des allégories que chacun' imagip.c ·\ (on
gré , ne peuvent
Cervir
pour établir les dogmes ;
,
S. Augultin dans (on ¿pirre
a
Vincent le donatifie ,
reconnoit qu'on ne peut Ce fonder fuI' une fi mple al–
légorie,
11
m ins qu'on n'ait des téllloigl1ages clairs:
pOU\' expltquer ceux qui (one obfcurs. D'ailleurs,
cOlllme chacul1 peut imaginer de
fins
my fiiqu es ,
Ce–
Ion (a pénétrdtiol1 ou
Ca
piété , chacun par la ml!me
rai/on a droit de leS rejetter ou d'en imaginer de
contraires.
11
timt cependant obCerver que des qu'uo
¡ms
I~yfiiquc
efiautoriCé par I'égli(e Ol! par le concert
1I11al11me des pcres , ou
~u'il
luir naturellemene da
texte ,
&
que l'Ecriture mellle le favori(e ,on en peut
tirer des preu.ves
de raifonnemens Colides. Mais
le plu
me
en matiere de conrrover(c efi de s'at achel'
au./tns
linéral, paree qu'il efi fort aifé d'almCer dll
I
ns
allégorique.
SE
EXTl!RNRS,
(PI'.yjiol.)
organes corporels,
fur lequels les obj ets extérieurs caufe ne les d'fféren–
tes elpeces de fenfations , que nou appellon
le
COI/–
elle,
>
le
{JOÚl
,
[ odoral,
(OIÚt ,
la
"ú. ,
&c L'autellr
de
l'lu/toi,..
naulrtllt
d,
!'/¡omlTlt
vous expliquera
mieux que moi comment ces dif!"' rentes efpec s de
Cenfations parviennent
a
I'ame. Elle lui Cont tranC–
mlfes ,nou dit·il, par le nerfs qui
f
rlnent le jeu
de tolltes les partie>
&
I'aélion de tous les membres.
Ce lont eux qui font l'or ane immédiat du fenti nent
qui (e divedifie
&
change , pOllr amli dire , de na–
[Ure , (uivant leur dilférente dilpolition; en(orte que,
(elon leur nombra , lem fincfle , Icm arrangement .
leur qualit ' , ils portent
a
I'ame
Q
s
e(p~ce
i/leren–
tes de manieres de fentir qu'on a ditlingllécs par le
nom
definfat'ons ,
qui Cerublcnr n'a oir rien de {em- '
blable n r'elles.
Cependant fi I'on fai t atteneioD que tollS ces
fills
.XUfI/'S
ont un liljet COI lmun ,
&
qu'ils nc (ont que
des membranes nerveuCes , di¡féremment étenducs
>
diCpofées
&
placées ; que le nert;; fon t I'organe gé–
néral du (entimene
j
que, dal1s le corps animal, nul
aurre corp que les nerfs n'a cette propriété de pro–
duire le (entimenr, on fera porté
¡\
croire ue
lesjens
ayant tous un principe commun ,
&
n'~tant
que des
formes variées de la m me (\tofiance, n'ctane cn un
mot que des nerfs différemmene ord nnes
&
diCpo–
(és , les fenfations qui en rélilltent ne (ont pas auffi
efi'entiellcmene différentes entr'elle qu'elle le pa–
roille nt.
L'reil doit etre regardé comme une expanfion dll
nirf optique , ou plutot I'reillui-meme n efi que I'é–
panouifi'ement d'ull faiCceau de nerls, qui étane expo(é
a
I'extérieur plus qu'aucun alltre nerf, efi aulli celui
qui a le Centiment le plus vif
&
le plus délicat; il Cera
donc ébral1lé par les plu p tites parties de la ma–
tiere telles que (Ont celles de la lumiere ,
&
il OOtlS
donnera par con(équent une fen(ation de toutes les
fubfianccs I
plus éloianées ,pourvu qu'elle Coient
eapables de produire
O~I
de rdlechir ce
etites pzr–
ticules de matiere.
L'oreille qui n'en pas un or ane a\lffi extérieur
















