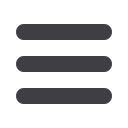
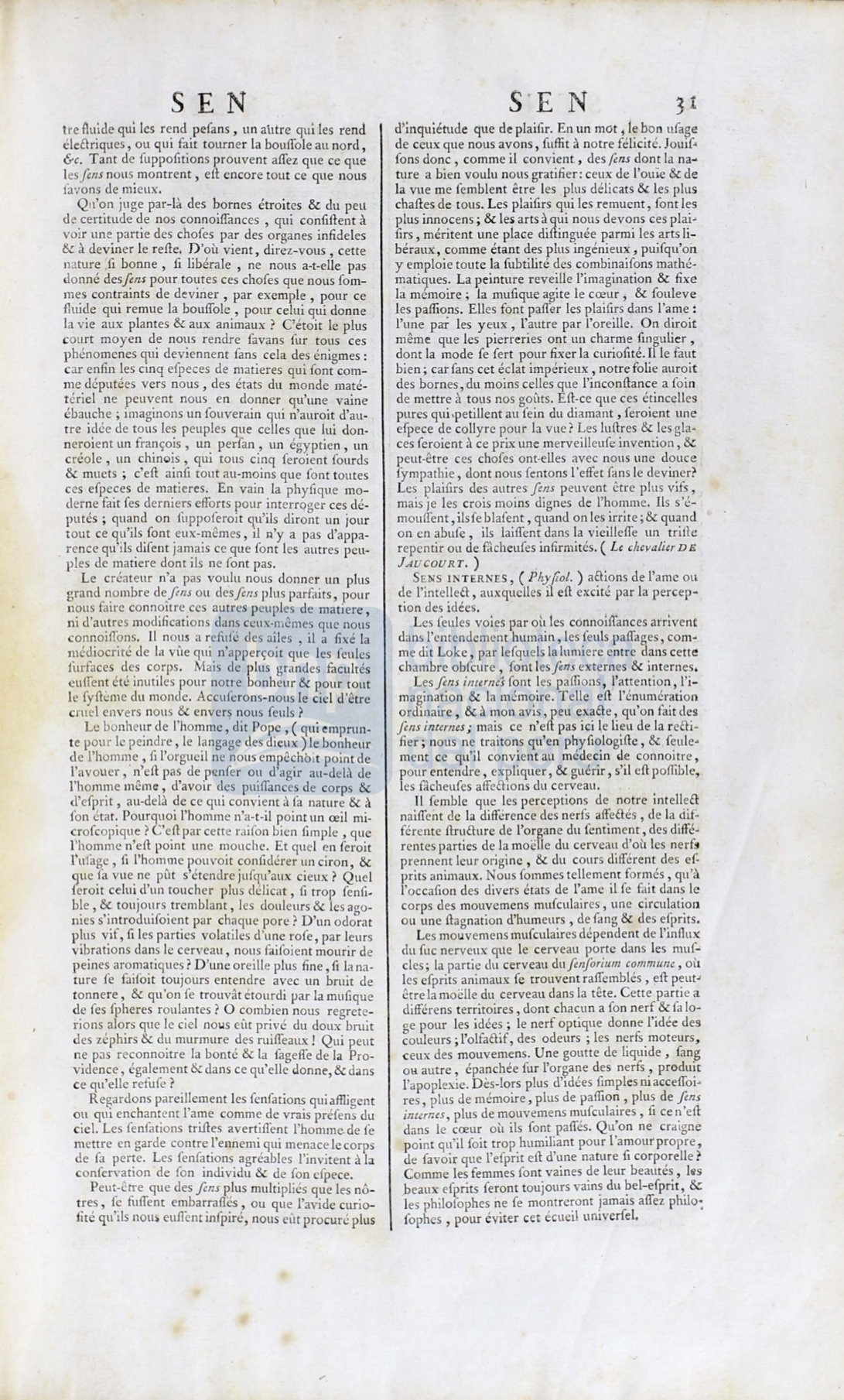
S E N
tre Auide qui
les
rend pe(ans, un ahtre qui les rend
éleétriques, ou qui faie tourner la boulrole an nord,
&c.
Tane de (uppofitions prouvent aífez que ce que
les/ms nous momrent, ell: encore tout ce que nous
favons de mieux.
Qn'on juge par-lit des bornes étroites
&
du peu
de.certitude
~e
nos connoilrances , qui confill:ent
á
vOlr une parne des cho(es par des organes infideles
&;\
deviner le rell:e. ])'0[1viem, direz-vous cette
nature .fi bonne,
Jj
libérale , ne nous a-t-eUe pas
onné
desflns
pour tomes ces cho(es que nous (om–
m~s cont~aints
de deviner , par exemple , pour ce
fhude qm remue la bouífole , pour celui qlÚ donne
la vie aux plantes
&
aux animaux ? C'étoit le plus
court moyen de nous rendre (avans (ur tous ces
]>hénomenes qui deviennent (ans cela des énigmes :
car en/1n les cmq e(peces de matieres qui (om com–
me députées vers nous , des états du monde maté–
tériel ne peuvent nous en donner qu'une vaine
'bauche ; imaginons un (ouverain qui n'auroit d'au–
tre
i~lée
de tous
le~
peuples que celles ,que
!tú
don–
nerOlent un
fran~Ols,
un per(an, un eayptien un
créole , un chinois, qui tous cinq
(er~ient (o~rds
&
muets ; c'ell: ainú tout au-moins que (ont toutes
ces e(peces de matieres. En vain la phyfiqu.e mo–
derne fa it (es derniers efforts pour intcrroger ces dé–
putés ; quand on fuppo(eroi t qu'ils diront un ¡our
tout ce
~u'ils
(ont eux-memes , il A'y a pas d'appa-
. r ence qu ils di(ent jamais ce que (ont les alttres peu–
pIes de matiere dont ils ne (om paso
Le créatenr n'a pas vouln nous donner un plus
grand
~ombre
de,flns
ou
desflns
plus parfaits, pour
110US falre connoltre ces autres peuples de matiere
ni
d'a
~tr.esmodifications
da~~
ceux.!"emes que non;
connOlfions. II nous a refu/e des a¡[es , il a fixé la
1Il
diocrité de la vi'te qui
11'apper~oit
que les (eules
lillfaces des corps. Mais de plus grandes facultés
euífent été inutiles pour notl'e bonheur
&
pour tout
le
(yll:~l1le
du monde. Accu(erons-nous le ciel d 'erre
cruel envers nous
&
envers nous (euls
?
Le
bonhel~r
de l'homme; dit Pop.e , ( qui empnm–
te pour I pe1l1dre, le langage des dleux ) le bonheur
de
l'homn~e
,
fi
l'orgueil ne nous empechoit point de
l'avouer, n'ell: pas de pli:n(er ou d'agir au-delil de
l'homme meme, d'avoir des puilrances de corps
&
d'e(prit , au-dela de ce qui convient
a
(a nature
&
iI
fon étar. Pourquoi l'holllme n'a-t-il poimun reil mi–
cro(copique
?
C'ell: par cette rai(on bien fimple , que
l'homme n'e/1: point une mouche. Et quel en (eroit
l'u (age , fi l'homme pouvoit confidérer un ciron
&
que fa vue ne pttt s'étendre jU\<J,u'aux cieux? Quel
feroit celui d'un toucher plus delicat , fi trop (enfi–
ble ,
&
toujours tremblant , les douleurs
&
les ago-
11ies s'introdui(oient par chaque pore ? D'un odorat
plus vif, fi les parries volatiles d'une rore, par leurs
vibrations dans le cerveau, nous fai(oient mourir de
peines
aro~l~tique~?
D 'une orei\le plus fine, fi la na–
rure (e fal(o lt touJours entendre
avec
un bruit de
tonnere,
&
qu 'on (e trouvat étourdi par la mufique
de (es (¡>heres roulantes
?
O combien nous regrete–
l'ions alors que le ciel 1101lS eilt privé du doux bruit
es zéphirs
&
du murmure des ruilrealLx! Qui pellt
ne pa reconnoitre la bonré
&
la (agelre de la Pro–
videoce , également
&
dans ce qu'elle donne
&
dans
ce qu'elle refiJ(c ?
'
Regardons pareillemeot les (en(ations qui aRlicrent
ou qui enchantent l'ame eomme de vrnis pré(en" du
cielo Les fen¡;'llions trilles a ertiile nt l'homme. de le
mettre en garde contre I'ennemi qui menace lecorps
de (a perte. Les (en(arions agréables I'invitent
a
la
on[ervation de fon individu ' de (00 c(pece.
Peur-ctre que des
fi ns
plus multipliés que les no–
tre, '
(~
nllrent
en
~bar.ra/l~s,
ou que I avide curio–
fite qu,ls noui eunent m(plré, nous eut pro uré plus
S
E
N
d1inquiétude que de plai(U". En un mOt
j
le bon ufage
de eeux que nous avons, (uffit
iI
notre félicité. Joui(·
fo ns donc , comme il convient , des
(ens
dont la na–
ture a bien voulu nous gratifier: celIX de l'oule
&
de
la vue me femblent etre les plus délicats
&
les plus
chall:es de tous. Les plaifirs qui les remuent, (ont les
plus innoeens ;
&
les arts
a
qui nollS devons ces plai·
firs, méritent une plaae di/1:ingulÍe parmi les arts li–
bératIX, comme étant des plus ingénieux, pui(qu'on
y emploie toute la [ubtilité des combinai(ons mathé–
mati~ues.
La peinture reveille l'imaginarion
&
fixe
la memoire ; la muúque agite le creur,
&
[ouleve
les paffions. Elles font paner les plaifirs dans l'ame
!
l'une par les y eux , l'autre par l'oreille. On diroit
meme que les pierreries ont U1l charme úngulier ,
dont la mode [e [ert pour fixer la eurioúté. Ille faut
bien; car (ans cet éc1ar impérieux , notre folie auroit
des bornes , du moios celles que l'incon/l:ance a (oin
de mettre
iI
tous nos goitts. E/l:-ce que ces étincelles
pures qui,petillent au (ein du diamant , (eroient une
e(pece de collyre pour la vue? Les lu /l:res
&
les gla–
ces (eroient
a
ce prix une merveilleu(e invention,
&
peur-(:tre ces cho(es ont·elles avec nous une douce
fympathie, dont nous fentons I'effet (ans le deviner?
Les plai/irs des au tres
flns
peuvent etre plus vifs ,
mais je les crois moins dignes de I'homme. Ils s'é–
mouífent , ilsfe bla(ent , quand on les irrite;
&
quand
on en abu(e , ils lai/fent dans la vieillelre un tri/l:e
repentir ou de fficheu(es infirmités. (
Le , /zevalier
D E
JAUCOURT.
)
.
S EblS INTERNES, (
P/Zyfiol.
)
aétions de l'ame 01\
de [,intelleét , auxquclles il eíl excité par la percep–
tion des idées.
Les (eules voies par oh les connoilrances arrivenf
dans l'entendement humain, les (euls paífages , com"
me dit Loke , par le(quels la lumiere entre dans cette
chambre ob(cure , foot les
fins
externes
&
internes.
Les
flns
illlerne1
(ont les paffions , l'attention, l'i–
magination
&
la m ' moire. Telle e/l: l'émtmérarion
ordinaire,
&
a
lllon avis, peu exaéte, qu'on fait des
flns internes;
mais ce n'e/l: pas ici \e lieu de la reéti–
fier ; nous ne traitons qu'en phyfiologifre ,
&
feu le"
ment ce qu'i l convient au médeein de connoitre ,
pour entendre, expliquer,
&
guérir, s'il e/1: poffible
les facheu(es affeétions du cerveau.
TI (emble que les perceptions de notre inte\lea:
naiífent de la difference des nerfs affeétés, de la dif–
férente ll:ruéture de l'organe du [entiment , des diffé–
rentes parties de la moelle du cerveau d'otl les nerf3
prennent leur origine,
&
du cours différent des ef–
prits animaux. ous (ommes tellement formés , qu'a
l'occafion des divers états de l'ame il (e fai t dans le
corps des mouvemens mllfculaires , une circulation
ou une ll:agnation d'humeurs , de (ang
&
de e(prits.
Les mouvemens mu(culaires dépendent de ['jnflux
du [ue nerveux que le eerveau porte dans les mu(–
eles; la partie clu cerveau du
fill/oriufIl
COfllfllU1le,
oh
les e(prits animaux (e trouvent ralremblés , e/1: peut
J
erre la moelle du cerveau dans la tete. Cette partie a
différens territoires, dont chaeu n a (on nerf
&
(a lo–
ge pour les idées ; le nerf optjque donne I'idée des
couleurs; I'olfaétif , des odeurs ; les nerfs moteurs,
ceux des mouvemens. Une goutte de liquide, (ang
0\1 autre épanchée (ur
I'or~ane
des nerfs , produit
l'apoplexie. Des-lors plus d'ldées úmples
ni
acceífoi·
res, plus de mémoire , plus de
paffio~
, plus de
J:ns
interms
plus de mouvelllens mu(culalres , ú ce n ell:
dans le creur 011 ils font paífés. Qu'on ne craigne
poior qu'il [oit trop hurniliant pour l'amoul' propre,
de (avoir que l'e(prit e/1: d'une nature
Ú
corporelle ?
Comme les fernmes (ont vaines de leur beamés, liS
beaux e(prits (eronr tOUjOllTS
vain~
du
~el-e(prit,.
&
les philo(ophes ne fe montreronr ¡amals aífez
philo~
foph s , pour éviter c t éClleiluOlverfel.
















