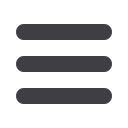
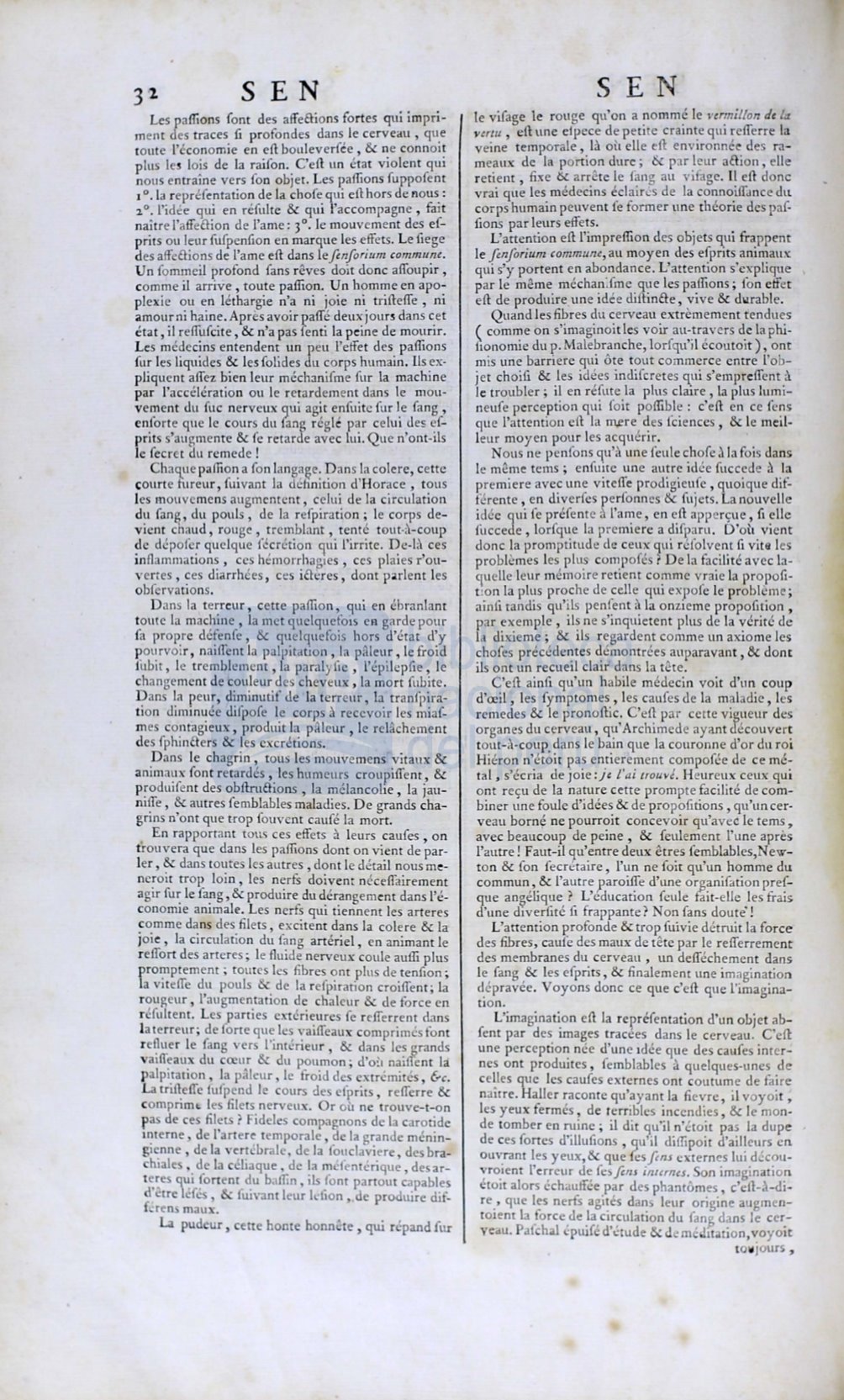
3
1
SEN
Les paaions fom des affeaions fortes qui impri–
ment des traces
fi
profondes dans le cerveau , que
toute I conomie en en bouleverfée ,
&
ne connoit
plll le! lois de la r.úfon. 'en un état violent qui
nous entralne vers foo objeto Les pallions fuppofem
) 0.
la repréfentation de la chofe quí e/l: hors de nous. :
:2.°.I'idee qui en réfulte
&
qui I'accompagne , falt
naitre I'affeaion de I'ame: 3°. le mouvement des ef–
príls ou leur fufpenúon en marque les elFets. Le fiege
des affi aion de I'ame en dans
lefinforiul1l COl1lmllnt.
n fommeil profond fans reyeS doit donc aIToupir ,
comme il arrive, tOUle pallion. Un homme en apo–
plexie ou en lélhargie n'a ni joie ni trineITe ,
ni
amourni haine. Apr ' s avoir paITé deuxjour5 dans cet
état, il reITufcite,
&
n'a pas fenti la peine de mourir.
Les médccins enten0ent un peu I'etfet des paffions
fur les liquides
&
les folides du corps humain, lis ex·
pliquem aITez. bien leur méch:mifme fur la machine
par I'accélération ou le retardement dans le mOIl–
vement du fuc nerveux qui agit enfuite fur le fang,
en(orte que le cours du fang réglé par celui
de~
ef–
prits s'augmeme
&
fe retarde avec lui. Que n'om-ils
le fecr t du remede!
haquepaffion a fon
langa~e.
Dans la colere, cette
courte hlreur, fuivant la d finition d'Horace , touS
le mouv mens augmcntcm, celui de la circulanon
du fang, du pouls, de la refpiration ; le corps de–
viem chaud, rouge , tremblant , tenté tOUl·a-coup
de dépofer quelque fécrétion qui I'irrite. De-la
ces
inflammations, ces hémorrhagtes , ces plaies r'ou–
venes , ces diarrh ' es , ces iaeres, dom parlent les
obf, rvations.
D ans la terrcur, cette pallion, qui en ébranlam
tollte la machíne , la mct qu Iquefois en garde pour
fa propre défenfe,
&
quelquefois hors d'état d'y
pourvoir, naíITem la palpitduon, la
p~leur
, le froid
Ji.lbit , le tremblemcnt la paralylie , I'épilepfie, le
changemem de couleur des cheveux , la mort fubite .
D ans la peur, diminutif de la terreur, la tranfpira–
tion diminuée difpofe le corps
a
recevoir les miaf–
mes contagieu.", prodlút la plllcur, le rcHi hemeot
des fphin ers
&
les e. crétions.
Dans le chagrin, tous les mouvemens vitaux
&
animaux font retardés , les humcur croupiífent,
&
produjft nt des ob/l::ruaíons , la mélancolie, la jau–
njITe,
&
autres femblables maladies. De grands cha–
grins n'om que trop fouv m caufé la mOrt.
n rapportant tom es effets
a
leurs caufes, on
trouvera que dans les pallions dom on viem de par–
ler, 'dan lOute I auu'es, dom le d ' tail nous me–
neroíl trOp loin, les nerfs doívem n ceITairemem
agír fur le fang,
&
produíre du dérangemem dans I'é–
conomíe anímale. Les
ner~
qui liennem les arteres
comme dans des lilets , excítem dans la colere
&
la
joíe, la circularíon du fang anériel en anímam le
re/fon des aneres' le fluide nerveux
~oule
auffi plus
prO~lptement
. tOUlCS I libre om plu de tenfton;
la lteITe du pouls
de la refpirarion croi/fem '
la
rou~eur,
I'augmentatíon de chaleur 'de forc: en
r titltent. Les partie extérieur fe rcíferrem dans
la lerrem; de (orle que les vaiífeaux comprimés fom
re~uer
le fang ver I'int.!rieu r
&
dans les grands
alífeaux du reur
r
du poumon ' d'o!1 naiífent la
palpitanon la paleur le froid d
xtrémilés
&c.
tr~e/fe
1ufpend I cours de fprils re/ferre
&
compnmt. le lilels nervelLX. rOl! ne Irouve-t-o n
pas
de ce lileLS? Fídel compagnon de
la
carotide
lIlterne de l'anere temporale de la grande m nin–
si
nne de la
"en
Ibrale, de la fouclavíere de bra-
hial
de la .maque , de la mct'emcrique desar-
t~re
qui Conent
~u
ballin, ils !om panout pables
Ir ,Ier, , . (w\-a.ntleur IlIon de produire
dií:
ene home honn ' le)
qui
r'
and [ur
SEN
le vifage le rouge qu'on a nommé le
l'ennillon de
la
verw
e/l: une elpece de peti e crainte qui reITerre la
ein; tempoTale la Oll elle e/l: environné des ra–
meatL" de la portion dure ;
&
par leur aaion ell
retiem ,
Ii~e
&
arr te le fang au vilage. 11 en donc
vrai que les médecins clair':s de la connoilT,lnc dll
corps humain pellvent
Ce
former une th orie de I a(.
fions par leurs effels.
L'attention e/l: I'imprellion des objets qui frappenr
le
ftnJorium communt,
au moyen des efprits animau.'C
qui
s'y
portent en abondance. L'attention s'cxplique
par le meme méchan:fme que les pallions; 10 n etfet
n de produire une idée di/l:inae, vive
&
d\lrable.
Qlland
les
libre du cerveau extrememem tcndues
( comme on s'imaginoitles
voir
all-traver de la phi–
Í1onomie du p. lalebranche, lorfqu'il écoutoit), ont
mis une barriere qui ote tout commerce entre I'ob–
jet choiú
&
le idées indifcretes qtÚs'empre:ITent
¡\
le: Iroubler; il en r ' fute la plus daire, la plus lumi–
neufe pe:rception qui foit pollible: c'en en ce fens
que I'attention en la m.ere des (dences ,
&
le meil–
leur moyen pou r les aequérir,
ous ne pen(ons qu'a une feule chofe
11
la fois dans
le meme tems; enCuite une autre idée [uceede
¡\
la
premiere avec une víreITe prodigieufe , quoique dif–
férente, en diver[e perfonnes
&
fu jets. La nouvelle
idée qui fe préfente
a
I'ame, en en apperc;ue, fi elle
fllccede, lorfque la premie re a difparu. O'oll vient
donc la promptitude de ceux qui r ' folvem
íi
vite les
problemes les plus compofés. De la facilité avec la–
quelle leur mémoire rerient comme vraie la propofi–
l!on la plus proche de celle qtti ex pofe le problcme;
ainli randi qu'ils penfent
11
la onúeme propofition ,
par exemple, il ne s'inquíetent plus de la vérité de
1,1
dixieme;
&
ils regardent comme un axiome les
chofes précédentes démomrées auparavant ,
&
dont
iIs om un recueíl clair dans la t te,
'en ainfi qu'un habile médecin voit d'un eoup
d'reil, les fymptomes, les caufes de la maladie, les
remedes
&
le prono/l:ic. C'e/l: par cette vigueur des
organes du cerveau, qu'Archim de ayant découvert
tout-a-coup. dans le bain que la couronne d'or du roí
Hiéron n'étoit pas enríerement compofée de ce mé–
tal, s'écria de ¡oie:
jo l'aí
trouvé.
Heureux ceux qui
ont re/fu de la nature cette prompte facilité de com–
biner une fouJe d'idées
&
de propofitions ,qu'un cer–
veau
born~
ne pourroit concevoir qu'avcc le tems,
avec beaucoup de peine,
&
(eulement l'une apres
I'autre! Fam-i1 9u'entre deux etreS femblablcs, ew–
ton
&
fon fecrcraire , I'un ne foir qu un homme du
commun,
&
I'autre paroiífe d'une organjfation pref–
que
an~élique?
L'éducation (eule fait-elle les frais
d'une dlverfité ti rappante? on fans dome'!
L attention profonde
&
trop fuivie détruit la force
des
libres, cau{; des maux de tete par le refferrement
des membranes du cerveau , un detréchement dans
le fang
&
les efprits,
&
linalement une imagination
d.épravée. oyons donc ce que
c'ea
que l'imagina-
1I0 n,
L'imagination e/l: la repréfentation d'un objet ab–
Cem par des images tracées dans le cerveau. C'e/l:
une perception née d'une Idée que des caufes inter–
nes om produites, femblables
a
quelques-unes d
celles que les caufes externes o nt Coutume de faire
nailre. Haller racome qu'ayam la lievre, il voyoit,
les yeux fermés de terribles incendies ,
&
le mon–
de tomber en ruine ; il dit qu'il n't':toit pas la dupe
de
ces
fones d'iUuúons , qu'íl dillipoit d'ailleurs en
OU\;am les yeux, que fes
fins
externes lui d 'cou–
vrOlem I erreur de fes
JW.l
internes.
on imagination
toir alors échau/fi'e par des phantomes e' /l:-a-<li–
re.. que les neru agit 's dan leur origine augmen–
tOlent
la
orce de
la
circulation du fan dans le cer–
yeau. al' ha! :puiC,' d\!Nde' m
lt
lion,voyoit
rOlflours ,
















