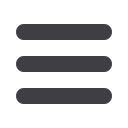
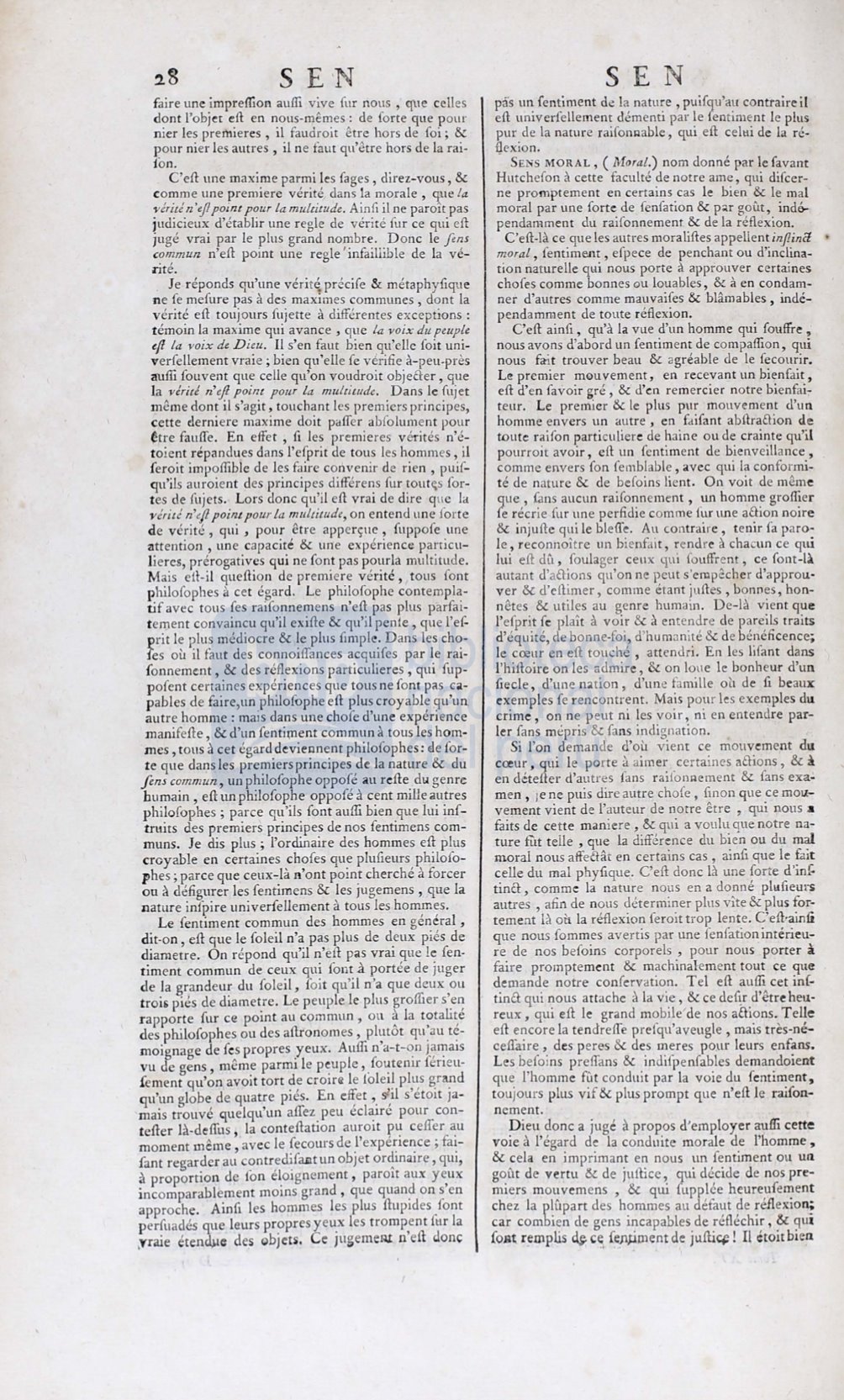
faire une impreffioR auíli vive (ur nous , q\le celles
dont I'obje[ eíl: en nous-m&mes: de forte que pour
nier les premieres , il faud roit etre hors de (oi;
&
pour nier les alltreS , il ne fau[ qu'etre hors de la rai–
Ion.
C'efr une maxime parmi les (ages, direz-vous,
&
comme une premiere vérité, dans la morale , 9;ue
la
,,¿ridn'ejIpoint pour la multitude.
Ainfi il ne paroH pas
judicieux d'établir une regle de véri[é (ur ce qui eíl:
jugé vrai par le plus grand nombre. D onc le
fins
commun
n'eíl: point une regle /infaillible de la vé–
rité.
Je réponds qu'une
vérit~
préci(e
&
métaphyfique
n e (e me(ure pas
11
des maximes eommunes , dont la
vérité eíl: toujQurs fujette
a
différentes exceptions :
t émoin la maxime qui avance, que
la voix du peuple
ejl la voix
d.
D iw.
11 s'en fam bien qu'elle (oit uni–
verfellement vraie; bien qu'elle (e vérifie a-peu-pres
a\lili {ollvent que eelle qu'on voudroit objeaer, que
la
virúi n'ejl poim pour la multiwdc.
Dans le (ujet
meme dont il s'agit, touchant les premiers principes,
cette derniere maxime doit pa{[er ab(olument pour
~rre
fauíI'e . En elfer , fi les premieres vérités n'é–
toient répandues dans l'efprit de tous les hommes , il
feroir impoffible de les faire convenir de rien , pui{–
Cju'ils auroient des principes dilférens {ur
rout~s
{or–
tes de {ujets. Lors donc qu'il efr vrai de dire que la
"érité n'efl poiru pour la fnlllútude,
on entend une (orte
de vériré, qui , pour etre
apper~l1e,
{uppo{e une
attention , une capacité
&
une expérience parricu–
lieres, prérogatives qui ne font pas pourla multitude.
Mais eH-il queíl:ion de premiere vérité, tous {ont
philo(ophes
a
cet égard. Le philo{ophe contempla–
tif avec touS (es rai(onnemens n'eíl: pas plus parfai–
teI1)ent convaincu qu'il exiíl:e
&
qu'il penie , que l'e{–
prit le plus médiocre
&
le plus fimple. Dans les cho–
fes ou il faut des connoiíI'ances acqui{es par le rai–
fonnement,
&
des réflexions particulieres , qui {up–
po{ent certaines expériences que tous ne {ont pas ca–
pables de faire,un philo(Qphe eíl: plus croyable qu'un
autre homme : mais dans une chofe d'une expéri ence
manifefre,
&
d'un {enti(l1ent commun
a
tous les hom–
mes, touS a cet égard devieonent philo(ophes: ee for–
te que dans les premiersprincipes de la nature
&
du
fins commun,
un philofophe oppofé au refre du genre
humain, efr un philofophe oppofé a cent mille autres
philo(ophes; parce qu'ils (ont auiIi bien que lui in{–
tnlÍts des premiers principes de nos fentimens com–
muns. Je dis plus; l'ordinaire des hommes eíl: plus
croyable en certaines chofes que plufieurs
philo{o–
phes; parce que ceux-lil n'ont point cherché a forcer
on
a
défigurer les {entimens
&
les jugemens , que la
nature in{pire univerfellement a tous les hornmes.
Le fentiment commun des homrnes en général ,
dit-on, efr que le foleil n'a pas plus de deux piés de
diametre. On répond qu'il n'ea pas vrai qHe
le
{en–
timent commun de ceux qui font
a
portée de juger
de la grandeur du foleil, foit
qu'il
n'a que deux Otl
troi6 piés de
diamet.re. Le peuple le plus gronier
s'.e~
rapporte fur ce p01l1t au cornmun, on a la [otalite
des philofophes ou des afrronomes,
pl~ltOt
qu:au
t~moignage de fes propres 'yeux. Auíli n
a-H~n J~~als
vu de gens, meme parrnlle
p~uple, . fo~temr
{i
n eu–
fement qu'on avoit toft de
CrOlnl
le tole!l plus grand
qu'un globe de quatre piés. En effet '. slil s'étoit ja–
mais trouvé quelqu'un alfez peu écJ¡uré pour con–
tefrer la-deíI'us
la
contefration auroit pu ce1fer au
moment mame' avec le (ecours de l'expérience ; fui–
fant regarder
a~ ontr~~f3lilt
un objet
or~nai re ,
qui,
a
proportion de (on eloJgnement , paron aux yeux
incomparablement moins grand , que quan? on s'en
approche. Ain{¡ les hommes les plus ftupldes {Ont
perfuadés que leurs propresyell:" les trompent (ur la
,vraie étenc4te des Qbjets. Ce JugemeIU
n'ea
done
SE N
p3S un fentiment de la nature , puiCqu'au contraire il
eíl: univer(ellement démenti par le (entiment le plus
pur de la nature
rai(ol1l~able,
qui eíl: celtli de la ré–
flexiono
- SE -S MORAL, (
Moral.)
nom donné par le favant
Hutche(on
11
cette faculté de notre ame, qui di(cer–
ne promptement en certains cas le bien
&
le mal
moral par une {orte de (en(ation
&
p;¡r gota, ind6.–
pendamment du rai(onnement
&
de la réflexion.
C'eíl:-la ce que les autJ'es moraliíl:es appellent
injlinél
moral,
{entiment, e(pece de penchant ou d'inclina–
rion naturelle qlÚ nous porte
a
approuver certaines
cho(es comme bonnes ou louables,
&
a
en condam–
ner d'autres comme mauvai(es
&
blamables, indé–
pendamment de toute réflexion.
C'eft ainfi, qu'a la vue d'un homme qui (oulfre ..
nous avons d'abord un Centiment de compaffion, qlÜ
nous fa-it trouver beau
&
agréable de le (ecomir.
LI! premier mou vement, en recevant un bienfait,
efr d'en {avoir gré,
&
d'en remercier notre bienfai–
teur. Le premier
&
le plus pur mouvement d'un
homme envers un autre , en fai{ant abaraaion de
toute rai{on particuliere de haine ou de crainte qu'il
pourroi[ avoir, eíl: un (entiment de bienveillance ,
comme envers {on (emblable , avec qui la conformi–
té de nature
&
de befoins liento On voit de meme
que, fans aucun rai(onnement, un hornme groiIier
{e récrie {ur une perfidie comme fur une aaion noire
&
injuíl:e qui le bleíI'e. Au contraire, teoir (a paro–
le, reconnoltre un bienfait, rendre a chacun ce
<¡tú
lui efr dtl, {oulager ceux qui (oulfrent, ce (ont-Ia
autant d'aaions qu'on ne peut s'erupecher d'approu–
ver
&
d'efrimer , comme étant juíl:es, bonnes, hon–
netes
&
utiles au genre humain. De-la vient que
I'e{prit {e pla!t a voir
&
a entendre de pareils traits
d'équité, de bonne-foi, d'humanité
&
de bénéficence;
le creur en eft touché , attendri_ En les li(ant dans
l'hifroire on les admire,
&
on loue le bonheur d'un
fieele, d'une n¡¡tion, d'une famille oh de
fi
beaux
exemples {e rencontrent. Mais pour les exemples da
crime, on ne peut ni les voir, ni en entendre par–
ler fans mépris
&
fans indignation.
Si I'on demande d'Oll vient ce mouvement
du
cceur, qlli le porte
a
aimer certaines <la ions,
&
a
en détefier d'autres fans raifon Rcment
&
fans exa–
men , le ne puis dire autre chofe , fi non que ce moa–
vement vient de I'autcur de notre etre , qui nous a
faits de eette maniere,
&
qui a voulu que notre na–
ture
fttt
telle , que la dilférence du bi en ou du
mal
moral nous alfetHIt en certains cas, ainfi que le fait
celle du mal phyfiql1e. C'eíl: donc la une (orte d'inf.
tina, comme la nature nous en a dooné pl1i{ieurs
auu'es , afin de nous déterminer plus vlte
&
plus for–
tement la ou la réflexion (eroit trop lente. C'efr,ainli
que nOllS fommes avertis par une (en(ationintériell–
re de nos be(oins corporels , pour nous porter
a
faire promptement
&
machinalement tout ce que
demande notre con(ervation. Tel efi auffi cet in(–
tina qlli nous attache a la vie ,
&
ce
de~r
d'erre hell–
reux , qui efr le grand mobile'de nos aaioos. T elle
efr encor e la tendre{[e prefqu'aveugle , mais tres-né–
cefiaire, des peres
&
des meres
po.urleurs enfans.
Les be(oins pre{[ans
&
indi{pen(ables demandoient
que l'homme
fUt
conduit par la voie du (entiment,
roujours plus vif
&
plus prompt que n'eíl: le raifon–
nement.
D iel1 done a jl1gé
a
propos d'employer autli cette
voie
11
l'égard de la conduite morale de I'homme,
&
cela en imprimant en nous un fentiment
Ol!
un
goftt de vertu
&
de juíbce , qui décide de nos pre–
miers mouvemens ,
&
qui fuppl ée heureufement
chez la plupart des hommes au défam de réflexion;
car combien de gens incapables de réfléchir ,
&
qui
íO.Qtremplis
el$;
e~. (~POlent
de
juili~!
Il
~toit
bien
















