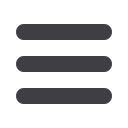
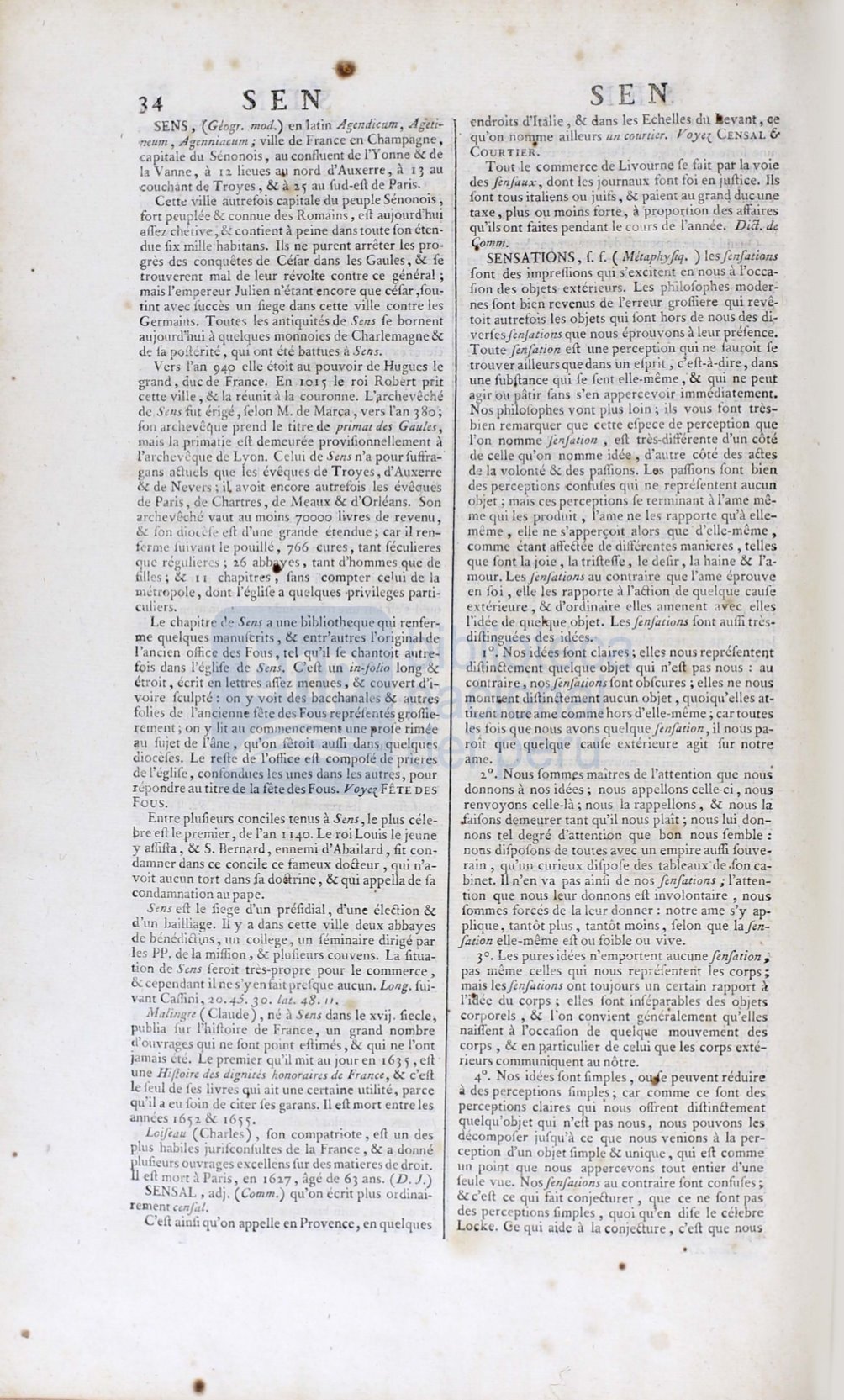
34
SEN
SENS,
(Gl.ogr. mod.)
en latill
Agendicam,
Aglli–
,
reum , Agennia,um ;
ville de France en Champagne •
capitale du Sénonois, au confluent de I'Yonne
&
de
la Vanne ,
a
r:t
licues
341
nord d'Auxerre,
a
13 au
oCouchánt de Troyes ,
&
a
2.
5
au (ud-ell: de París.
ettt: ville autrefois capirale du peuple Sénonois ,
fon pcuplée
&
connue des Romains, ell: aujomd'hui
elfe1. chétive, r conrient
a
peine dan
s
toute (on éten–
due fix mille habitans. lis ne purent arreter les pro–
gres des conquetes de Cé(ar dans les Gaules,
&
fe
erOllverent mal de le,ur révolte contre ce général;
mais l'empereur Julien n'étant encore que
cé(ar
,cou–
tint avec {ucces un fiege dans cette ville contre les
Germaills. Tomes les antiquités de
Sens
fe bornellt
aujollrd'hlli
a
quelques mOllnoies de Charlemagne
&
de fa po!l:érit ' , qui ont été battues
a
Sens.
Vers l'an
940
elle étóit au pouvoir de Hugues le
grand, dllc de France. En
10
15
le roi Robén prie
ceete ville ,
&
la réunit
a
la COllronne. L'¡¡rcheveché
de
S."s
fut érigé, (elon
M.
de Marca, vers l'an
380 ;
fon archev(!que prend le titre de
primal des Gallles,
mais la pri matie ell: demell rée provifionneHement
a
l'archevcque de Lyon. Celui de
Sens
n'a pourfufFra- '
gans atl:lIels que les éveqll cs de Troyes, d'AlIxerre
&
de Nevers;
il
avoie encore autrefois les éveolles
de Paris, de Chartres , de
M
eaux
&
d'Orléans. Son
archeve hé vam au moins
70000
livres de reyenu,
&
fon diol '
(e
ell: d'une grande étendue; car il ren–
ferme lui vant le pouillé,
766
cures, tant (éculieres
que régulieres ;
2.6
abb¡yes , tant d'hommes que de
fill es ;
&
1 I
chapitres, (ans compter celui de la
1l1étr0pole , dont I'égl.ife a quelques .privileges parti-
culiers.
.
Le chapitre
( e
Sms
a une bibliothcque qui renfer–
me quelques manu(trits ,
&
entr'autres l'original de
1
'aneien office des Fous , tel qu'il (e chantoit alltre–
fois
dans l'égli(e de
s.ns.
C'ea un
in-folio
long
&
étroit , écrit en lettres aífe1. menues,
&
couvert d'i–
v-oire (culpté: on
y
voit des bacchana les
&
Hutres
folies de l'ancienne
f~te
des Fous repréfentés gr,offie–
rement ; on y lit all comlllencemem une pro(e rimée
au (ujet de l'ane , qu'on retoit aulTi dans quelgues
c!ioce(es. Le rell:e de l'oRice eil: comporé de prieres
de l'églifc, confondues les unes dans les autr<:s , pour
répondre au titre de la rete des Fous.
POYI!{
FETEDES
Fous.
Entre plufieurs conciles tenus a
s
ens,
le plus céle–
pre e le premier, de l'an
I 140.
Le roi Louis le jeu ne
y a!filia,
&
S. Bernard, ennemi d'Abailard, nt con–
damner dans ce concile ce fameux dotl:eur , qui n'a–
voit aucun tort dans fa dOlÍh'ine,
&
qui appella de (a
condamnation au pape.
.
Sms
ell: le iiege d'un préfidial, d'une életl:ion
&
d'un bailliage.
TI
ya dans cette ville deux abbayes
de
bén
éditl:i.ns, un college , un (éminaire dirigé par
l~s
PP.
de la miffion,
&
plufieurs couvens. La fitua–
Ilon
de
S,m
reroit
rr '
s-propre pour le comrnerce,
•cepcndam il ne s'y en fait pI' (que auclln.
Long.
fui–
v.;¡nt affini
20.4.5. 30'
[at,
48.
/l.
M,z!u¡gre
(
laude ), né
iI
Sens
da ns le xvij . fieele,
publia
{m
l'hifroire de France , un grand nombre
~l'oll~rages
qui ne (om point eftimés ,
&
qui ne l'ont
J311lalS été, Le premier qu'il mit au ¡om en
163
í ,
efr
un~
Hi(loi:e
d
s digllids honorairls
d.
Frallce ,
&
c'ell:
le
feu l de fes livre qui ait une certaine utilité , p31'ce
qu'i!
a
eu (oin de citer
(es
garans.
Il
ell: mort entre les
annees
16)2.
&
165) .
Loiflau
( Charles), (on compatriote elt un des
plus habiles juri(conlidtes de la France ,
&
a donné
pluG urs ouvrages excellens (m des matieres de droit.
II
ell: mort
a
Paris , en
162.7,
agé de
63
ans.
(D.
J.)
E
lSAL , adj.
(Cotnm .)
qu on écrit plus ordinai–
rCJ¡lenr
Ctnjat.
ell: ainfi qu on appeUe en Provenee, en quelques
endroit d'lrálie,
&
dans les EcheUes dll 1levant , ce
qu'on
n0m.meaiUcurs
un co/mi.r. Poye{
CENSAL
&
COURTlER.
Tout le commerce de Livourne fe fait par la voie
des
finJ;mx ,
dont les journaux font foi en juil:ice. Ils
font touS italiens ou juifs,
&
paiem au granq duc une
taxe, plus ou moins forte.,
a
propo(tion des afFaires
qu'ilsont faites pendant le cours de l'annee.
Dia,
de
CioTllm.
SENSATIONS,
f.
f.
(
Métaphy.fo¡.
)
les
flnJatiolls
(om des imprelTions qlIÍ
s~excitent
en nous
a
I'occa–
fion des objets extérieurs. Les philo(ophes moder;
nes {ont bien revenus de I'erreur grolTiere qui reve–
toit au trefois les oojets qui [ont hors de nous des di–
ver(esfinJalions
que nous
éprou~ons
a.leur pré(e.nce.
Toute
finJalion
elt une perceptlon
qll1
ne falu;olt fe
trouver ailleurs que dans un eíprit , c'elt-a-dire, dans
une (ubítance qlli fe (ent elle-meme ,-
&
9ui ne peut
agir ou píhir (ans s'en appercevoir immediatemenr.
Nos philotophes vont plus loin ; ils vous fo ?t tres–
bien remarquer que cette e(pece de perceptlOn q,ue
l'on nomme
jellJation
,
eíl: tres-ditférente d'u n coté
de celle qn'on nomme idée , d'antre coté des atl:es
de la volomé
&
des paffions. Los paRions (ont bien
des perceptions <:onfll(es qni ne repréfentent aucun
objet ; mais ces perceptions (e terminant a l'ame me–
me qui les produit , l'ame ne les rapporte qn'a elle–
meme, elle ne s'apperc;oit alors que d'elle-meme,
comme étant affetl:ée de ditT' rentes manieres, telles
que (ont la joie , la triíl:eíre, le defir , la haine
&
1'a–
mour.
LesJenJátions
au contrail'e que I'ame éprouve
en (oi , elle les rapporte
a
l'atl:ion de quelque caufe
extérieure ,
&
d'ordinaire elles amenent avec elles
l'idée de qndque objeto Les
flnfluiollS
font aulTi tres–
diftinguées des idées.'
1 0 .
Nos idées (ont claires ; elles nons repréfentellt
dill:intl:ement quelque objet qui n'ell: pas nous : au
contraire, nos
finfations
font ob(cnres ; elles ne nous
montl;ent diíl:intl:ement aucun objet , qnoiqll'elles at–
tirent notre ame comme hors d'elle-meme; cartoutes
les fois que nous avons quelque
fll/fatÍon,
il nous pa–
roit que quelque cau(e extérieure agit (ur notre
ame.
2.
0 .
Nous (omml!Smaltres de l'attennon que nous
donnons
;1
nos idées ; nous app Hons ceUe-ci , nous
renvoyons celle-la ; nous la rappellons,
&
nous
la
J'ai(ons demeurer tant qu'il nous plalt ; nous lui,don–
nons tel degré d'an cntion que bon nOllS (emble :
noos dirpo(ons de tomes avec un empire auffi (ouve–
rain, qu'lln cmi ux difpofe des tablcaux'de.(on ca–
binet.
II
n'en va pas ainii de nos
flnJauons
;
l'atten–
rion que nous leur donnons eft involontaire , nous
forom es forcés de la leur donner : notre ame s'y ap–
plique, tantot plus , tantot moins , (eIon que
lafin–
fluion
eUe-meme efr ou foible ou vive.
30.
Les pures idées n'emportent aucuneflnfation,'
pas meme ceHes qui nollS repr '(entent les corps;
mais
lesflnfa¡ions
Ont toujours un certain rapport
a
l'i~ée
du corps; elles (ont inféparables des o.bjets
corporels ,
&
l'on convient généialement qu'elles
naiffent
a
l'occafion de quelq\le mouvement des
corps ,
&
en p.articulier de celui que les corps exté–
rieurs communiquent au nOtre.
4°·
os idées (ont fimples ,Ol e peuvent réduire
;i¡
des perceptions fimples ; cal' comme ce (ont des
perce¡¡tions claires qui 'nous olFrent difrintl:emene
quelqu'obj et qui n'ell: pas nous, nOllS pouvons les
décompo(er ju(qu'a ce que nous venions a la per–
ception d'un obiet fimp le
&
unique , qui ell: comme
un poim que nous appercevons tout enrier d'une
(eule vue.
NosflnJalions
au contraire fom confu(es ;
&
c'ell: ce qui fajt conjefrurer, que ce ne (ont pas
des percepcions fimples , quoi qu'en di(e le célebre
Loe e. Ge qui aide 11
la
conjefrure, c'efr que nous
















