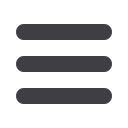
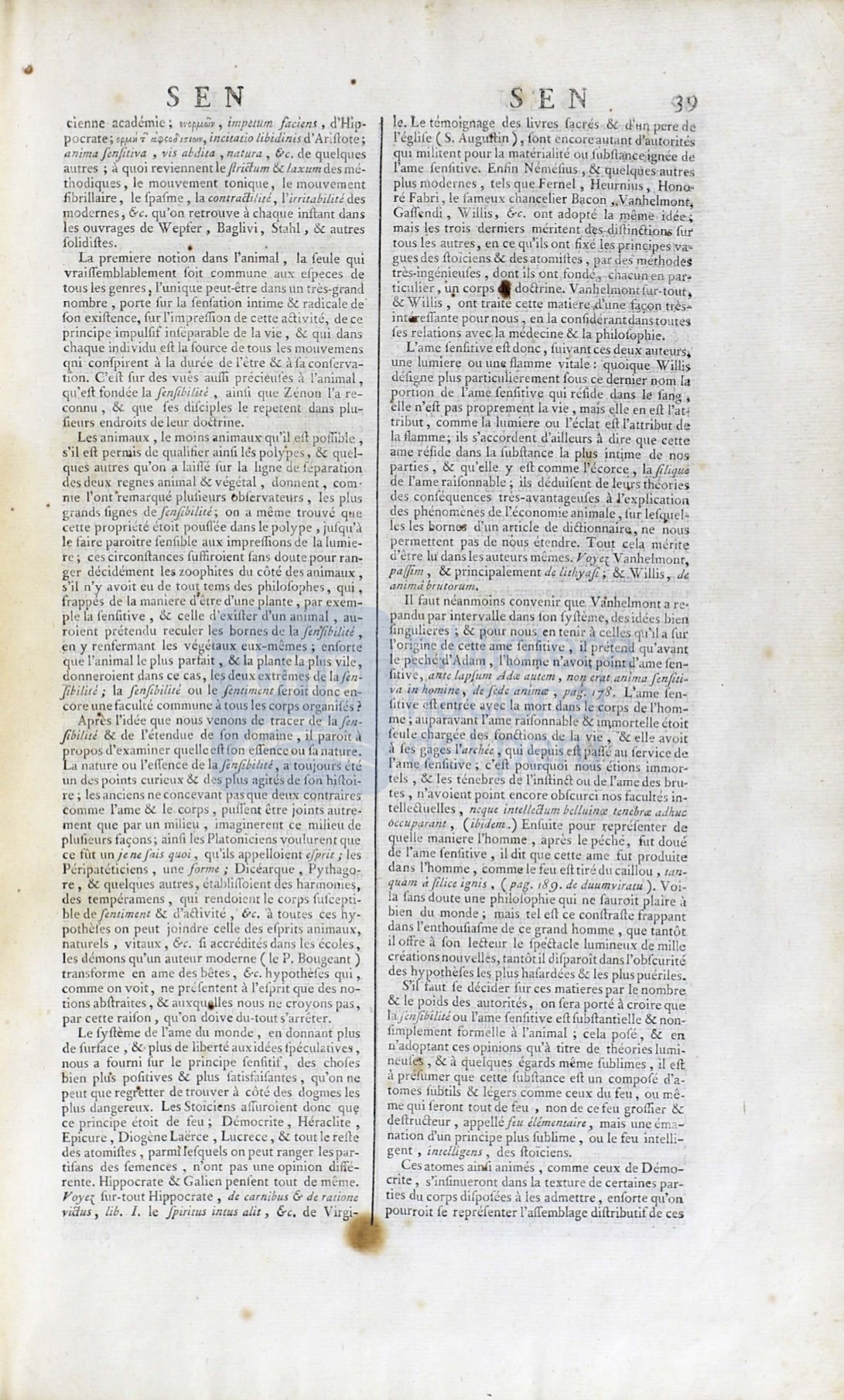
•
SEN
cienne académie;
••
ep¡.<¡;;v ,
impemm foeims
,
d~Hip
pocrate;
oPl-'~'; d~~OJ'l~lOJV,
incitatio lihidinis
d'Adl:ote;
anima fenjitiva
,
vis abdita ,natura, t/e.
ele quelques
autres ;
a
quoi
revielmentlejlriffum &laXllfll
des mé–
thodiques , le mouvement tonique, le mouvement
fibrillaire, le
fpafm~
, la
eonrraflilité ,
l'
irritahilitJ
des
modernes ,
&e.
qu'on retrouve achaque infiant dans
tes ouvrages de \Vepfer , Baglivi, Stahl,
&
autres
folidiíl:es.
•
.
La premiere notion dans I'animal, la feule qui
v raiífemblablement foit commune aux e(peces ele
tOlls les genres , I'un ique peut·etre danslln tres.granel
nombre, porte lin· la fenfation intime
&
radicale de·
fon exiíl:ence, fur I'impreffion ele cette aél:ivité, de ce
príncipe ímpulf1f iníeparable de la vie ,
&
qui dans
chaque indivielll efi la [out·ce de tous les Illouvemens
gní confpirent
a
la elurée de l'etre
&
¡\
fa conferva–
tíon. C'efi fur eles vues auffi précieuf"es
a
l'animal,
qu
'e.íl: fond ée la
fenjihitit¿ ,
ainli que Zénon l'a re–
connu ,
&
que fes elifciples le rel?etent dans plu–
fiellrs endroits de lem doéhine.
Les animaux, le moins anima\l)cqu'il efi po1Iible ,
s'il efi p erruls de qualifier ain/i les polypes ,
&
quel–
gues autres qu'on a laiífé fur la ltgne de fi!paration
des eleux regnes animal
&
végétal, donnent , com·
me l'ont'remarqué ptufieurs oblervatenrs , les plus
grands (¡gnes ele
felljibitilé;
on a meme trouvé qu e
cette propriété étoit pouífée dans le polype , jufqu'a
le faire paroltre fen(¡ble aux impreffions de la lumie–
re ; ces circoníl:ances fuffiroient fans dome pour ran–
ger décidémen t les zoophites du coté des allimaux ,
s'il n'y avoit eu de tout tems des philofophes , qui ,
frappés de la maniere d'etre d'une plante, par exem–
pIe la (en(¡tive ,
&
celle d'exiiler d'un animal, au–
roient prétendu reculer les bornes de la
ji:nJlhililé ,
~n
y
renfermant les véo-étaux eux-memes ; en(orte
que I'animalle plus parPait ,
&
la plante la plus vile,
donneroient dans ce cas, les deux ext¡;emes de la
/en–
]ibilit¿ ;
la
felljibilité
ou le
fentimenc
[el·oit donc en–
core une faculté commune
a
tous les corps erganifés ?
Apr''es l'idée que nous venons de tracer de la
fel/–
jibilit¿
&
de l'étendue de fon domaine , il paroJt
a
propos c!'examiner quclleeíl: fo n eífence ou fa nature.
La nature Oll l'eífence de
[ajenjibiLit¿ ,
a
tOlljoui·~
eté
un des points curieux
&
des plus agités de ron hifroi–
re; les anciens ne concevant pa,s que deux cqntraires
comme l'ame
&
le corps, puífent erre joints aurre–
ment que par un milieu, imaginerent ce milieu ele
plll(¡eurs fac;ons; ainíi les Platoniciens vouluren t qlle
ce ftlt
lInjeneJais quoi,
qll'ils appelloienr
eJfrie;
les
Péripatéticiens , une
/oflm
;
Dicéarque , Pythago-.
r e,
&
quelqllcs autres, étahli/foient des harmonies,
des tempéramens , qlli.
r~n,doient
le corps fufcepn–
ble
deji:ntim<nl
&
d'aél:1vtte ,.
Ve.
¡\
tolltes ces h)'–
pothHes on peut joindre celle des e(prits animaux,
naturels , vitaux,
&c.
íi accrédités dans les écoles ,
les démons qll'un auteur moderne ( le
P.
BOllgeant )'
transforme en ame des betes,
&e.
hypothefes qui,
comme on voit, ne préfentent
a
I'e/prit que des no–
tions abfiraires ,
&
allxqu¡¡lles nous nc croyons pas ,
par cette raifon, qu'on doive du-tour s'arreter.
Le fyileme de l'ame elu monde, en donnanf plus
de futface,
&.
plus de liberté auxidées !i)éculatives,
nous a fourni (ur le principe fen/itif, eles chofes
bien plu·s po(¡tives
&
plus fatisfuifantes, qu'on ne
peut que
regr~tter
de trouver
a
coté des dogmes les
plus dangereux. Les Stolciens a/furoient donc
qu~
ce principe étoit de feu; D émocrite, Héraclite ,
Epicure , Diog' ne Laerce , Lucrece,
&
tout le reile
des atomift€s , parmilefquels on peut ranger les par–
tifans des femences n'om pas une opinion diffé–
rente. Hippocrate
&
Galien penfent tour de meme.
Y oye{
Cur-tout Hippocrate ,
de carnihlls
&
de ratio11e
"if/IIS,
lih.
j,
le
fpirilllS imus alir,
&e.
de Virgi-
S 'E N
~9
1:;
t .e ttmoignage .des
üvr~~ f,!cr~s
&
&tI'l
pete
dé
l egh(e ( S. Aug1l1hn ) , font encore'autallt d'alltorités
qui militent pour la materialité ou,ftil>fi'1PJeJignée de
l'ame fenfitive. Enlin Nemé(¡us
, ~;t¡uelqliesrautres
plus niodernes, tels que F ernel
,Heurni~IS
Hona'
ré Fabril le
f~.m.eux
chancelier B(lc?,1l
,.\~¡H~~elmoht)
Galrend1, Wlllts,
&e.
ont ad0pte la w&mé
idé~
mais
-les
trois derniers méritent_
g~s.-;djítinél:~Qlló
Ctit
tous les alltr,es , en ce qu'ils ont fixé
J~~
pringipes-lva
g~es.
des,
~olciens
&
def atomifies , par des'
mé.rhodé~
t:es.mge~leu[es
, dont 115o nt .fondé(3. <;haGelH1-ftn par.
tlcuh.er.' uf! corps.
doéhin~. Vanhelmol)~.[li,r-tOUf)
~
;Vtllts , ont traIte
c~tte matiere.p:un,efu~o
tr.es-
1ntw eífante pour nous , en la conlidérantdans toures
fes relations avec la inédecine
&
la philo(op\lie,
L'ame. fen/itive eíl:donc , fuiyantcc§
d.~ux ~uteuts~'
u~e
lumlere ou
~IO~
.fl.i!mme v1tale: quojque \Yjlli$
de[l~e
plus
part1C\lller~ment fOl~~
ce qenlier I;lOn} la
portlOl1 de I'ame fep(¡tlve qui relide daos le' fano- )
el.len\ fi.pas prop.cepel
t
la vie , maÍs
.e.1ié
en efi
-l:~tf
trIbut, comme
la
.tu01iere on I'éclat ei,l: l'attribut,c!e
!~
fl.m,me.;
ils
s'accordent.~ai\leurs ~
dice que cette
ame ref¡cle dans l a fubfiance la plus intime de nos
partfes ,
&.
qu'elle y
~lr,c~m~e l'éf~.J;c·~
lc,./j1{g1l6
de l ame rmfonnable; lis dedu{fent de leLLrS thcories.
des cQnféquences ires:avantageu(es
a
l'e~pjjcation:
.des
phénome ne~
de
eé~~ nomie~n.i~a·re., (ur.1efq.u el ~
les les bornee d un arn.cfe de d1él:lOon,a1re, ne nous
permettent pas de nqus ércnclre. Tout cela méritfC
d'etre lu' dan·s lesauteurs melnes.
Yoy~{
'Yan helmo;1[
paf!i17~ ,
&
priocipalement
de
~it!V'~ ;'_~,Willis
,-,d;
antilla v'fltorurll.
n
fau t
n~anmoills
convenir que. VánhélrrlOnt a re–
~ana~
par llltervalle dans (on fyíl:éme, des iclées bien
fmguheres ;
&
[\our nous en tenit·
it
celles q\I'i1
a
fur
l'origine ele cette ame- fenlitive ,
i1
prétend
qu'avan~
!e pe ché'd'Ad3m, l'hOmr¡¡e n'avoit point d'ame fe n–
/itive,
ante lapJum Ad<2 alllC17l , no,? erál anIma fenjiti–
ya
illhomine j deFd. anímre , pago
'7.8.
J;'ame fen–
¡¡five éfi entrée avec la mort dans le corps de l'hom–
me; auparavant I'ame rai'fonnable
&
irr¡mortelle étoit
feul e chargée
d~s
fonél:ions de la vie
,~&
elle avoit
¡\
fes gages l'
areMe
,
qui depuis eíl; I;alle au fervice de
['ame fen/itive ; c'eíl: pourquoi nous' éí:ions immor–
tels ,
&
les ténebres de I'iníl:inél: Oll del'ame des bru–
t~s
, n'avoient point encore obfcllTci nos facultés in–
telletl uelles,
negue imelleall17l bell"illw lellelme adhuc
óccuparaht
'.
( ibidem. )
Enfuite pour ¡;epréfenter de
que!le mamen:
I'ho:n~e
, apres le péché, fut doué
de lame feníit1ve , 11 dlt que cette ame fu t prodllite
dans I'homme, c.omme le feu eH tiré dn caillou ,
lall–
qua",
ajilice
ignis , (pag.
,89.
de dllumviralIl
).
Voi-
1¡¡
/ans dome une philoíophie qui ne fauroit plai're
¡'¡
b1en du .monde ; malS tel eil ce coníl:rafre frappant
dans.l'enthou(¡afme de ,ce granel homme , que tantor
ti
oll:re
a
fon leél:eur le fpeél:acle Lumineux de mille
créations nouvelles, tantatil difparolt dalls I'obfcurité
des ,hypo.rhi:fes
!e~
Blus haCardées
&
les plus puériles_
S
ti
fa.llt fe dec1der fur ces matieres par le nombre
&
,~e
po}ds, des ,aut?rités , . on (era porté
a
croire que
laJm.fihlltte
ou 1ame fen/inve efi (ubfiantielle
&
non~
ftmplem·enr formelle
a
l'animal ; cela po(é,
&
en
o'adQPlant ces opinions qu'a titre de théorieslumi–
~eul~
,
&
a
cjuelques égards mÍ!me fublimes , il
e!l:
a prelumer que cette fubfiance efi un compoCé d'a–
tomes.
f~l[)tils
&
légers éomme ceux du feu, ou me–
me ql1l leronr tout de feu , non de ce feu gro/lier
&
de~ruél:~ur
,
a.pp~lléfill
¿l"m.ntuir. )
mais un.e éma–
nanon d un pnnclpe plus fubhme, oule fen IOlelli–
gent ,
Íntelligens,
des fio·iciens.
.Ces atomes ainli animés , comme ceux de D émo–
c.nce,
s'iníinu~ront,
dans la texUlre de certaines par–
o es du corps dlfpofees
a
les admettre, enforte qU'Oll
pOllrroit fe r préfenter I'aífemblage diilributifde ces
















