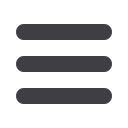
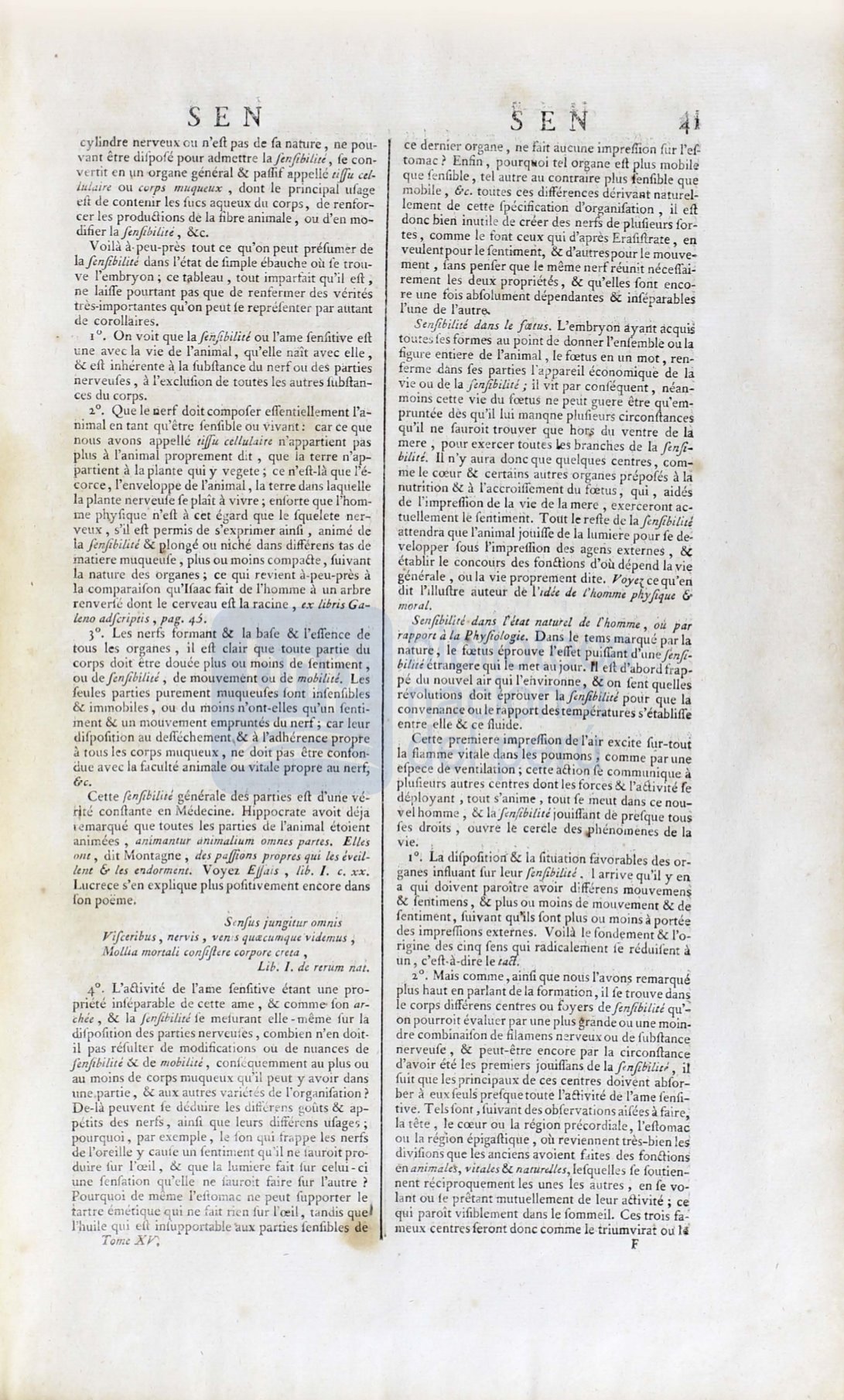
SEN
cyliDdre nerveux
Ol!
n'efi pas de (a Darure, De POll–
vanl erre di(po(é pour admettre
laflnjihilité,
Ce con–
v ertir en un 'organe général
&
pallif appellé
tiffu cel–
JuI,Jir,
ou
corps /II/UJueux
,
donr le principal u(age
efi de contenu les ClICS agueux du corps , de renfor–
cer les produétions de la libre animale, ou d'en mo–
dilier la
jenjibiLit¿,
&c.
Voila
¡\,
peu-pres rout ce gu'on peur preCumer de
laflnjibiLiti
dans l'érat de fimple ébauche Ol! fe trOtl–
ve l'embryon; ce rableau , tour imparfait gu'il efi,
ne laiffe pourtant pas que de renfenner des vérités
tres.imp0:1:antes qu'on peut fe repréCenrer par alttant
de corollaires.
10.
On
voit que
la fiñjibiliti
ou l'ame fenfirive efr
une avec la vie de l'animal , qu'eIle ná,t avec eIle ,
&
efi inhérente a,la fubfiance du nerf ou des parties
nerveufes ,
¡\
l'exc\uClQn de toures les autres filbfran–
ces du corps.
l.
0.
Que le ¡¡erf doit compoCer effentiellement
1'a.–
himal en ranr qu'etre fenfible ou vivant: car ce gue
nous avons appellé
tiffU cellulaire
n'appartient pas
plus
¡\
l'animal proprement dit , que la terre n'ap–
partient
a
la plante qui
y
vegete; ce n'efr-la que I'é–
coree, l'enveloppe de l'animal, la terre dans laquelle
la plante nerveufe fe plait
a
vivre; en{orte que l'hom–
me ph.yfique' n'efi
¡\
cet égard que le Cquelere ner–
veux, s'i! efl: perrnis de s'exprimer ainft , animé de
la
flnjibilité
&
plongé ou niché dans differens ras de
inatiere muqueuCe, plus ou moins compaéte, (uivanr
la narure des organes ; ce qui revient a.peu-pres
¡\
la comparai(on qu'[faac fait de l'homme
¡\
un arbre
r enverfe dont le cerveau efi la racine ,
e.ocLibris Ga–
Leno
adfcriptÍs, pago
45.
.
3°. Les nerfs forrnaht
&
la bafe & l'effetice de
tous les organes, il efi clair que toure partie du
corps doit etre douée plus ou moins de fentimenr,
ou
deflnfhilité,
de mouvemént ou de
mohilité.
Les
{eules parties purement muqueufes font infenfibles
&
immobi les , ou du moins n'ont-eIles qu'un (enri–
ment & un mouvement empruntés du nerf; car leur
difpofition au deíféchement,&
a
I'adherence propt e
a
touS les corps mugueux, ne doit pas I!tre confon·
aue avec la fdCUlté animale ou "itale ptopre au
ner~
l/c.
Cette
f'.nfhilitd
générale des paTries efi d'une vé–
riré confiante en Médecine. Hippocrate avoit déja
1
emarqué que routes les pan ies de l'animal étoient
animees ,
anímanlllr anilllaliulll olllms partes.
ELLes
nllt
dit Montagne,
des paJlions propres qui les ¿_.il–
lWe'
&
les endorment.
Voyez
EJlá,s
,
lih.
l.
C.
xx.
Lucrece s'en explique plus pofitivemenr encore dans
fon pooome.
Senfus ¡Imgiwr olllnij
Yzfcuibus, nuvis, VWISqlllEwmquevidelllus ;
Moltia Illorlali confzjl"e corpor. creta ,
.
•
Lih.
l.
de rerum nal.
4°. L'aélivité de l'aole feÍlfitive étant une pro–
priére infeparable de celte ame, & COJ11l11C" fon
ar–
clli.
& la
¡enjibilité
fe mefu ranr elle - meme (ur la
d.ifp~fition
des parties nervcufes, combien n'en doit·
il pas ré(ülter de modilicat ions ou de nuances de
flnfbilité
&.
de
mobilit¿,
conféquemment au ¡>lus ou
au moins de corps muqu eux qU'll peut y avolr dans
\1I1e parcie,
&
aux autres variétés de
I'org~nifalion
?
D e-la peuvent fe déduire les diltú ns gonrs & ap–
pétits des nerfs, ainfi que leurs
~iférens ufage~;
pourquoi, par exemple, l¿ (on <jU t .rappe les nerfs
de l'oreille y caute un (eOliment gu'il ne tauroit pro–
duire ¡llr l'aúl,
&
gue la lumicre fai t fitr celui - ci
une (en(ation 9,u'clle ne fauro;t faire fur l'autre ?
Pourquoi de
m~me
l'eflomac ne peut fupporrer le
tarrre éméliguc qui ne fait
ri
n (ur ['oej[, tandis quel
J'huile qui
ea
iníupp0l1able"aux parties fenfibles de
I
TomeXr:
5
E
N
i
ce dernier organe , ne
fart
aucune
impremo~
fu r l'eC–
tomac? Enlin, pourgllioi tel organe efl plus mobile
que (enfible, tel autre au ,
c~ntraire p~us
t.en/i.blegu~
mobile ,
l/c.
tomes cés dtfferences derivaRt naturel–
lement de cerre fpécilication d'organifation il efi
donc bieri inmile de créer des nerfs de
plufie~rs
for–
tes " comme le font ceux qui
d'apr~s
Era
/i.fl:rate, eq.
veulenrpour le fentimerit, & d'autrespollr le mouve–
ment , fans penfer que le meme nerf réúrút
néceffai~
remenr
l~s
deuJé: proprié:és, & qu
'ell.es(O"t enco:
re une (OIS ab(olument dependantes
&
inCéparables
l'une de l'autr6.
Senftbilité
dd~
le fa tus.
L'emi?rycín áya.rit acqlús
tou:es
{es
formes au pomt de donner l'enfemble ou la
figure entiere de l'animal , le foerus en un mot, ren–
ferme dans fes parties l'a p'areil écononiigue de la
vie ou de la
flnjibiliti;
il vit par con(équent néan":
moins,cett~
vie"du
~retus
ne
p~lÍt
guere
.etre'qu'em~
pruntee des qu
¡I!tu
manqne plufieurs clrconfiances
qu'il ne fauroit trouver que hors du ventre de la
mere, pour exercer tomES
I.esbranches <;le la
firifi–
b~liti.
II n'y aura donc que quelques centres, com–
me le creur
&
cel1ains alltres orgarles prépoCés
a
la
nutririon
&
a
l'actroiliement du fretus, qui, aidés
de l'i mpreaion de la vie de la mer e , exerceront ac–
tueIlenient le (entiment. TOllt le refie de la
firifibilit~
attendra que I'animal johiffe de la lumiere pqur fe de–
velopper fous l'impreffion des
ag~ris
externes
&:
établir le concou,rs des fonmons d'ou. dépend
l~
vie
générale , ou la vie proprement dite.
Poye{
ce gu"eri
dit l'illu!tre auteur dé
l',d¿e de L'ltomme pltyji'1 ue
&-
moral.
,
Senjihilité dans ['üal
natu~el
de l'horñme ,
011
par
rapport aJa Pkyfólogie.
Dans le ;ems marqué par
l~
narure; le foerus éprouve l'eífet puiífant d'une
/enji–
"ilite
étrangere qui le met au jom. 11
di:
d'abord frap–
P~
du n.ouvel air <J,ui
~'ehvironne, ~ o~ (e~t
quelles
revolutlons dOl! eprouver la
flrifihtlue
pOlir que la
convenahce oule i'appon destempératures s'établiffli
entre elle & ce f1uide.
.
erre premiere impreffion de l'air excite
fur-tou~
la fl?mme
vita~e (~ans
les
poum~JI1S
, comme par une
éfpece de ventllatlOn ; cerre aéllOn fe communigue
¡\
plufieurs autres centres dont les forces
&
I'aáiviré fe
deployant , tout s'anime , tOut
Ce
metlt dans ce nou–
vel homme , &
laf:nfihilité
jouifrant dé pre(que tous
fe.s droits, ouvre le cercIe des plt énomenes de la
Vle. :
..., •
1°.
La dífpofitiori"
&
la fitdation fávorables des or–
ganes influant fur leur
(mjibilit¿.
I arrive qu'il yen
a gui doivent paroitre avoir différens Iliou
vemen~
& f entimens , & plus ou molns de mouvemenr
&
de
(entiment, fuivant qu'ils font plus ou nioi ns
a
portée
des impreffions externes. Voila le
fónd~ ment
& 1'0-
rigine des cinq fens qui radicalement re réduifent
¡\
un, c'efi.a-dire le
taff.
2°.
Mais comme, ainíi que noús
l'avon~
remarqué
plus haut en parlant de la forl1)ation , il fe trouve dans
le corps
difF~rens
centres
Ol! foyers_
deflnjibilid
qu':
on pourrolt evaluer par une plus
~rande
ouune moin.
dre combÍnaifon de filamens ner veux ou de (ubfl:ance
nerveu(e,
&
peur-erre encore par la circonfiance
d'avoi r été les premiers jouiffans de
laflnjibllitl ,
il
(uit que les principaux de ces centres doivent ab(or–
ber
¡\
euxfeuls prefql1etoute l'aétivité de I'ame fenfi–
tive. Tels fom , (uivant des obfervarions ai(ées
a
faire '
la tete , le creur ou la
régio~
précordiale,
l'efioma~
ou la rég'ion épigaílique , 011 revienn ent tres-bien les'
div;fions que les anciens avoient f. ites des fonétions
en
animate!, ..itales&
nalUrdles,refquelles ie foutien–
nenr
r~ciproquement
les unes les amres, en
Ce
vo–
lant ou {e pretanr muruelIement de leur aétivité;
c~
qui paroit vifiblement dans le fommei]' Ces !rois fa:
meux centres (eront done eomme le triumvirat 011
¡i
F
















