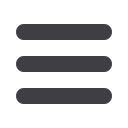
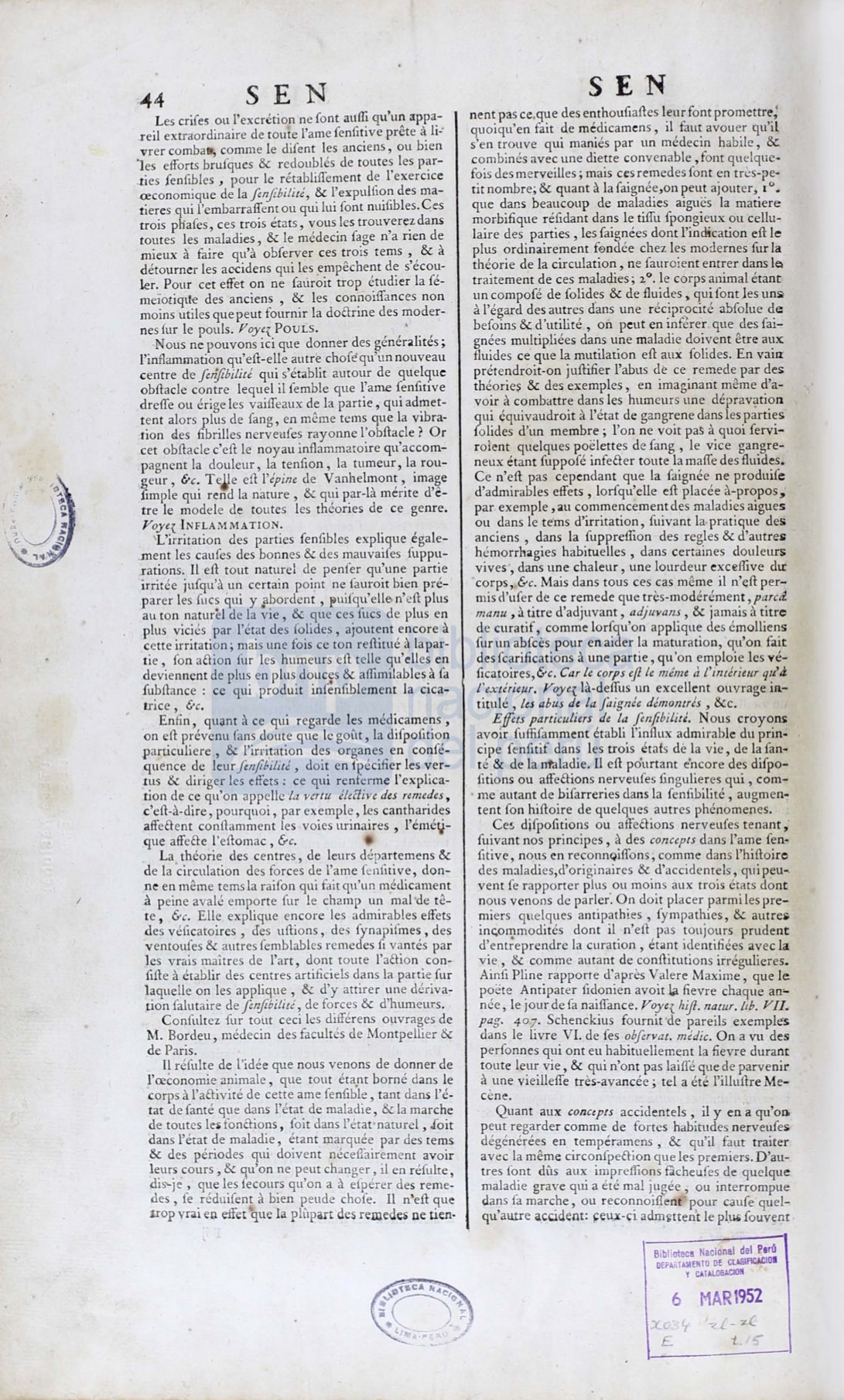
S E N
Les crifes ou I'excrétiofl ne (ont auffi qu'un appa–
.reil extraordinaire de toute l'ame (enlitive pnhe a li-'
vrer combaa, comme le difent les anciens, ou bien
'les efforts brufques
&
redoublés de toutes les par–
.lÍes fenlibles
J
pour le rétablurement de I'exercice
reconomique de
laflnjbilité,
~ ~'expulli?n
des ma–
tieres qui l'embarraífent ou qUlIUl (ont ntulibles. Ces
rrois pliafes, ces trois états , vous les trouvere.z dans
tomes les maladies,
&
le médecin (age n'a nen de
mieux
a
faire qu'a ob[erver ces trois tems,
&
a
détourner les accidens qui les .empeche?t
d~ s'éco~ler. Pour cet e/fet on ne (auroit trop etlldler la (e–
melOtiqlte des anciens ,
&
les connoiífances non
moins utiles quepeut fournir la doEtrine des moder-
nes {ur le pouls.
Poye{
POULS.
•
,Nous ne pouvons ici que donner des
~énéralités;
l'inflammation qll'efi-elle autre cho(equ'un nouveau
centre de
flñjibilité
qui s'établit alltour de qllelque
obfiacle contre lequel il (emble que l'ame fenlitive
dre(fe ou érige les vaiífeaux de la partie
i
qui admet–
tent alors plus de (ang, en meme tems que la vibra–
tion des fibrilles nerveufes rayonne I'obfiacle? Or
cet obfiacle c'efi le noyau inflammaroire qu'accom–
pagncnt la douleur, la tenlion, la tumeur, la rou–
geur,
{,>c.
Te~e
efil'épine de Vanhelmont, image
{¡mple qui rend la nature ,
&
qui par-la mérite d'e–
rre le modele de toutes les théories de ce genre.
roye{
I NFLAMMATION.
'L'irritation des parties (enlibles explique égale–
ment les caufes des bonnes
&
des mauvaifes fuppu–
rations. II eft tout naturel de penfer qu'une partie
lrritée ju[qu'a un certain point ne fauroit bien pré–
parer les (llCS <¡lli y .abordent , fluifqu'elll} n'efi plus
au ton natur¡!l de la vie,
&
que
ces
fucs de plus en
plus viciés par I'état des (olides, ajolltent encore a
cette irritation; mais une fois ce ton reftitué a la par–
tie, fon aétion fur les humeurs efi telle qu'elles en
deviennent de plus en plus douces
&
affimilables a fa
Iubfiance : ce qui produit infenftblement la cica–
trice,
{,>c.
Enfin, quant
a
ce qui regarde les médicamens,
on efi prévenu fans doute que le gOllt, la difpolition
p articuliere ,
&
l'irritation des organes en confé–
quence de leur
flnJibilité ,
doit en [pécifier les ver–
lUS
&
diriger les efT'ets: ce qui renferme l'explica–
tion de ce qu'on appelle
La vertu éüllive des nmedes,
c'e{l-a-dire, pourquoi, par exemple , Les cantharides
a/feétent con{lamment les voies urinaires , l'émétj.–
que affeéte I'e{lomac ,
&e.
La. théorie des centres, de leurs départemens
&
de la circulation des forces de l'ame fenlitive, don–
ne en meme tems la raifon qui fait qu'un médicament
a peine avalé emporte fm le champ un mal 'de te–
te ,
&c.
Elle explique encore les admirables eíl'ets
des vélicatoires , des uíl:ions, des fynapifmes , des
ventoufes
&
autres femblables remedes li vantés par
les vrais maltres de I'an, dont tollte I'aétion con–
[tite
a
établir des centres artificiels dans la partie fur
laquelle on les applique ,
&
d'y atnrer une dériva–
cion falutaire de
flnjbilité ,
de fo rces
&
d'humeurs.
Confultez {ur tout ceci les différens ouvrages de
M. Bordeu, médecin des facultés de MontpeLlier
&
de Paris.
II ré(ulte de l'idée que nous venons de donner de
l'
reconomie animale , que tollt
éta.ntborné dans le
corps
a
l'aétivité de cette ame fenúble , tam dans l'é–
tat de fanté que dans l'état de maladie ,
&
la marche
de tout s
l~
fo nétions , (oit dans I'état' naturel, [oit
dans l'état de maladie , étant marquée par des tems
&
des périodes qui doivent néceíliúremem avoir
leurs cours ,
&
qu'on ne peut changer , il en ré(ulte
dis--je , que les fecours qu'on a
a
efpérer des
reme~
des , fe réduiCent
a
bien peude chofe. Il n'eft que
1rOp
vrai en eifet que la plllpart des remedes ue cien·
nent pas ce.que des enthoulia{les leur font promettre;
quoiqu'en fait de médicamens , il faut avouer qu'il
s'en trouve qui maniés par un médecin habile,
&
combinés avec une diette convenable, font quelqlle–
fois des merveiLles; mais ces remedes font en treS-pe–
tit nombre;
&
quant a la faignée,on peut ajouter,
10.
que daos beaucoup de maladies aigucs la matiere
mor.bifique réfidant dans le tiífll fpongi eux ou cellu–
laire des parties, les faignées dont I'indication efi le
plus ordinairement f0ndée chez les modernes fur la
théorie de la circulation , ne fauroient entrer dans
I~
traitement de ces maladies;
2°.
le corps animal étant
un compofé de (olides
&
de fluides , qui font
les
uns:–
a
l'égard des autres d'ans une réciprocité abfolue de
befoins
&
d'utilité, on peut en
inf~rer
que des fai–
gnées multipliées dans une maladie doivent etre ame:
tluides ce que la mutilation efl: allx (olides. En vaia
prétendroit-on juflifier l'abus de ce remede par des
théories
&
des exemples, en imaginant meme d'a–
voir a combattre dans les humeurs une déprav¡nion
qui équivaudroit
a
l'état de gangrene dans les parries
(olides d'un membre; I'on ne voit paS a quoi fervi–
rolent quelques poelettes de fang , le vice gangre–
neux étant (uppofé infeéter toute la maífe des fluides.
Ce n'e{l pas cependant que la faignée ne produi[e
d'admirables effets , lorfqu'elle efi placée a-propos,;
par exemple ,au commencement des maladies aigues
ou dans le te'ms d'irritanon, (uivant la,pratique des
anciens , dans la fuppreffion des regles
&
d'autre¡;
hémorrhagies habituelles , dans certaines douleurs
vives, dans une chaleur , une lourdeur exceffive dlt
corps,
&c.
Mais dans tous
ces
cas meme il n'efiper–
mis d'ufer de ce remede que tres-modérément,
pared.
manu
,a ritre d'adjllvant,
adjuyans,
&
jamais
a
titre
de curatif, comme lorfqu'on applique des émolliens
[urun abfces pour en aider la maturatioll, qu'on fait
des fcarifications a une partie , qu 'on emploie les vé–
íicatoires,&c.
Car
Le
eorps ejl le
m.meti
L'intérienr
'Ida
L'extériew. V<ry't¡:
la-deífus un excellent ouvraue ill–
titulé,
Les abus de la Jaignét démontrés ,&c.
o
E
ffits
partieuLim de la flnJibilité.
Nous croyoru:
avoir fuffifamment établi I'inflm( admirable du prin.
cipe (enlitif dans les trois étafs dé la vie, de la fan–
té
&
de la n1'aladie. Il eft póurtant c'ncore des difpo–
{¡tlons ou affeilions nerveufes fingu lieres qui , com–
me autant de bi(arreries dans la fenftbilité, auumen–
tent fon hilloire de quelques autres phénome;es.
Ce!.. djfpolitions ou affeétions nerveu(es tenant,–
[uivant nos principes , a des
eoneeplS
dans l'ame [en–
{¡tive, nous en reconnQiífons, comme dans I'hi{loiro
des mJladies,d'origi naires
&
d'accidentels, qui
peu~
vent fe rapponer plus ou moins aux rrois états dont
nous venons de parler·. On doit placer parmi les pre–
miers quelques antipathies , fympathies,
&
autre~
in~on:modités
dont il n'efi pas tolljours prudent
d'entreprendre la curation, étam identifiées avecla:
vie,
&
comme autant de con{litutions irrégulieres.
Ainli Pline rapporre d'apres Valere Maxime que le
p~ete ~ntipater li~onien
avoit
I<i
fievre chaque an–
nee, le JOur de fa na4fance.
Vo,re¡: hijl.
nalla.
Lib. VII.
pago
4 0:<.
Schenckius fourn1t'de pareils exemple's
dans le hvre VI. de fes
obflrvat, mUic.
On a
VII
des
perfonnes qlli Ont eu habitllellement la fievre durallt
toute lem vie ,
&
qui n'ont pas laiifé que de parvenir
a une vieilleífe tres-avancée; tel a été l'illufire Me–
cene.
Quant aux
con"pls
accidentels, il Y en a qu'on.
peut regarder comme de forres habitudes nervell(es
dégénéré~s
en .tempéram,ens ,
&
qu'il fallt traiter
avec la meme ClrconfpeétlOn que les premiers.D'au–
tres font díis al!': in; p,refi'io?s
~cheufes
de quelque
maladle grave qm a ele mal Jugee , ou interrompue
da~s
fa
marc.he, ou
reco~noillent
p,our caufe quel–
qu amre acodellt:
~eux-Cl
admettent le pl,U¡;
[ouv~nt
Biblioteca Nacional del
PirÓ
OEl'A.TllIEHIODE CUSlACIoCIDI
y
C.t.TI.UI6t.C1ON
6
MARI952
-:d
-
z.(
t .
!í
















