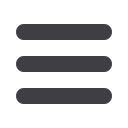
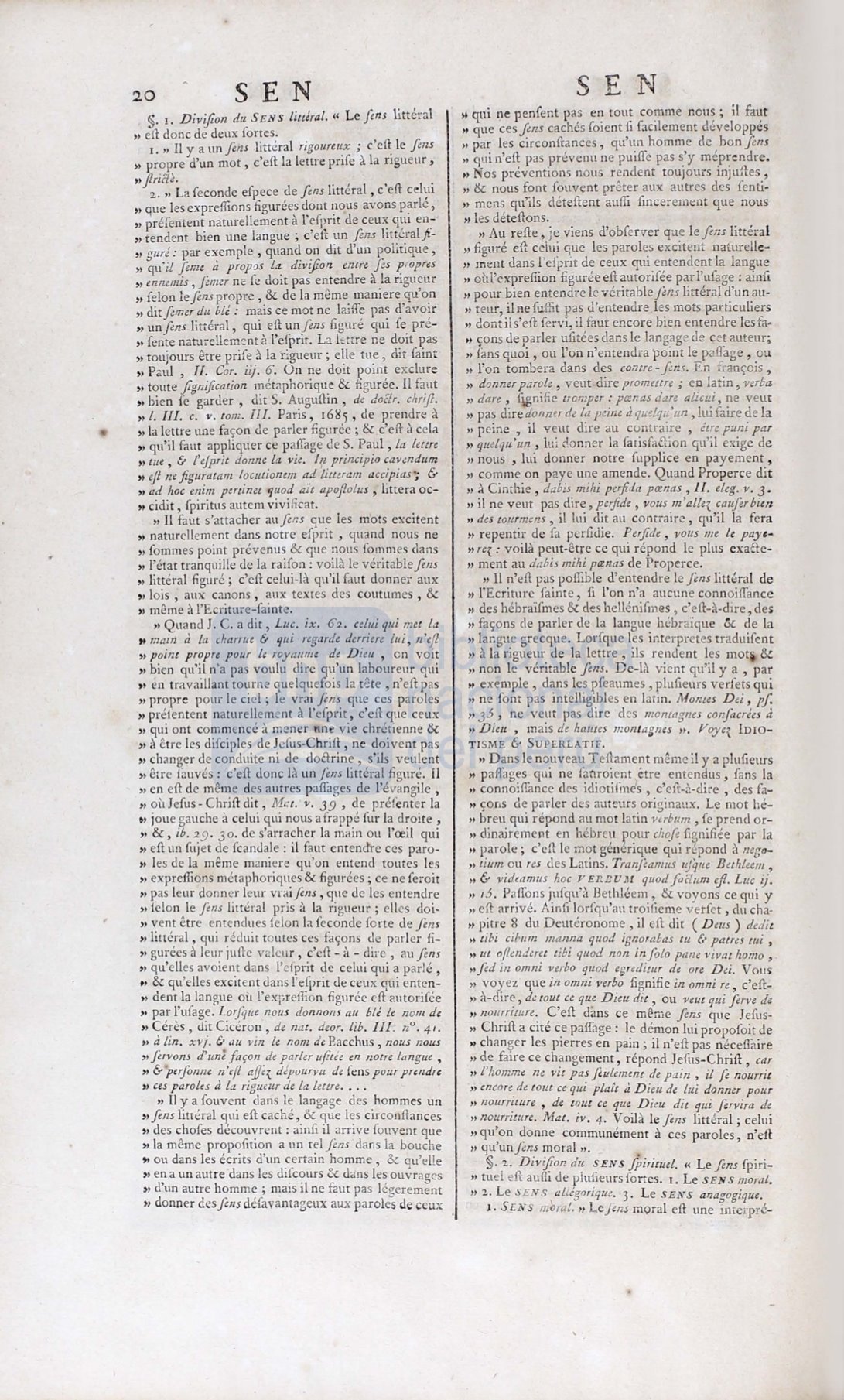
2 0
SEN
§.
I.
Divifion dil
S EN S
liulral.
"
Le
fens
littéral
t,
eíl: done de deux forres.
l . "
n
y a un
fen>
littéral
rigoure~x
;
c'efi le
fens
" propre d'un mot, c'eíl: la leme pn{e a la ngueur ,
"
jlriae.
1.. "
La feconde efpeee de
fellS
littéral , e'efi eelui
" que les expreffio ns
figurée~ ~ont
1.lOUS
avons
p~rlé ,
" préfentent naturellement
a
1
efpnt de
eeu~ q~1l
en–
"tendent bien une langue ; e'eft un
fens
bt,eral
fi–
" "un!
:
par exemple , qlland on dit d'un
l~olitique ,
»
qu·il
feme
tÍ
propos la. divifton entre j es
~ropm
" enlltlllis ,flmer
ne fe dOlt [las el:tendre a }a ngll; ur
" fe lon
lej i:ns
pr?pr~
' .&
de la meme. mamere,qu o.n
»dit femer du bLc :
mal
5
ce mot ne l;u{fe pas d avolr
" unfins
littéral, qui efi unfills fi guré qui fe pré–
)' fente natu.cllement
a
l'efprit. La lettre ne doit [las
" toujours
~tre
prife a la rigueur ; elle tue, dit faint
" Paul ,
l/.
Coro iij .
ó.
On ne doit point exclure
" tollte
jignijieation
métaphorique
&
figurée.
11
fant
" bien le garder , dit
S.
Auguílin ,
de doElr. ehrifl·
" l.
l/J.
c. v. tomo
lIJ.
Paris,
[685 ,
de prendre a
»
la tettre une
fa~on
de parler figuree;
&
c'efi ¡l cela
" qu'il faut appliquer ce palfage de
S.
Paul ,
la lu cre
"me ,
&
t'elpric dOllne la vie.
lr,z
principio cavendum
" ejl
ne figuratam loeulÍomm
tUi
liaeram accipiaS";
&
" ad hoe m im p" tillec r¡lIod att apojlolus
,
littera oe–
" cidit , {piritus autem vivificat.
" Il
faut s'attaeher
au fens
que les mots exeitent
" naturellement dans notre efprit , quand nous ne
" fommes point prévenus
&
que nous fommes dans
" l'état tranql1ille de la raifon : voila le véritablefills
" litteral figuré ; c'efi celui-Ia qu'il fdut donner aux
" lois , aux eanons , aux tex[es des coutumes,
&
" meme
a
l'Eeriture-fainte.
" Quand J.
C.
a dit ,
Lue. ix.
Ó2. .
ce/ui qui mee la
" main
tÍ
la c"arrue
&
'fui regarde d. rriere lui, n'ejl
"point propre pour le royalt"'o de D iw
,
e n voit
" bien qu'il n'a pas vOlllu dire qu'un laboureur qlli
" én travaillant toume quelquefois la tete , n'efipas
"propre pOlU" le eie! ; le vrai
fens
que ces paroles
" prélentent naturellement
a
l'efprit , e'efi que ceLlX
., qui ont commencé
a
mener
ttne
v ie ehrétienne
&
" a
~tre
les difeiples de Jefus-Chrifi , ne doivent pas
" changer de eonduite ni de doél:rine , s'ils veulent
"
~tre
ülUvés : c'eíl: done la un
/ws
littéral figuré.
íl
" en efi de meme des autres paífages de l'évangile ,
" oltlefus - Chrifi dit ,
Met.·v.
39 ,
de préfenter la
~,
joue gauehe
a
eelui qui nous a frappé fur la droite ,
" &,
ib.
:1.9 . 30.
de s'arracher la main ou I'reil qui
" efi
\111
íiljet de fcanoale : il fam enrend're ces paro–
" les de la meme maniere qu'on entend toutes les
" expreffions métaphoriques
&
figurees; ce ne feroit
"pas leur donner leur vraifens, que de les entendre
" lelon le
fens
liltéral pris
11
la rigueur ; elles doi–
" venr etre enrendues Jelon la feconde forte de
/ ens
" littéral , qui réduit tolltes ces fac;o ns de parl er
fi–
.' gurées a leur jufie valeur , c'en - a - dire , au
fins
" qu'elles avoient dans I'efprit de celui qui a parle ,
ti
&
qu'elles excitent dans l'ef¡Jrit de ceux qui enten–
" dent la langue Oll l'ex¡:;reffion figurée eíl: autorifée
" par l'urage.
Lorfque 1l0US donnons aU bU le no'" de
" Céres, dit Cicéron,
de nato deor. lib.
JI/.
n
O
. 4 ' .
..
tÍ
lino xvj.
&
l/U vin le nom de
Bacchus ,
nOUS nous
" fi rvom d'une
fa~oll
de parler ufitée en no"e l({ngue ,
" &
perJollllt
n"fi
afle{ d¿pvurvil de
(ens
pour prendre
" ces paroüs
ti
la rigtuur de la lettre.
• . .
" Il Y
a fouvenr dans le langage des hommes un
" fins
littéral qui eíl: caché ,
&
que les circonna nces
" des chofes déeouvrent : ainíi il arrive rouvent que
"la méme propoíition a un
t el j ells
dans la bouehe
" ou dans les écrits d'un eertain homme ,
&
qu'elle
" en a un autre dans les direours
&
dans les ouvrages
., eI'un autre homme ; mais il ne faut pas légerement
" donner des
fellS
défavantageux aux paroles de ceux
S E N
11
qui rye penfent pa: er: tout co;nme nous ;
il
fal~t
" que ces
fins
caches fOlent íi facIlement développes
" par les eirconfianees , qU'Ul1 homme de bon
fem
" qui n'efi pas prevenll ne puiífe pas s'y méprendre.
" Nos préventions nOU5 rendent touj ollrs injufres ,
" &
nous font
{ouv~nt
préter aux autres des fenti–
" mens qu'ils elétefient auffi íincerement que nous
" les détefions .
" Au refre , je viens d'obferver que le
fim
litteral
"figure efr celui que les paroles excitent naturelle–
" ment dans I'elprit de ceux qui entendent la langue
" olll'expreffion figuré e efi autorifée parl'ufage : ainíi
" pour bien entendre le véricable
Iuzs
litteral d'un au–
" teur, il ne {uffit pas d'entendre les mots particuliers
" dont ils'ea fervi, il faut encore bien entendre les fa.
., c;ons de parler uíitées dar.s le langage de cet auteur;
" ÜI11S
quoi , ou l'on n'entendra point le paírage , ou
" l'on tombera dans des
eomre
-
fim.
En
ran~ois ,
" donner parofe
,
veut dire
promettre ;
ee latin ,
verba
"
dare ,
f~nifie
tromper
:
palnas dare alicui,
ne vem
" pas dire
donner d¿ la
peine
¡¡
quelq;t'un
,
luí fa ire de la
" peine , il veut dire au contraire ,
¿ere
pUlli par
"qudqu'ull ,
luí donner la fat isfaétion qu'il exige de
"nous , lui donner notre fupplice en payement ,
" comme on paye une amende. Quand Properce dit
,, ¡¡ Cinthie ,
dabis mihi perfida palnas ,
JI.
e/egov .
3 .
" il ne veut pas dire,
p crfide
,
vous
m'
alle{ callfer bim
" des tourmm s
,
il lui dit a\l eontraire , qu'il la fera
" repentir de [a per6die.
Perfide , vous me le pay'–
" Te{
:
voila
pe\lt-~tre
ce qui repond le plus exaél:e–
" ment au
dabis mihi pallas
de Properce.
" Il
n'efi pas poffible d'entendre le
jens
littéral de
" r Ecriture (¡¡inte ,
fi
l'on n'a au cune eonnoiífanee
" des hébraifmes
&
des hellenifmes , c'efi-a-dire , des
"
fa~ons
ele parler de
la
langue hébraique
Oc
de la
" lar.gue greeque. Lorfq ue les interpretes traduifcnt
" a
la rigueur de la lettre , ils r endent les mot
&
" non le veritable
fins .
D e-la vient qu'il y a, par
" exemple , dans les pfeaumes ,pluíieurs verfets qu i
" ne font pas intelligibles en latino
Montes D ei , pf.
"35 ,
ne veut pas dire des
momagnes eonf acrées
tÍ
" D iw
,
mais
d. hauees mom agnes
>l.
V~e{
IDIO–
T ISME
&
SU PERLATIF.
" D ans le nOllveau T eframent meme il y a plllJieurs
" paífages qui ne fanroient étre entenGus , fans la
" eonnoiífanee des idiotiíinds , c'efi-a-dire , des fa–
,,~ons
de parler des ameurs originaux. Le mot hé–
" breu qui répond au mot latin
v rbum
,
fe prend or–
" dinaireme nt en hébreu pour
chofe
íignifiée par la
" parole ; e'eH
le
mot générique qui réponcl a
Ilego–
>1
Limn
eu
res
des Latins.
Tranl'anms u/ que B etlzteem ,
" &
v.id<amus hoc
r
ER B U
1\1
quod fo llum efl. Luc
ij.
"
r5 .
Paífolls jurqu'a Bethléem,
&
voyons ce qui y
"eil: arrive. Ainfi lor[qu'an ¡roi{jeme vetfet , du chao
" pitre
8
du Deutéronome , il efi dit
( D eus ) dedit
" ab,
" ¡'11m
manna quod Ignorabas
trt
e ..
pacres tui ,
" ut ,,{lenderet tibi qtlod non in folo pane vi vat /zomo ,
" jed in omni verbo qllod egrediw r de ore D ei.
Vous
" voyez que
in omni verbo
íignifie
in omni re
c'efi–
" a-dire ,
detout
ce
que D ieu die
ou
veut qllí ; rve de
. e'
fi .
,
J'
" nourrcture:
,e dans ee meme
fens
que Jefus-
" Chnfi a cite c.e palfage : le démon lui propofoit de
" ehanger les plerrcs en pain ; il n'eíl: pas nécellaire
>1
de falre ce ehangement, répond Jefus-Chrifi
car
" l'/wmme /le Vil p as fiu lement de p ain , il
fe
n: ttrril
"
<neore.detout ct qui plaÍt
tÍ
D iert de lui donner pour
"
Tlourr~ltlre
,
de tOta
ce
que D im die 'fui fervira de
"no~mUlre.
Mat. iv .
4 .
·~oi[¡'t
le
fins
littéral ; eelui
"qu on donne eornmunement a ces paroles n'eí!:
" qu'un jens moral".
'
§.
2 .
Divijion dtt s
EN S
fpirituel.
"
I.,.e
fens
fpiri–
" tuel eCr auffi de plufieurs [e rtes.
l .
Le
S EN S
morato
" 1..
Le
S EN S
aliégori'lue.
3.
Le
S ENS
arzagogir¡ue.
1.
SENS
mbrat.
" Lcjens
moral efi une interpré-
















