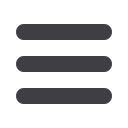
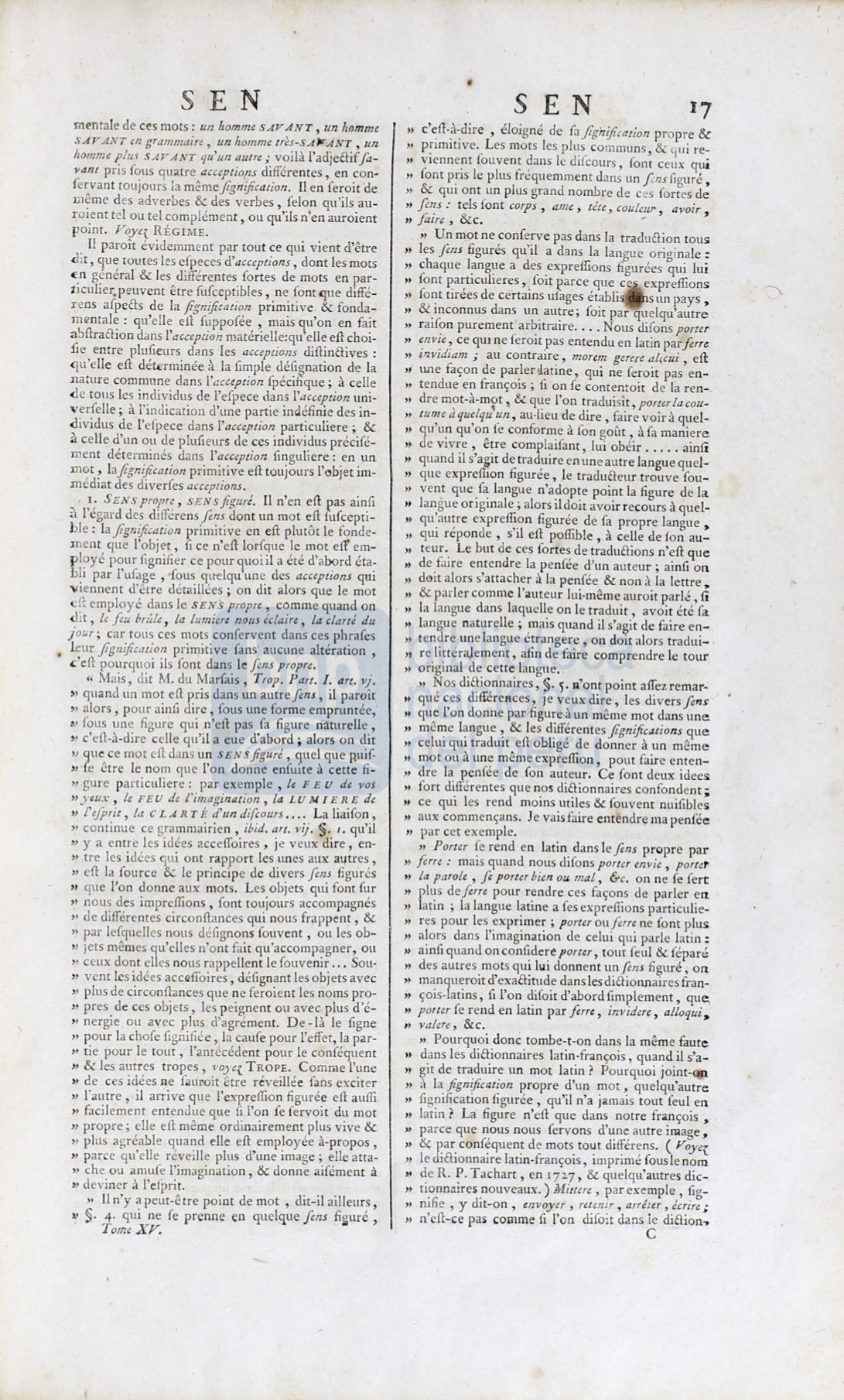
SE N
mentale de ces mots:
un homme SAVANT, un Izemme
SAVANT en grammaire , un homme
treS-Sk~ANT
,
un
Izomme pltLf SAV ANT 'lu'un autro;
voila I'adjeél:if[a–
y,tnt
pris fous qu¡¡tre
acceptiol,LS
di/férentes, en con–
fervant toujours la meme
jignijicatioll.
Il en (eroit de
¡neme des adverbes
&
des verbes , (elon qu'ils au–
r oient tel ou tel complérnent, ou qu'ils n'en auroient
poinr.
V oye{
R ÉG I ME.
Il
paro!t évidemment par tout ce qui vient d'etre
¿ it, que toutes les eipeces d'
acceptions
,
dont les mots
<,n général
&
les di/féreJ1tes (ortes de mots en par–
úcuIier. peuvenr etre (u(ceptibles, ne font que di/fé–
r ens afpeél:s de la
jignijication
primiti ve
&
fonda–
m~nta le
: qu'clle eH (uppo(ée , mais qu'on en fait
abftraél:ion dans
l'
acception
matérielle:qu'elle eH choi–
fte entre plufieurs dans les
acceptions
difiinél:ives :
qu'elIe eft déterminée
a
la fimp le défianation de la
Jlature commune dans
I'acception
fpé cigque;
a
ceHe
<le
tollS les individus de I'e(pece dans
I'acception
uni–
ver(elle;
a
i'indication d'une partie incléfinie des
in–
<1ividus de l'efpece dans l'
acceplion
particuliere;
&
a
celle d'un ou de plufieurs de ces individus préci(é–
ment déterminés dans l'
acception
finguliere: en un
mot , la
jignijication
primitive eft toujours l'objet im–
médiat des diver(es
acceplions.
, l.
S ENS propre, s ENsfiguré.
Il
n'en eft pas ainfi
~
I'égard des di/férens
[ens
dont un mot eft fufcepti–
ble : la
jigllijication
primitive en efi plutot le fonde–
ment que I'objet, fi ce n'eft lorfque le mot efi' em–
ployé pour fignifier ce pourquoiil a été d'abord éta–
bli par I'u(age , 'fous qttelqu'une des
acceptions
qui
viennent d'etre détaillées; on dit alors que le mot
fr
employé dalls le
SEN!; prop",
cornme quand on
<lit,
ü
ftu
brúte , la lumiere nous ielai,. , la darte du
j our ;
cal' tous ces mots con(ervent dans ces phra(es
leur
jignijicalion
primitive (ans aucune altération ,
,'eí!: pourqlloi ils (ont dans le
fens prop",
" Mais, di! M. du Mar(ais ,
Trop. Parto
l.
are. v;'
" quand un mot
ea
pris dans un aurre
fens ,
il paro!t
" alors, pour ainfi dire , (ous une forme emprunrée,
'.' (ous une figure qui n'eft pas (a fi gure riantrelle ,
" c'efi-a-dire celle qu'il a eue d'abord; alors on dit
,¡
que ce mot eft dans un
SENS figuré,
quel que Huir–
".(e etre le nom que I'on donne enCuite
a
certe fi –
>1.gure particuliere: par exemple ,
le F E U de vos
" y eux, le FEU de l'imagin¿¡tion, la LU
M I
E
R
E de
"
l'eJPrit, la
e
LA
R
T
É
d"un difc0urs ....
La liai(on,
,; continue ce grammairien ,
ibid. arto vij.
§.
l.
qu'il
" y
a entre les idées acceífoires , je veux dire, en–
" tre les idées qui ont rapport les unes aux a4tres,
" efr la (ource
&
le principe de divers
fens
figurés
" que I'on donne aux mots. Les objets qui fonr (ur
" n ous des impreílions , (ont toujoms accompagnés
" de cli/férentes circoní!:ances qui nous frappent,
&
" par le(quelles nous déíignons (ouvent, ou les ob–
,) ¡ets memes qu'elles n'ont fair qu'accompagner, ou
" ceux dont elles nons rappellent le (ouvenir . . . Sou–
,) vent les idées accaífoires, défignant les objets avec
,) plus de circonfiances que ne feroie nt les noms pro–
,) pl'es de ces objets, les peignent ou avec plus d'é–
" nergie ou avec plus d'agrément. De -
1<\
le figne
" pour la chofe fignifiée , la caufe pour I'e/fet, la par–
" tie pour le tout, I'antécédenr pour le conféquent
" &
les autres tropes,
,/o)'e{
T ROPE.
Comme I'une
,) de c s idées ne (¡¡uroÍt etre réveillée fans exciter
,) l'autre, il alTive que I'expreílion figurée efi auíli
" facilement entendue que íi I'on (e fervoit du mot
" propre; elle eft meme ordinairement plus vive
&
" plus agréable quand elle eft employée a-propos ,
" paree qu'elle réveille plus d'une image; elle atta–
" che ou amure I'imagination,
&
donne aifémenr
a
" deviner a I'efprit.
" Il n'y a pem-e tre point de mot , dit-il ailleurs,
)) §.
4. qui ne (e prenne en qUelqlle
flns
fi~uré ,
Tome Xr.
SEN
"
c'~fi
..
a~dire
, éloigné de (a
jigizijication
pl'opre
&
" p:lmltlve. Les mots les
pl~s
communs,
&
<.¡ lI i
re–
" vlennenr (ouvenr
~ans
le difcours, (onr ceux qui
" (onr pns le plus frequemment dans un
flns
figuré
" &
qui onr un plus grand nombre de ces (orres d;
"
fi~s ,'
tels (ont
corps, aTlle , téte, couleur, ayoir ,
" fiIlre
,
&c.
-
" Un mot ne con(erve pas dans la traduél:ion tous
" les
fem
figmés qu'il' a dans
la
langue originale :
" chaque langue a des expreílions figurées qui luí
" (ont
¡>a~ticulieres, .
Coit paree,
que.ceexpreílio!)s
" (onr mees de cerrallls uiages etabhs
s un pays ,
" lIt.inconnus dans un.
au~re;
[oir par quelqu'autre
" ralfon puremenr arbltralre. .. . Nous difons
porte/'
"
envie,
ce qUl ne [eroir pas entendu en larin parfirre
"
inyidiam;
au conrraire,
morem gerere al¡cui
,
eft
,{ lUJe fac;:on de parler
~atine,
qui ne feroit pas en–
" tendue en franc;:ois ; fi on (e contentoir de la ren–
" dre mot-a-mot '/
&
que I'on traduis!t,
ponerlacou–
" tume
a quel'lu~un ,
au·lieu de dire, faire VQid quel–
" qu'un qu'on
le
conforme a (on gout,
a
(a maniere
" de vivre, erre complaifant, lui obéir ..... ainíi
" quand il s'agir de rraduire en une autre langue quel–
" que expreíI¡on figuré e , le rraduél:eur trouve (ou–
" vent que (a langue n'adopte point la figure de la
" langue originale; alors ildoir avoirrecours
a
quel–
" qu'alltre expreílion figurée de (a propre langue ,
" qui réponde , s'il efi poílible , a celle de (on au–
" teur. Le but de ces forres de traduél:ions n'efi que
H
de faire entendre la pen(ée d'un auteur ; ainfi on
»
dGir alors s'attacher
a
la pen(ée
&
non
a
la lettre ,
" &
parler comme I'ameur lui·meme auroit parl¿ , íi
" la langue dans laquelle on le traduit, avoit été (a
H
langue naturelle ; mais quand il s'agit de faire en–
" tendre unelangue érrangere , on doit alors tradui–
>1
re lirtéra,lement, afin de faire comprendre le tour
" original de cette langue.
" Nos diél:ionnaires,
§.
5. Il.'ont point aífez remar-O
" qué ces différeflces, je veux dire, les divers
ferz$ /
H
que I'on donne par figure
a
un meme mot dans une.
" meme langue ,
&
les di/férentes
jignijications
que
" celui qui traduit eft obligé de donner
a
un meme
" mot ou
a
une meme expreílion, pom
faire
enten-
" dre la pen(ée de fon auteur. Ce font deux idees
" fort différentes que nos diél:ionnaires confondent;
" ce qui les rend moins utiles
&
(ouvenr nuifibles
" aux commenc;:ans. Je vais faire entendre
111a
pen(ée
" par cer exemple.
" POrler
(e rend en latin dans le
fens
propre par
"
firre ,'
mais quand nous difons
porter enyie, porte,..
" la parole
,
fe porte/' bien
0/1
mal, &c.
on ne fe (ert
" plus
defelre
pour rendre ces fac;:ons de parler en
»
latin ; la langue latine a (es expreílions particulie–
" res pour les exprimer ;
porter ouferr.
ne (ont plus:
" alors dans l'imagination de celui qui parle latin :
»
ainfi quand on confidere
pOrler
,
tour (eul
&
(éparé
" des autres mots qui
J¡ú
donnent un
fellS
figuré , on
>J
manqueroit d'exaél:itude dans les diaionnaires fran–
" c;:ois-Iatins, fi I'on difoir d'abord fimplement , que,
" porter
(e rend en latin par
firre, inyidere ,
alloqui~
"
valere,
&c.
" Pourquoi done tombe-t-on dans la meme faute
" dans les diél:ionnaires latin-frans:ois, quand
il
s'a–
" git de traduire un mot latin? Pourquoi joint-en
" ;\ la
fignification
propre d'un mot, quelqu'autre
»
íignification figurée, qu'il n'a jamais tout [eu l en
" latín? La figure n'efi que dans norre franc;:ois ,
»
paree que nous nous (ervons d'une: autre image ,
" &;
par con(équenr de mots tout di/férens.
(Voye{
" le diél:ionnaire latin-franc;:ois, imprimé (ous le nom
»
de R. P. Tachan, en
17~7 ,
&
quelqH'aurres dic–
" tionnaires nouveaux. )
Mimre,
par exemple , fig–
" nifie ,
y
dit-on,
envoyer, ruenir , arreeer, ¿air< ;
" n' fi-ce pas ¡;omme
{j
I'on diCoit dans le diél:ion.,.
C
















