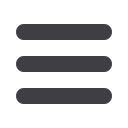
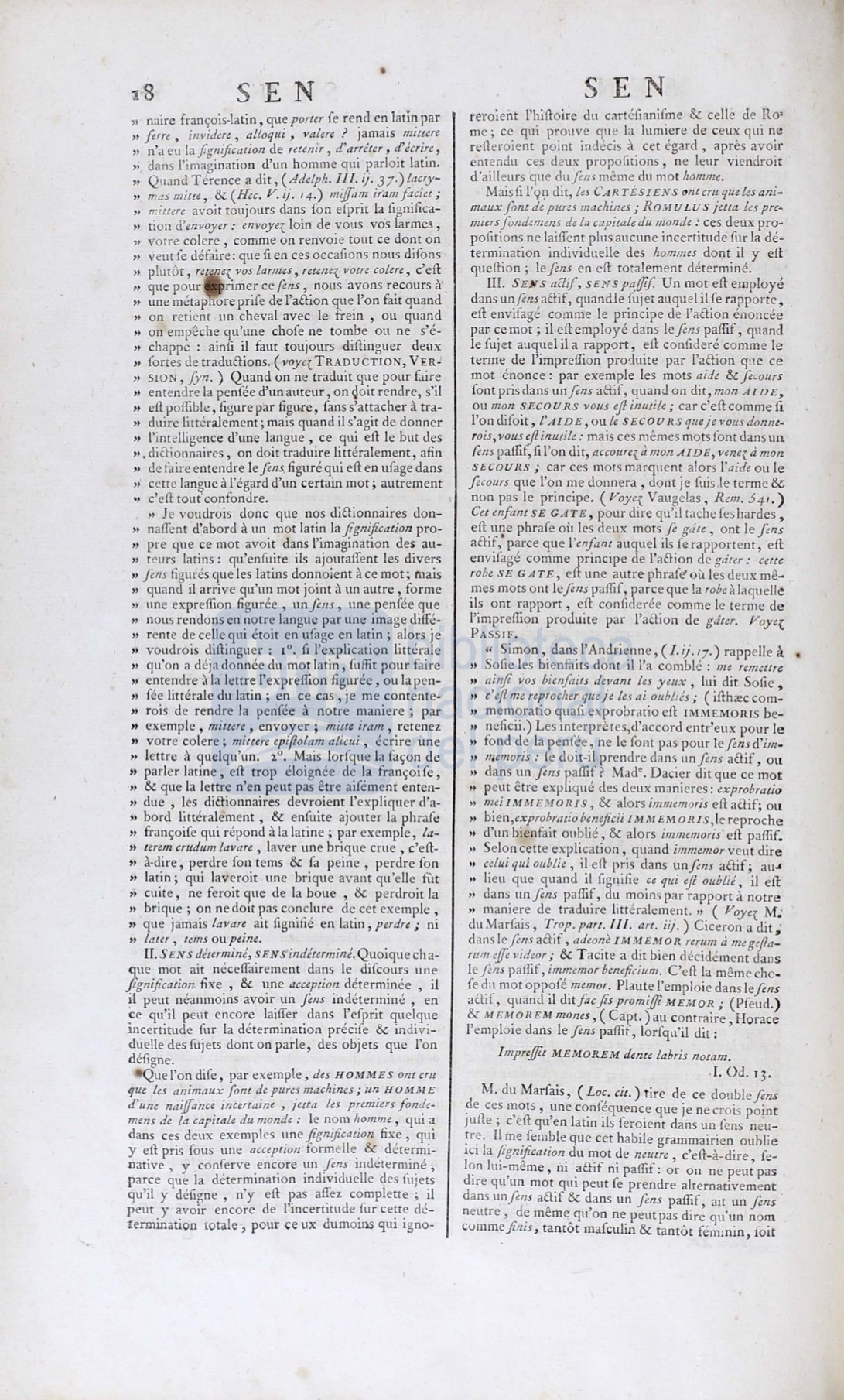
18
SEN
" naire franc;ois·latin , que
porter
fe
re~d e~ lati~
par
"
forre ,
invidere , alloqui, valere
? jamals
m¿ltere
" n'a eu la
jignijiealirm
de
,.anir,
d'
a~rtter
,
<!
écri,:e ,
,. dans I'imaginarion d'un homme
ql11
parlolt latm.
.. Quand Térence a die,
(Adelph.
I1f. ij.
37· )lae ry –
" maS mille ,
&
(Hee.
V.
ij. 14. )
miffa,~
iram fo.ciet ;
" miuere
avoit toujours dans fo n efpnt la úgru!ica–
" tion
d'envoyer: envoye{
loin de vous vos larmes ,
" votre colere , comme on renvoie tout ce dont on
" vellt fe défaire: que ú en
ces
occaúons nous difons
" pluto! ,
rel ne{ vos larmes, retene{ votre eolere,
c'ell:
" que pour
rimer ce
(ens,
nous avons recours
a',
" une métap ore prife de l'aél:ion que I'on fait quand
" on rerient un cheval avec le frein , ou quand
" on empeche qu'une chofe ne tombe ou ne s'é–
" chappe : ainú il faut tOlljours diíl:ingller deux
" fortes de traduél:ions.
( voye{
TRADUCTION, VERJ
" SION,
fyn .
)
Q uand on ne traduit que pour faire
" entendre la penfée d'un aureur , on Qoit rendre, s'il
" eíl: poffible, figure par
!igu.re, fans s'attacher a tra–
" duire littéralement ; mais quand il s'agit de donner
" I'intelligence d'une langue , ee qui ell: le but des
". diél:ionnaires, on doit traduire littéralement , afin
" de faire entendre le
flns
figuré qui eíl: en ufage dans
,,' cerre lan&ue
a
l'égard d'un certain mot ; autrement
" c'ell: tout confondre.
\
" Je vOlldrois done que nos diél:ionnaires don–
" nalTent d'abord
a
un mot larin la
fignijieation
pro–
'1
pre que ce mot avoit dans I'imagination des au–
" teurs larins : qu'enfuite ils ajoutaífent les divers
" j efls
figurés que les latins donnoient
a
ce mot ; mais
" quand il arrive qu'un mot joint a un autre , forme
" une expreffion figurée ,
un ftns,
une penfée que
" nous rendons en notre languc par une image diffé–
" rente de celle qlú étoit en ufage en latin ; alors je
" voudrois dill:i nguer:
l°.
fi I'explication littérale
" qu'on a déja donnée du mot latin, fuffit pOllr faire
" entendre
a
la lettre l'expreffion figurée, oula pen–
" fée littérale du larin ; en ce cas ,je me contente–
" roís de rendre la penfée a notre maniere; par
;, exemple ,
miltere ,
envoyer ;
mille iram,
retenez
" votre colere;
miaere epiftolam alicui,
écrire une
" lett re a quelqu'un,
2°.
Mais 10rCque la fac;on de
" parler latine, eíl: trop éloignée de la franc;oi fe,
." &
que la lettre n'en ¡¡eut pas etre aifément enten–
" due , les diél:ionnaires devroient l'expliquer d'a–
" bord littéralement,
&
enCuite ajou ter la phrafe
" franc;oife qui répond ala latine; par exemple,
la–
" terem crudum lavare,
laver une brique crue , c'ell:–
" a·dire, perdre fon tems
&
fa peine, perdre fon
" latín ; qui laveroit une brique avant qu'elle ñlt
" cuite, ne feroit que de la boue ,
&
perdroit la
" brique; on ne doit pas eonclure de cet exemple ,
)) que jamais
lavare
ait fignifié en latin ,
p erdre ;
ni
"
laur, tems
ou
peine.
II. S
ENS determiné, SENsindéterminé.
Quoique eh a–
que mor ait nécelTairement dans le di(cotlrs une
.Jignification
fi.xe,
&
une
acceptÍon
déterminée , il
il peut néanmoins avoir un
fiflS
indéterminé, en
ce qu'il peut encore lailTer dans I'efprit quelque
lncerritude fur la détermination précife
&
indivi–
duelle des Cuj ets dont on parle, des objers que I'on
déíigne.
Que I'on dife, par exemple ,
des HOMM ES Ollt cru
que tes animaltx jOn! de purls machines; un HOMME
d'une naiffanee ineertaine
,
jetta les premiers fonde–
mens de la capitale du mOflde:
le nom
Itomme,
qui a
oans
ces deux exemples une
fignijica/Íon
fixe, qu i
y
ea
pris fOtls une
acception
formelle
&
détermi–
n ative,
y
conferve encore un
fins
indéterminé ,
paree q le la détermination individuelle des fujets
Cju'il
y
déíigne , n'y ell: pas alTez complette ; il
peut
y
avoir encore de I'incertitude fur cene dé–
terminaúon totale, pour
~e
ux dumoins qui igno-
SEN
feroient l'hill:oire du cartéfiani(me
&
cellé de Ro'
me; ce qui prouve que la lumiere de ceux qui nc:
reíl:eroient point indécis
a
cet égard, apres avoit
entendu ces deux propoíitions, ne leur viendroit
d'ailleurs qHe
dufins
meme du mot
homme.
Maisli 1'9(1 dit,
t.s CARTÉSIENS ont cruqueles ani–
maux jont de pures machines ; ROMULUS ¡ella les pre–
miers fondUlzerls de la eapitaledu monde.'
ces deux pro–
pofltions ne lailTent plus aucune incertitude fur la dé–
termination individuelle des
hommes
dont il y eít
quell:ion;
lelms
en ell: totalement déterminé.
lII.
S EJ/S aaif, SENS pa/Ji/.
Un mot ell: ernployé
dans unfiflsaél:if, quandle fujet auquel il fe rappone, .
ell: envifagé comme le principe de l'aél:ion énoneée
par, ce mot ; il eíl: employé dans le
fins
paffif, ql1and
le fuj et auquel il a rapport, eH conÍlderé 'comme le
tenne de I'impreffion pro-:luite par I'aél:jon q ue ce
mot énonce : par exemple les mots
aid.
&
ft cours
font pris dans
un fuzs
aaif, quand on dit,
mon
Al
DE,
ou
mon S..ECO URS vous
ejl
inutÍle;
car e'ell: eomme
íi
1'0ndiCoit,
l'AIDE,ou le SECOvRsquejevousdonne_
rois,vous e(l inl/tile:
mais ces memes mots font dans un
fens
pafIi(, fi I'on dit,
accoure{
el
mon AIDE, venez
ti
mon
SECOURS;
car ces mots marquent alors
r aide
ou le
ftcours
que I'on me donnera , dont je
fuis.leterme
&
non pas le principe.
(Voye,-
Vaugelas ,
R em, 54 1. )
Ca enfan! SE GATE ,
pour dire qu'jl tache fes hardes ,
ea une phrafe oliles deux mots
fi gáte ,
ont le
ft ns
aél:if; paree que
I'enfant
auquel jls fe rapportent, ell:
envifagé comme principe de l'aél:ion de
galer:
eeu~
robe SE
G
ATE,
eil: une autre phrafe' ollles deux me–
mes mots ont
lej ens
p-affif, paree que la
robe
a
laquellé
ils ont rapport, ell: confiderée oomme le terme de
l'impreffion produite par l'aél:ioll de
gatero Voye{
PASS1F,
«
Simon , daos l'Andrienne,
(1.
ij.IJ.)
rappelle
a .
H
Soíie les bienfaits dont ill'a comblé :
me remettre
H
ainfi 1I0S bienfoits devant les y eux
lui dit SoÍle
H
c'eft me reprocher que je les ai oubliés
~
(iíl:h¡ee
com~
H
memorario quafi exprobrario ell: IMMEMORIS be–
H
neficii.) Les interpretes,d'accord entr'eux pour le
H
fond
d~
la
penf~e.'
ne le fOHt pas pour Ieftns d'im–
H
rr¡emons :
le dOlt-11 prendre dans un
ftns
aél:if, Ol1
H
dans !:l11
fins
~affi!?
Mad
e
•
Daci
7
r dit que ce mot
H
peut etre explique des deux ma11leres :
exprobratio
" moiIMMEMORIS,
&
alors
immemoris
ell: aél:if· on
" bien,exprobratio beneficii
1
MM EM ORI S
le
repr~che
" d'un bienfait ou?lié?
&
alors
;,nmemo:is'
eíl: paffif_
" Selon cette expilcatlOn, quand
immemor
veut dire
H
c.elui qui oubli.
,
i~
ell: pris dans
u nftns
aél:if; au"
H
heu que quand
11
Í1gnifie
.ce qui
ejl
oublié,
il efr
" dans un
fins
paffif, du mOlns par rapport
a
notre
"
manie~e
de traduire littéralement." (
Yoye{
M:
du Marf¡us,
T rop. part. lIl. artoiij.
)
Cieeron a dit '
dans le
ft~s
aél:if,
adeone
1l.1
~E~OR r~r~lm,
ti
megejla~
rum
effi
vldeor ;
&
T aclte a dlt bIen decldement dans
le
jims
paffif,
immemor beneficium.
C'eil: la meme
eho~
fe
~u
mot
oPP?fé.memor.
Plaute I'emploie dans
leflfls
aél:lf, quancl ll dltfoc
fis promijJi MEMOR;
(Peeud .)
&
MEMOREM mones,
(Capt. ) au cono'aire Horace
I'emploie dans le
ftns
paffif, lor[qu'il dit : '
l mpreffit MEMOREM dente labris fl otam.
1.
Od. 13.
M. du Marfais,
( Loe. cit.
)
tire de ce double
ftns
?e ces mots , une conféquence que je ne crois point
Juíl:e ; e'ell: qu'en latin ils Ceroiem dans un fens ne'u–
~r~.
II
me. fem? le que cet habile giarnmairien oublie
ICI la
fignificatton
du mot de
nelllre
c'eíl:-a-dire fe–
I~n
lUi-,meme, ni .aél:if ni paffif: dr on ne peu; pas
dlre quun motoql1l peut fe prendre alternativement
dans un
flns
aél:if
&
dans un
ftns
paffif ait un
ftns
t
d"
,
neu re,
7
meme. qu on neopeut pas dire qu'un nom
comme
jims ,
tantot mafculin
&
tantot fémi nin, (oír
















