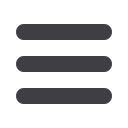
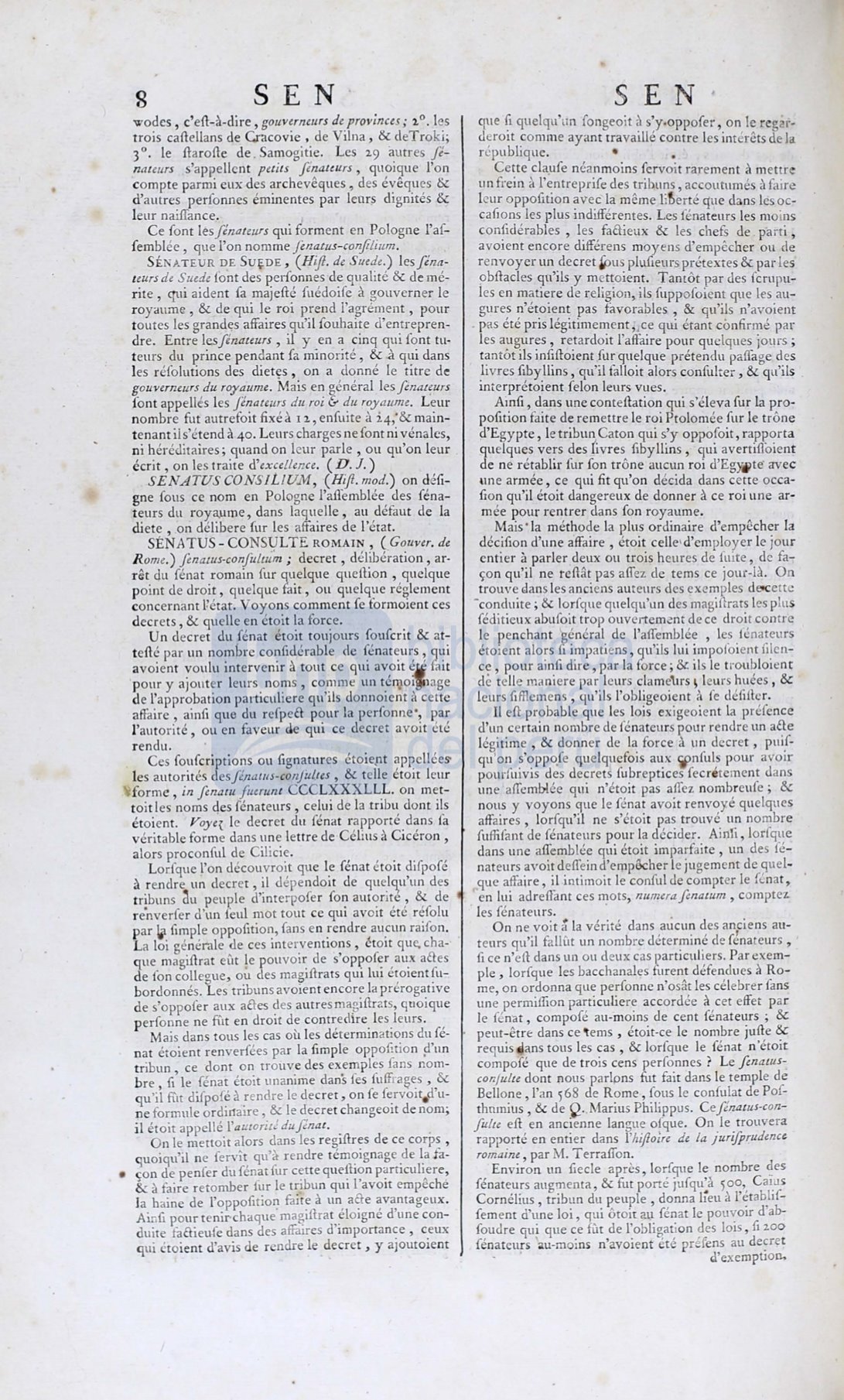
8
S EN
wodcs , e'eí1:-a-dire ,
gouverneurs de provinces;
2.
0 .
les
trois cafiellans de Crncovie , de Vilna ,
&
deTrok i;
3
o .
le í1:arofie de . Samogitie. Les
29
alltres
fé–
naleurs
s'appellent
petils félU1.lWrS ,
quoique r on
compte parmi eux des archeveques , des éveques
&
d'autres perfonnes éminentes par
lenr~
dignités
&
leu r naiíTance.
Ce (ont
lésJénoteurs
qui forment en Pologne l'af–
femblée , que ron nomme
jenatus-confLium.
SÉNATEUR DE
SU ~DE ,
CHifl.
de SlIede .)
les
J éna–
tellrs de Suede
{ont des perfonnes de qualité
&
de mé–
rite , qui aident fa majeí1:é {uédoife
a
gouverner le
royaume ,
&
de qui le roi prend I'agrément , pour
toutes les
grand~s
affaires qu'il fouhaite d'entrepren–
dre. Entre
lesJ' nateurs
,
il
Y
en a einq qui font tu–
tell rs du prince pendant fa mÍnorité ,
&
a
qui dans
les ré{olutions des
di et~s ,
on a donné le titre de
gOllverneurs du royaume.
Mais en général les
fenat~lIrs
font appellés les
J énateurs du roi
&
du royaume.
Leur
nombre fut autrefoit fixéa
12,
enfu ite a
i 4,'&
main–
tenant ils'étend a
40.
Lel.1rs charges ne font ni vénalcs,
ni héréditaires; quand on leur parle , ou ql.1'on leur
écrit , on les traite
d'excellence.
(D.
J.)
SENATUS CONS lLIUM ,
CHifI.
mod.)
on défi–
gne fous ce nom en Pologne I'aíremblée des féna–
teurs du roya.ume, dans laq uelle, au défaut de la
diete, on délibere fur les affaires de l'érat.
SÉNATUS - CONSULTE
ROMAIN ,
( Gouver. de
R ome.) fenams.conJultu'm ;
decret, délibération , ar–
r at du fé nat romain fur quelque quefiion , quelque
point de droit, quelque fait, ou quelque réglement
concernant I?érat. Voyons eomment fe formoient ces
decrets ,
&
quelle en étoit la force.
Un decret du fénat étoit touj ours fouferit
&
at–
teí1:é par un nombre eonlidérable de fénateurs, qui
avoi ent youlu intervenir
a
tOut ce qui
av~it ~¡,f
fait
'pom y a)ollter lems noms , comme un
te'V0I~i1age
de l'approbation particuliere qu'ils donnoient
a
certe
affaire, ainli que du refp eé} pour la perfonne-, par
l'alltorité , ou en favellr de qlli ce decret avoit été
rendll.
Ces foufcriprions ou lignatllres étoie,nt appel1ées–
les autorités
desJ bzallls-conJultes,
&
telle étoit leur
forme,
in fenaw fmrunt
CCCLXXXLLL. on met–
toit les noms 4es {énateurs , cellli de la tribu dont ils
étoient.
Voye{
le decret du {énat rapporté dans {a
véritable forme dans une lettre de·Célius
iI
Cicéron ,
alors procon{lll de Cilicie.
Lorfque l'on découvroit que le fénat étoit di(po(é
a
renclre un decret
,y
dépendoit de qlle,lC),u'un des
tribuns
~u
peuple d Interpo(er fon alltonte ,
&
de
re'nverfer d'un feul mot tout ce qui avoit été ré(olu
par
ijI
limpIe
oppolitio~,
fans en .rendre,au.cun rai{on.
La loi générale de ces mterventlons, eroa que, cha–
que magifirat ellt le pouvoir de s'oppo(er aux aé}es
de fon colleaue, ou des magifrrats qu i lui étoient
(1I–
bordonnés.L es tribuns avoient encore la prérogative
de s'oppo(e r aux aé}es des autresmagifirats, qUOiqlIe
per(onne ne fUt en droit d;
cont~edire.
les.leurs . ,
Mais dans touS les cas ou les determmatlons du (e–
nat étoi ent renverfées par la limpie oppofition ?'lln
tribun ce dont on trouve des exemples (ans nom–
bre
¡j'
le fénat 'roit unanime dans (es
(u ffra~es
>
&
qU'ii ñlt
di(po{~
a
.rendre le decret, on (e
f~rvoit.d'll
ne formule ord1l1alre ,
&
le decret changeolt de nom;
il ' toit appellé
l'auloritJ duf/nat.
.
.
n le mertoit alors dans les regifires de ce corps ,
uoiqu'il ne (ervlt, qu'1t rendre tém?ignage .de I.a
f a-
• ,>on de penfer du fenat fur cette
que~h?n p~rncul~ere?
& iI
fai re retomber {m le tnbun
qUl
I avolt empeche
la baine de
I'oppolitio~ fair~
a
un,
a~e ~va,ntageux .
Ainfi pour tenll'cbaque
ma&lfira\~IOlgne
d une con–
duite fa é}ieu-(e dans des affaires d Importance , ceme
qui 'toienr d'avis de r ndre le decret , y ajoutoient
SEN
que
~l
que1qu'un fo ngeoit a s'y.oppofer , on le reO'ar–
derolt comme ayant rravaillé colJtre les intérets de la
république.
•
•
Cette cla.u(e néanmoins (ervoit rarement a mettr
un frein 11 I'entreprife des tribuns , accoutumés
a
fai re
lcur oppoíirion avec la meme
li~erté
que d ns les oc–
caíi ons les plus indifférentes. Les fénateurs les moins
con!idérables ,
l~s ,
faétieux
&
les chefs de parti,
aVOlent encore dIfferens moyens d'empecher ou de
renvoyer un decret ¡pus plufieurs prétextes
&
par les
9 bí1:acles q(¡'ils y mettoient. Tantot par des fcrupu–
les en matiere de religion, ils (uppofoient que les au–
gures n'éroient pas f¡:¡yorables ,
&
qu'ils n'avoient
. pas été pris légitimement " ce qui étant confirmé par
les augures , retardoit I'affaire pour qu elques jo urs ;
tantót ils iníiíl:oient
(Uf
quelque prétendu paífage des
livres fibyllins, qu'il falloit alors confulter ,
&
qll'ils
interpréroient felon leurs vues.
Ai nfi , dans une conteí1:ation qui s'éleva (ur la pro–
pofition fai te de remettre le roi Ptolomée {ur le trone
d'Egy pte , le tribun Caton qui s'y oppo(oit, rapporta
quelques vers des (¡vr es íibyllins , qui avertiíloient
de ne rétablir fm (on n one aueun roi d'EgYjlte' avec
une armée, ce qui fit qu'on décida dans cen e occa–
fion qu'il étoit dangereux de donner
a
ce roi une ar–
mée pour rentrer dans fon royaume.
Mais ' la méthode la plus ordinaire d'empecher la
décilion d'une affaire, étoit celle' d'employ er le jou.
entier 11 parler deux ou trois heures de fuite, dc fa–
c;:on qu'il ne refiat pas aífez de tems ce jom -Ia. On
trouve dans les aociens autenrs des exemples deocette
~conduite ;
&
lor(que qll elqll'un des magifirats les plus
féditieux abllfoit trop ollvertement de ce droit contre
le penchant 'général de I'aífemblée , les fénateurs
étoient alors
Ii
impatiens , qu'ils lui impofoient íilen–
ce, pour ainli dire, par la force;
&
ils le troubloient
de telle maniere par lems c1ametlrs I leurs huées ,
&
lellrs íimemens , qll'i ls l'obligeoient
iI
(e déíifier.
Il efi probable que les lois exigeoient la préfenee
d'un certain nombre de fénateurs pour rendre un aé}e
Iégitime ,
&
donner de la force
a
un decret, pllif–
qu'on s
'oppo.feqllelqllefois allx
~nfuls
pour avoir
pour(uivis des decrets fubreptices (ecrétement dans
une aífemblée qui n'étoit pas aíTez nombreu(e ;
&
nous y voyons que le {énat avoit renvoyé quelques
affaires , lor{qu'il ne s'étoit pas trouvé un nombre
fuffifa nt de {énateurs pour la décider. Ainfi , lorfque
dans une aíTemblée qlli étoit imparfaite, un des fé–
nateurs avoit deffein d'empocher le jugement de quel.
que affaire, il intimoit le con(ul de compter le fénat ,
en lui ad reílant ces mots,
numerafenatum ,
compte7.
les (énateurs.
.
On ne voit
á
la vérité dans
a~cun
des anciens au–
tenrs qu'il fallí'lt un nombre déterminé de (énateurs ,
Ii
ce n'efr dans un ou deux cas particul iers. Par exem–
pie , lor(que les bacchanales fu rent défendues
a
Ro–
me, on ordonna que perfonnc n'os!h les célebrer fans
une permifIion particuüere accordée
a
cet e/fet par
le (énat , compofé au-moins de cent fénateurs ;
&
peut-etrE: dans ce 'tems , étoit-ce le nombre jufie
&
requis ans tous les eas ,
&
lor(que le fénat n 'éroit
compoTé que de trois cens per(onnes
?
Le
fenalus–
conJulle
dont nous parlons tilt fait dans le temple de
Bellone , l'an 568 de Rome , fous le con{ulat de Pof–
thnmius,
&
de
Q..
Marius Philippus.
CeJ.!!lAtlts.con–
Jufte
efr en an cienne langue ofque. On le trouvera
rapporté en enrier dans
l'hijloire de la jurifprudm ee
romaine ,
par M. Terraffon.
Environ un lieele apres , lor(que le nombre
~es
{énateurs augmenta,
&
fin porté ju(qu'a
50 0,
Cal.usCornélíus, tribun du peuple , donna líeu
a
I'étabh(–
{ement d'une loi , qui otoit au (énat le pouvoir d'ab–
{oudre qui que ce
fLIt
de I'obligatíon des
101S ,
íi
200
fénateurs OIu-moins n'avoient ét ' préfens au
de~ret
d'exempuon.
















