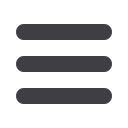
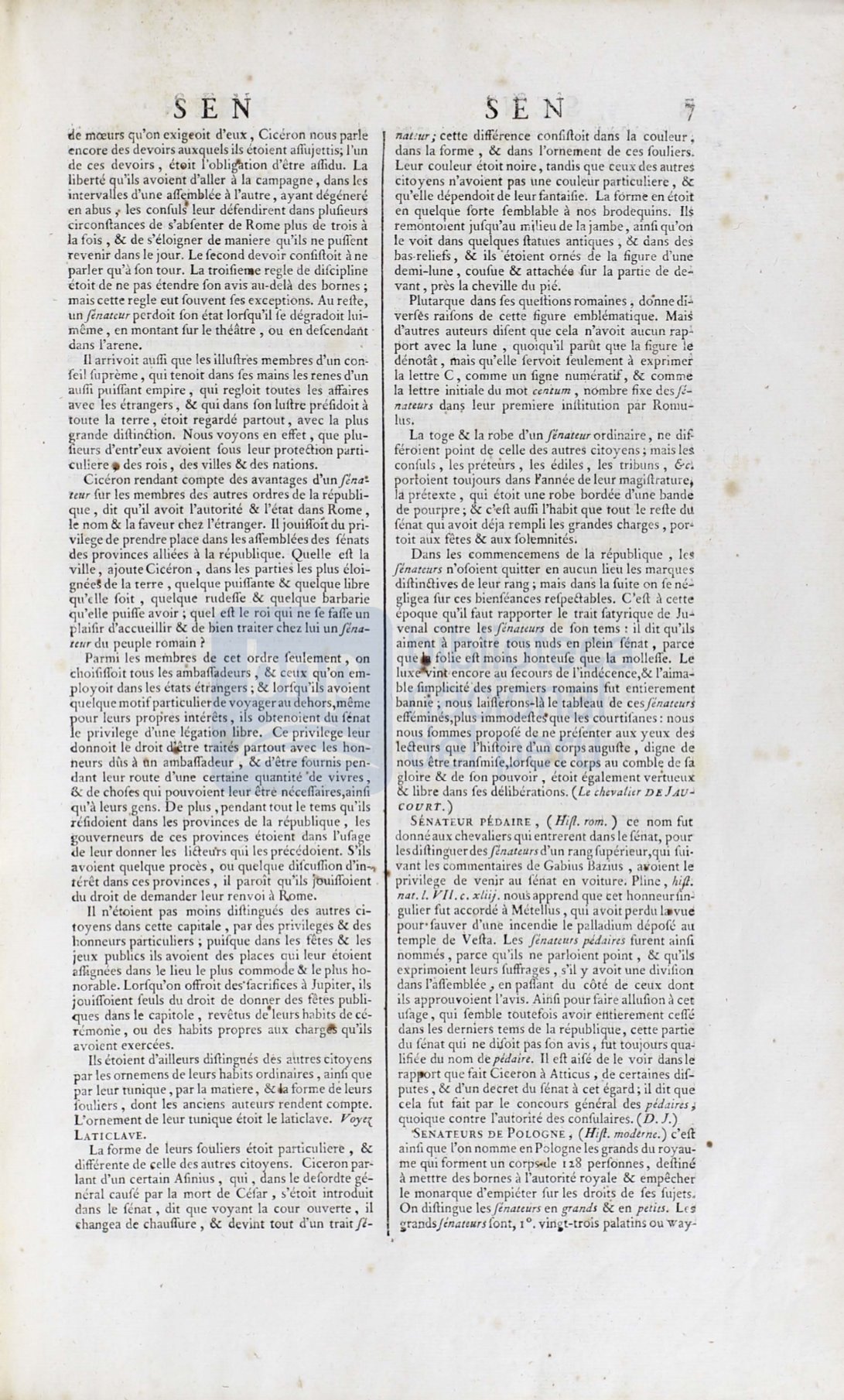
.S E N
~e
rnrems qu'on exigeoit d'enx, Cicéron IlOtlS parle
~ncore
des devoirs auxquels ils étoient alfuj enis; l'un
de ces devoirs,
ét~ir
l'oblig"arion d'erre aílidu. La
liberté qu'ils avoient d'aller
a
la campagne, dans
les
intervalles d'une alfeinblée a l'autre, ayant dégéneré
en abus " les confull leur défendirent dans plufieurs
circonfiances de s'abfenter de Rome plus de trois
a
la
fois , & de s'éloigner de maniere qu'ils ne pulfent
revenir dans le jour. Le {econd devoir coníifioít
a
ne
parl er qu'a Con tour. La troifiellle regle de difcipline
étoit de ne pas étendre fon avis ·au-dela des bornes ;
mais cette regle eut fouvent {es exceptións. Au refie,
un
flnauur
perdoit Con état lorfqu'il fe dégradoit lui–
meme, en montant {ur le
thé~tre
, ou en defcendañt
dans l'arene.
Il
arrivoit auíli que les illufires membres d'un con–
{eil fu preme , qui tenoir dans fes mains les renes d'un
_ aulTi pui{fant empire, qui regloit toutes les alfaires
aveo les étrangers, & qui dans fon lufl:re préíidoit
a
toute la terre, étoit regardé partout, avec la plus
grande di íl:inél:ion. Nous voyons en elfet, que plu–
fieurs d'entr'eux avoient {ous leur proteéhon parti–
cuEere des rois, des villes & des nalÍons.
Cicéron rendant compte des avantages d'un
féna!
1eur
Ülr les membres des autres ordres de la républi–
que , dit qu'il avoit l'autorité
&
l'état dans Rome ,
le nom
&
la faveur chel l'étranger.
n
jouiJroít du pri–
vilege de prendre place dans les a/remblées des {énats
des provinces alliées a la république. Quelle efi la
ville, ajoute Cicéron , dans les parties les plus éloi–
gnéd de la terre , quelque puiífante & quelque libre
qn'dle {oit , quelque rude{fe & quelque barbarie
<]u'elle pui.ífe avoir; quel efi le roi qui ne fe falfe un
plaifir d'accueillir & de hien traiter chez lui
unféna–
twr
du peuple romain
?
Parmi les meinbres de cet ordre {eulement, on
choiíilfoit tous les
a~balfadeurs
, & cetlx qu'on em–
p loyoir dans les états étfangers ; & lor{qu'ils avoient
quelque motif partitulierde voyagerau dehors,meme
p our leurs propres intéd!ts, ils obtenoient du fénat
le privilege d'une légatidl1 libre, Ce privilege leur
donnoit le droit
~tre
traités partout avec les hon–
heurs dllS
a
un ambalfadeur , & d'etre fournis pen–
dant lem route d'une certaine quantité 'de vivres,
&
de chofes qui pouvoi ent leut' erré nécelfaires,ainfi
qu'a leurs .gens. D e plus, pendant tout le tems qu'ils
r éfidoient dans les provinces de la république, les
gouverneurs de ces provinces étoient
da.nsI'ufage
oe leur donner les lifrellrs Ejui les précédoient. S'tls
avoient quelque proces, ou quelque difcuilion d'in.,.,
t éret dans ces provinces, il parolt quJils ¡Ouilfoient .
ou droit de demander leur renvoi a Rome.
n
n'étoient pas moins difiingués des autres ci–
toyens dans cette capitale , par des privileges & des
llonneurs particuliers ; puifque dans les retes & les
jeux vublics ils avoient des places qu i leur étoient
affignees dans le lieu le
~lus
comn:ode
&
le
p~us
h.o–
norable. Lorfqu'on olfrOlt des'facnfices
a
Jupller, lIs
jou ilfoient {ellls du droit de donner des fi!tes publi–
ques dans le capitole, revetLls de'leuts habits de cé–
r émonie, ou des habits propres allx
charg~
qu'ils
avoient exetcées.
lis étoient d'ailleurs difiingl1és des antres citoyens
par les OTnemens de leurs habits ordinaires , aif!fi que
par leur tu nique, par la matiere,
& ' a
forme de leurs
{onliers , dont les anciens auteurs tendent compte.
L'ornement de leur tunique étoit le laticlave.
V oye{
L ATI CLAVE.
La forme de teurs foüliers étoit particuliere,
&
dilférente ele celle des autres citoyens. Ciceron par–
lane d'un certain Afinius, qui, dans le defordte gé–
néral caufé par la mort de Céfar , s'etoie introduit
dans le fénat , dit que voyanr la cour ouverte , il
hangea de chaulfure , & devint tout d'un erait
ji-
ltflt!ur;
cette dilférence coníifioit
cÍa~s
la cou1eur ;
dans la forme, & dans I'ornement de ces fouJi ers.
Leur couleur étoit noire, randis que ceux des autres
citoy ens n'avoient pas bne couleur particuliere,
&
qu'elle dépendoie de leur fantailie. La fórmé en étoit
en quelqtle fbrte {emblable
a
nos brodequíns.
IlS
remontoient jufqu'au milieu de la jambe, ainfi qu'orl
le voit dans quelques fiatnes antiques ,
&
dans des
bas-reliefs, & ils 'étoient ornés de la figure d'une
deini-lune, coufue
&
attachéa
.fm
la panie
de
de':'
vant, pres la cheville du pié.
Plutarque dans fes quelnons romaines , do"nne
di.!.
verfés raifons de cette figure emblématigue. Mais
el'autres auteurs difent que cela n'avoit aucun rapé
port avec la lune , quoiqu'il paríh que la figure
le
dénodit, inais qu'elle fervoit feulement
a
exprimef
la lettre C, comme un figne nUl11ératif,
&
comme
la lettre iniriale elu mot
cenium
,
nombre fixe des
fl–
nateurs
d.an~leur premi ere inítiturion pár ROlllu–
lns.
La toge & la robe d'un
ftnaieur
ordinaire , ne dif–
férdi erlt point de celle des autres citoyens; ¡llais les
confuls , les prétellrs, les édiles , les tribuns ,
&c:
porroient toujours dans Yannée de leur magifirature¡
la prétexte, qui étoit une robe bordée d'une bande
de pourpre;
&
c!efi auili I'habit que tout le refie dll
fénae qui avoit déja rempli les grandes charges , por·
toie aux fetes & aux {olemnités;
D ans les commencemens de
l<i
république ,
Ir
fénawm
n'ofoient quitter en aucun liel.! les marques
difiinfrives de lem rang; mais dans la {uite on fe né;
~Iigea
fur ces bienféances refpefrables. C'eO:
a
certe
epoque qu'il faut rapporter le trait fatyrique de
Ju~
venal contre les
jénateurs
de fOh tems : il dit qu'ils
aiment a paro¡tre tous nllds en plein {énat, parce
qué. folie efi moins honteufe que la mollelfe. Le
luxe"vint·encore au fecOllrs de l'indécence,&
l'aima~
ble fimplicité 'des premiers romains fut ertrierement
bannie ; nous lai/lerons-liI le tableau de
cesfén.ateurs
elféminés,plüs
immodefie~que
les courtifanes: nous
nous fommes propofé de ne préfenter aux yeux des
lefrems que l'hifioire d'un corps augufie , digne de
nous etre tranfmife,ldrfqu e ce corps au comble de fa
gloire & de fon pouvoir , étoit également vertueux
&
libre dans {es délibérations.
(Le
chevlltúr DEJAU.J
COURT.
)
SÉNATEUR
PÉDA IRE,
(Hi(l.
rom. )
t e nom fut
donnéaux chevaliers qui entrerertt dans le (énae, pour
les difiing'uerdesjirzateursd'un rang fup érieur,qui fui·
vanr les commentaires de Gabius Ba1.Íus , avoient le
privilege de venir au /enat en voitllre. Pline,
lújl:
nat:
l. VII.
c.
xli~. nou~ ap~rend
que ttt;t honneur fin–
guher fut accorde
iI
Metellus, qll1 avolt perdulatvue
pour' fauver d'une incendie le palladium
dépof~
au
temple de Vefl:a. Les
fénate/1Ts p¿daires
furent ain/i
nommés, paree qll'ils ne parloient point, & qu'ils
exprimoient leurs
fulfra~es
, s'il
y
avoit une divifion
dans l'aílemblée ) en pailant du coté de ceux dont
ils approuvoient l'avis. Aihli pour faire allufion
a
cet
u(age , qlli femble tOutefois avoir ef1tierement celfé
dans les dern:ers tenlSde la république, cette partie
du fénat qüi ne di.foit pas fon avis
j
fut toujours
qlla~
lifiée du nom de
pldai".
Il
efi aifé de le voir dans le
rap['Ort que fa it Ciceron
a
Atticus ,
pe
certain es
dif~
putes , & d'un decret du fénat
a
cet égard; il dit que
cela fu t fait par le concours général des
pldaires
J
quoique contre I'autor:té des confulaires.
(D.
J.)
EN.ATEU RS DE POLOGNE
j
CHifl.
moderne.)
c'eí!:
ainli que l'on nomOle en Pologne les grands du royau- -
me qui forment un corps-ue r
18
perCónnes, deO:iné
a mettre des bornes
a
l'autorité royale & empecher
le monarque d'empiéter fur les droit.s de fes fujets.
On di/lingue
lesflnateurs
en
grandl
&
en
petill.
Les:
grands
jénaaurs
[ont,
10.
vin¡t-trois palatins ou way-
















