
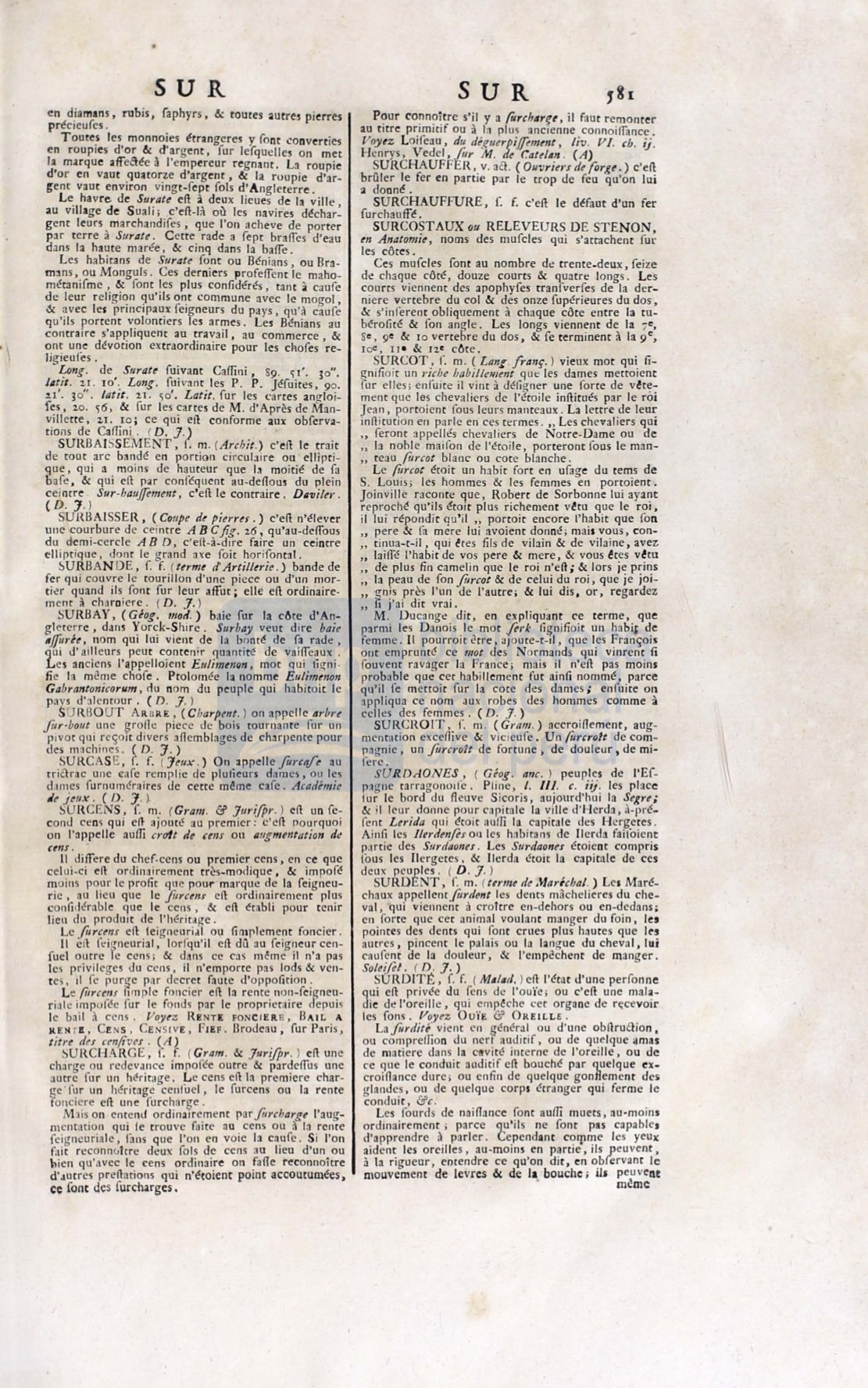
\
S U R
en diamans, rubis
1
faphyrs ,
&
toutes ;urres pierres
prédeufes .
Toutes les monnoies étrangeres
y
font coaverries
en roupies d'or
&
d'argent, fur lefquelles on rnet
la marque ;tfeéiée
a
l'empereur regnant. La roupie
d'or en vaut quatorze d'argent ,
&
la ruupie d'ar–
gent vaut environ vingt-fept fols d'Angleterre.
Le havre de
Sttrate
ell:
a
deux licues de la ville
au village de S uali ; c'ell:-la ou les navires
déchar~
g ent leurs marchandifes , que l'on acheve de porter
par tcrre
i\
Surate .
C ette rade a fept braífes d'eau
dans la haute rnarée ,
&
dnq dans la baífe .
Les habitans de
Surate
font ou llénians ou !Jra–
mans , ou Monguls. Ces derniers profeífent Íc maho–
rnét:lnifme,
&
font les plus confidérés, tant
¡¡
caufe
de leur rclig ion qu'ils ont commune avec te mogol
~
,avec les principau_x feigneurs du pays, qu'a ca
uf~
q u ds porrent volonners les armes . Les Bénians au
contraire s'appliquent au travail , au commerce
&
ont une dévotion extraordinaire pour les cl'lo!'es 're–
Jig ieufes.
f:ong .
de ,
Surate
fu~vant
Caffini ,
89.
s
t'.
30".
~~~11. ~,r.
10 ..
L011g.
f?• vanr_les P. P. Jéfuites,
90 .
.u.
30 .
lattt.
2t.
so .
Latrt.
fur les <.:artes angloi–
fes,
20.
s6 ,
&
[ur les carees de M . d' Apres de Man–
vill ette,
2t.
ro¡ ce qui etl conforme ;ux obferva-
tions de Canini .
( D.
J.)
·
SURIJAISSEMENT,
í.
m.
{Arcbir.)
c'en le trait
de cout are bandé en portion circulaire ou ellipti–
que, qui a moins de haureur que la moitié de fa
bafc
1
&
qui ell: par conféquent au-dellous du plein
ceinrre
Sur-bauffiment,
c'en le contraire.
Dt~vi/e¡·.
(D.
J.)
V
RllAlSSER, (
Co11pe de pierre;. )
e•en n'élever
une courbure de ceintre
A 8 C
fig.
26,
qu'au-deífous
du demi-cercl e
A 8 D,
c'ell:-ii-d•re faire un ceinrre
ell iptique , dont le g rand axe foit hori(ontal .
~URIJAN DE,
f.
f. (
terme
d'
Artillerie. )
bande de
fer qui couvre le courillon d'une píccc ou d'un mor–
ti¿r quand ils font fur leur affur; elle ell: ordinaire–
menr
i\
charoiere.
( D.
:J. )
SURIJAY, (
Géog. moti. )
baie fur la cOte d'An–
glererre, dans Yorck-Shire .
Sttrbay
veut dire
baie
&jfi,·ée,
nom qui lui vient de la boncé de fa rade ,
qui d' ailleurs peut contenir c¡uanrité de vaiífeaux .
L es anciens l'appelloient
Eulimmon,
mor qui tigni–
fie la meme chofe . Ptolomée la nomme
Eulimenon
Gabrantonicorum ,
el
u nom du peuple qui habitoir le
pays d'a lenrour . (
D.
J.
)
SU RBO UT AR BRE , (
Cbarp_ent.)
on appelle
11rbre
fi~r-bout
une
~rolle
piece de bois rournante fur un
p1vor qni
re~01t
divers afl emblages de charpence pour
des
machin~s .
(D.
J.)
SURCASE , f. f.
( Jeux . )
On appellefltrcife au
triélrac une eafe rempl ie de plutieurs dames, o u les
dames furnum éraires de cette
m~
me cafe.
Académie
le jmx .
(D.
J. ~
SURC ENS,
[.
m.
(Gram.
&
Juri.fpr. )
ell: un fe–
conu
ceo~
qui efl ajomé au premier : e•en Pourquoi
on l'appelle auffi
crll1t de cms
ou
tmg•nentation
d~
ctnr .
ll differe du chef.cens ou premier cens, en ce que
cel ui-ci ell: ordinairement tres-mo<lique,
&
impofé
moins pour le profit que pour-marque de la feigneu–
ric , au lieu que le
Jitrtms
ell: ordinairement plus
confidérable que le cens ,
&
ell: érabli pour tenir
lieu du produit de l'héricage .
Le
ji1runs
en !eig neurial ou fimplement foncier .
11
ell: feig neurial, lorfqu'il ell: du au [eigneur cen–
fuel oucre fe cens;
&
dans ce cas mém e il n'a pas
les privil eges du cens , il n'emporte pas lods
&
ven–
tes,
il
fe purz e par decret faute d'oppo!irion .
Le
(itrcm s
hm ple foncier en la rente non-feigneu–
riale impofée fur le fonds par le proprietaire áepuis
le bail
il
cens .
Vo)lez
RENTE FONCIERE, llAIL A
llENTll , CENS , CENSIVE, F1EF . llrodeau, fur Paris,
titre des ccnjives
.
(A)
SURCHARGE ,
f.
f.
( Gram.
&
:Jt~ri.fpr.
l ell: une
charge ou redevance impofée outre
&
pardeífus une
aurrc fur un hérirage . Le cens ell: la premiere char–
ge ' iur un héritage ceniiJel, le furcens ou la rente
fonciere ell: une
furchar~e .
Mais on entenli
ordina~rement
par
fltrcharge
l'aug–
mcntation qui le trouve faite au cens ou
~
la rente
[eig neu riale, lans que l'on en voie
la
caufe . Si l'on
fait reconn<>irre deux fols de cens au lieu d'un ou
bien qu'avec le cens ordinaire on falle re·connoirre
d'aurres prell:arions qui n'étoient poinc accoucumées,
ce font
des
furcharges.
S U R
P~mr co~n~itre
s'il y a
{urchllr!Je,
il
faur remonter
au mre pr.'mmf ou 3 la pl us ancienne connoiífance .
Voyez
Lo1feau,
du dég uerpijfommt, liv. VI. ch.
ij.
H enrys, Vede!,
_{ttr
M .
de Cate/1111 . (A)
SURCHAUFFER, v. aél. (
Ouvriers de (orge.)
c'ell:
brüler le fer
en
partie par le rrop de feu qu'on tui
a donné.
SURCHAUFFURE, [ f. c'ell: te défaut d'un fer
furchautfé.
SURCOSTAUX
ou
RELEVEURS DE STENON,
en Anatomie,
noms des mufcles qui s'attachent fur
les córes.
Ces muícles font au nombre
de
trente-deux, feize
de chaque cóté, douze courrs
&
quatr~
longs . Les
courts viennent des apophyfes tranfverfes de la der–
niere vertebre du col
&
eles onze fupérieures du dos ,
&
s' inferent obliquement
a
chaque cóte entre la tu–
bérofité
&
fon angle. Les longs viennent de la
7•,
S• ' 9•
&
!O
vertebre du dos'
&
fe terrninent
a
la
9°,
100 ,
11 •
&
u •
cOte .
SURCOT ,
r.
m. (
Lan,:. frllnf.)
vieux mor qui fi–
g nifioit un
ricbe habillement
qut les dames mettoient
fur elles; enfilite il vinta défigner une forre de v!re–
ment que les chevaliers de l'étoile innirués par le rói
.Jean, portoient fous leurs manteaux . La lettre de leur
innitution en parle en ces termes , , Les cheval iers qui
, feront appellés chevaliers de Norre-Dame ou de
, la
nohle maiíon de l'étoile, porreront fous le man–
" teau
{ttrcot
blanc o u cote blanche .
Le
{ttrcot
éroit un habit fort en ufage du tems de
S. Louis; les hommes
&
les femmes en porroient.
Joinville raconte que, Roberr de Sorbonne lui ayant
reproché qu'ils éroi t plus richement v!ru que le roi,
il lui répondir q u'il , portoit encore l'habit que fon
, pere
&
ía mere tui avoient donné; mais vous, con–
" tinua-c-il, qui
~res
fils de vilain
&
de vila ine, avez
, lai{fé !'habit de vos pere
&
mere
1
&
vous !res v.!tu
, de plus fin camelin que le roi n'etl;
&
lors je prins
, la peau de fon
Ji•rcot
&
de celui du roi, que je joi–
" gnis pres l'un de l'autre;
&
luí dis, or, regardez
, ¡;
j'ai dit vrai.
_
M . Oucange dit, en expliquant ce terme, que
parmi les Danois le mor
fork
fi~nifioit
un habir de
femme .
11
pourroit erre, a¡oure-t-11, que les
Fran~ois
out emprunté ce
mot
des Normands qui vinrent fi
fouvent ravager la Francc; maís il n'ell: pas moins
probable que cer habillemenr fut ainfi nommé, paree
qu'il fe mettoit fur la cote eles dames; enfuite on
appliqua ce nom aux robes des hommes comme
a
celles des femmes .
(D.
J. )
SURCROIT,
r.
m. (
Gram. )
accroiflement, aug–
mentation exceflive
&
vic1eufe. Un
{urcrolt
de com–
pagnie, un
forcrott
de forrune, de douleur, de mi–
fere.
SURDAONES, ( Géog. anc.
l peuples de l'Eí–
pagne rarragon01fe. Ptine,
t.
/11. c.
iij.
les
place
lilr le bord du lleuve Sicoris, sujourd'hui la
Segre;
&
il leur donne pour
ca
pi tale la vil!e d'Herda, a-pré–
fent
Lerida
qui
~roit
auffi la capitale des H ergeres .
Ain!i les
1/erden.fe.r
ou les habirans de !lerda fai(oient
partie des
Srtrdaones .
Les
Sttrdaones
étoieot compris
tous les Ilergetes,
&
!Jerda éroic la capirale de ces
deux peuples . (
D . :J.
)
SURDENT,
f.
m.
(ttrme de .'r!arhba/. )
Les Maré–
chaux appellentfiirdent les dents machelieres du che–
val, qui viennenc
ii
croirre en-dehors ou en-dedans;
en forre que cer animal voulant manger du foin, les
pointes des dents qui font crues plus hautes que
l~s
aurres, pincenr le palais ou la la ngue du cheval, lui
caufent de la douleur,
&
l'empechent de rnanger .
SolcijCI. ( D . J.)
SURDITE, f. f.
( M11larl.
J
ell: l'état d'une perfonne
qui en privée du fens de l'ou'ie; ou c•en une mala–
die
d~
l'oreille, qui empéche cer organe de r.;:cevoir
les fons .
Voyez
Ou'iE
&
ÜREILLE .
La
fitrditr
viene en général ou d'une obll:ruélion ,
ou compreffion du nerf auditif, ou de quelque
~mas
de matiere dans la e-evité interne de l'oreille' ou ue
ce
que le conduit aoditif en bouché par quelque ex–
croillance dure ; ou enfin de quelque gonflement des
glandes , ou de quelque corps écranger qui ferme le
concluir,
&c.
Les fourds de naillance fonr auffi muers , au·moins
ordinairemenr ; paree qu'ils ne fonr pas capable,
d'apprendre a_ parler. Ce_pendant
C<?rp~e
les yeux
aident les ored les, au-rnoms en parue, ds peuvent ,
a
la rigueur' encendre ce qu'on dit' en obfervant le
mouvernent de levres
&
de la bouchc ; ils peuvent
·
m~me
















