
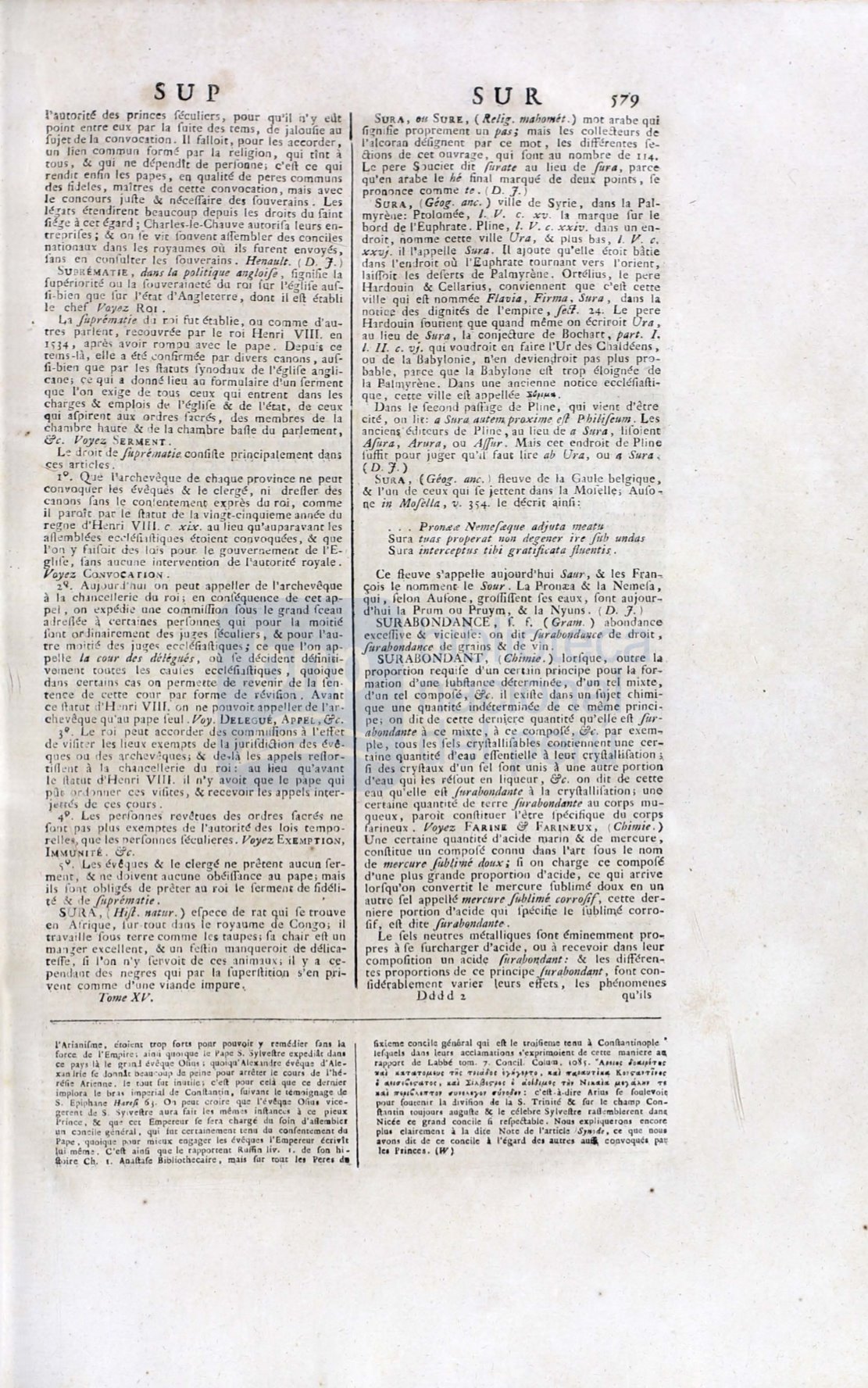
SUP
l'a~coric~
des princes féc.uliers, pour qu'il n' y elle
pomr entre eux par la foue des rems, de jaloulie au
fujet de la convocation .
11
falloi c, pour les accorder
un líen COfr!tDUn formé par la religion , qui cinc
i
rous ,
&
qut ne dépendlt de perfoooe; c'efl ce qui
rend~t
enlin les papes , eo qual ité de peres communs
des fiJeles, fr!l lrres de cetre convocation , mais avec
le concours. ¡ufle
&
nécetraire des fouverains . Les
lé
•us
~rendtrenr
beaucoup de¡JUis les droirs du faint
1il5e
:1
cer
~gard;
Charle<-le.Chauve aurorifa leurs en–
creprifes ;
&
on fe vir foovenr affe mbl er des conciles
'!ation1ux daos les royaumes Ott
ils fu rene envoyés ,
lan~
en Ct>nfulrer les
fouv~r.ains .
Hen.ault .
( D.
J.¡
UPK
~MATIE
,
dt111I la polw que angloifi ,
lignifie la
fu pérmnré ou la Í<•uveratneté du rat fur l'éalife auf–
fi. bien que rur l'état d'Anglererre, done
i1
~ll
écabli
le chef
f/o:¡u.
Rot .
l.,1
foprhncttie
du n i
fue
établie, o u comme d'au–
rres p.trlenr, recouvrée par le roi H enri
V llL
en
J) l4, apre< avoir rompu
avec
le pape. O epuis ce
rems-la , elle
a
été ..:onfirmée par divers canons auf-
1i-bien que par les
fla~u ts
fynod1ux ele l'églife
~ngl i
cane; ce qu t
a
donné lteu ao formulaire
d~un
ferment
que l'on exige J e tous ceux qui encrent dans les
charges
&
emplois d<<
l'é<>life
&
de l'état
de ceu<
qoi afpirent aux Clrdres
ti~r~ ,
des memb'res de la
chambre haute
&
de la chambre baCie du parJement
&c.
f/oy ez
: ERIII ENT .
.
'
Le
d~oit
de
jitprfmatie.
contille pr¡'lcipalemenc d,a.ns
~es
art1clcs.
1°.
Q:J~
ll.rche veque de
ch:~que
pr ovince ne peut
convoqLier les
év~ques
&
le cl ergé, ni dreCier
des
c1nons fans le
conl entemen~
ex res du roj, comme
il
plt·air par le Ciatut de la ving t-clnquieme année du
r egne d'H enri
V111.
e xi.x.
au lieu
qu'"upara •·~nt
les
afl<!mblées ec.·léti 1ftiques étoient convoquées,
&
que
l'o'! y fu foit
de~
lois pour. le
gouvern~meor
de I' E–
gl ole, fans
~ ucune
inrervencion de l'autorité royale .
Voy•z
Co;.:vocArLON .
2'~.
Au¡-.>ur.t· u1 u n peut appeller de l'orcheveque
a
la chJIICC! Ierie du roi; en coof'équence de l'Ct ap.–
pel , On
<'Xpédi~
une COmmif!iOJl fo\Js (e g rand fceau
adrellée
~
<·eru;nes perlo nnes. qui pour
la moirié
lilllt o rJinairemcnc des juo-es féculiers ,
&
pour. l'·au–
rre moitié des ju!{e< eccl éfiallique
;
ce que l'on ap–
p elle
la co11r da dí:lfg1tés,
ou fe Mcideot dé!initi–
vement couces
les c.a u,.es
eccléfiJ!liques , quoique
dans oerwm
ca~
on permette de re venir de la t'en.
t en
ce de <·ctte cour pa r forme de révifion . Avant
ce
ll.Hut d' I-J ·nri
VIII.
on ne pouvoit appell er de l'ar ·
cheveque qu·au pa pe feul .
Voy .
DELEGUÉ, AP r EL,
&c.
3° .
Le roi peut accorder.· des cummnfions
a
l'etfer
de vifit?r les heu< exempts de la jurifdiélion des év6-
q ues ou eles :¡rchev·!ques;
&
Je,l~
les appels retlor–
t iCl ent
a
¡.¡
ch~ncell erie
du roi: au lieu qu'avant
le llatur d' Henri
Vlfl.
il n'y avoit que le pape qui
p
t-
nr hnner
ce~
vifites ,
&
recevoir les appels incer–
j..ttl!'s de ces
~;uu rs.
· 49.
Les pe"lonnes
rev~tues
des orJres
fa crés ne
font pas plm excmptes de !'autoricé des lois tempo –
r-elle•1que les
o
rfo nnes [éculieres .
f/oy•z
ExEMPTJON,
l!IIMU ¡< ITÉ .
& c.
1" ·
Les
év ~~ ues
&
le clergé ne prerent aucun fer–
menr ,
&
nc
J
ivem >ucune obéitrance au pape; mais
ils (un e obligés de preter au roi le fermenr de fidéli-
t é
rle
Ji•p•·émati• .
•
SU RA , (
Hijl.
natur. }
efpece de rar qui fe rrouve
en A(rique , tur tour dam le royaumc de Cqngo; il
trJva1lle fous terre comme
le,
taupes; fa chai r eft un
mJ,
rer e•cell ent,
&
un feftin manqueroit de délica–
tetre~
ti
l'o n n'y
ft!~Voir
de ces aninu ux; il y a
c~
pendanr des neg res qui par la luperllir,iOJl s'en p.ri–
-vcnr comme d' une
via.n.de impure ..
Tom•Xf/.
l'Arianifrne. éroic:nt trop foru
pOJlf pouvoir
y
rem6dier
Cans
la
force. de
I' Ern,rire; aio1i quo•que
le:
1-'ape S.
Sytvel\re
expcJii t d,lnt
ce
pa)'J
ti,
le:
¡;r1nJ éve<tu,e
Ofins;
<\,tJOiqu'
Ale~x.mdre ~v~qu:
d'Ale.
Xdn trie
fe:
Jonn1t
bt-aurou¡l
Je
peine pour arreter le
cours
de
l'h~·
rét'ie Ariennc o le
t\lUt
fu t inutile ¡ coell pour celi que
ce
dcrrüer
implora
le
br.h
irnpcria.l
de
Conflant,in . fuinnc
le
ttmoignage
de
.
Epiphane
H<Artfi 6
J·
0 "1
peut
croire
que
loé véq~;~e
Ofitu
vice.
"erent
rle
S.
'iy.veftre aura fait les
m~rnc:s
in(\.lnc..:s
l
ce pieux
~rince
o
&:
que:
cet
E.cnpereur fe
fer.l cbargé
du
foin d'aOerablcr
~n
cJncile
~énéral
o
qui
fot
ccnamerncnt
tenu do
confentement du
Pape
o
quoique
¡hlOr mit-Ur; eagagcr
les
év~ques
!OEmpereur
écri•h
¡ui
m~me .
C'eft aioli que 1e rapportellt
~uffin
hv.
r. de foil hi –
«•Jire
C~.
t.
A.ll.albfe
BibliotbeQ.ire • mats
(ur
to~t
Jee
Veces
d~
S
U
R
URA ,
OIJ
Su u : ,
( lt.dig.
mahomft .)
mor arabe qui
li~n1fie
proprement
oo
pas ;
mais les coll e.:leurs de
l'alcorao délignenr par ce mor , les di lférentes fe–
frions de cet ouvrage, qu i fom au nombre de
114 .
Le pere S Jucier dit
{urau
au
lieu de
Jin•a ,
paree
qu'en arabe le
M
final marqué de deux points, re
proaonce cornme
te .
( D .
:;.
)
SuR
A, (
Géog. an... )
ville de Syrie , daos la Pal–
myrene: Pcolomée,
l. V.
c. x v .
la marque fur le
bord de I'Euphrate . Pline,
l.
f/.
c.
xxiv.
dans un en–
droit , ñomme cene
ville Ura,
&
plus bas,
l. V . c.
x x vj.
il l'appelle
S" ra .
U
a¡ouce qu' elle étoit
b~tie
dans l'entlroit o
u
l' Euphrate rournant vers
l'orienr,
laitrnit les derercs de Palmyrllne. O rtc!lius , le
p~re
1-hrdouin
&
Cellarius , conviennerlt que c'ell cene
ville qui ell nommée
Flavia , Firma , S"ra ,
dans la
noriae des dignités de l'empire ,
foll.
2.¡ ..
~e
pere
H1rdouin fnurienr que quand méme on écnrott
Ura,
au lieu de
S~tra ,
la conjeélure de Bochare,
par
t.
1,
l. 11.
c.
vj .
qui voudroit en faire l'Ur des
C
aldéens,
ou de
la Babylonie, o'en devien¡lroir pas plus pro–
bable ,
p1r.ceque la Babylone cll
trop éloignée de
la P-sln1yrene. Oans une and enne nocice eccléfi afti-
que , ce.tte ville
el~
anpdlée ,.,,,,.. .
.
D ans le feeond paCI<tge de Pltne, qui v.it!nt d'erre
ci té, on !ir:
a
S11ra
tlltteu~proxime
tljl
P
bif.ifo11m .
Les
ancienf édltcurs de l' line , au lieu de
a S11ra ,
li(oienc
A.fi!ra, A rura,
ou
Ajfi.r .
Mais cec endroit de Pline
ruflit pOUf juger qu't l faut lire
ab
Ura'
ou
IJ
Sltrll '
(D.
J. }
.
SuR
A ,
(
Géog . anc.
l Aeuve de la Gaulc belgique ,
&
l'un de ceux qui fe jettenr daos
laMoiell~ ;
Aufo–
ne
Ítt Mofo/la,
v .
H+
le décrit
~
in.li:.
...
Prond!te
N~mefoque.
adjuta meatu
Sura
tua.r properat
11011
deg mer ir• jitb unda.r
S.ura
interu pt11.r ti/Ji g ratíjicatf! jlueutir. .
Ce
Aeuve s'appelle auiourd' hui
Satt>',
&
les
Fran~
~is
le ·
n.omme~r-
le
Sour .
La P.ronrea
&
la Nen:'el3,
qui, fe lon AuIon.e, grollitrent fes eaux, font au¡our–
d'hui la P.rurn ou P.ruym ,
&
la Nyuns.
( D.
:J.
)
SURABONOAI'{CE, f.
f. (
Grntit.
) abondance
excef!ive
&
vicieule: on. dir
forabo1¡d~JJce
de droit ,
jiJrahondance
de
gr~
ins
&
de vio .
SURAilONDANT, (
Cbimie . )
lorfq ue , ourre la
propor.rion r.equife d' un cemin princi pe pour la for–
mation d' une fubflance détcrminée , d'un tel mixte,
d' un tel comparé ,
&.c.
il exiftc dan; un fu jet chimi–
que une quantité indéterminée de ce meme prínci –
pe; on dir de cette
deruie~e
quanriré qu'elle eCI
fi¡¡·–
nboiJda•zte
a
ce mi<te ,
~
ce
compol~,
&.c.
par
exem~
pie, cous les fel s
crylla ll i f~bles
eomiennent
U
!'fe .cer–
ra ine quantité cl'eau etrenttell c
a
Icor cryfialhfatiOn ;.
ti
des cryftau x d:un fel font unis
a
une autre po rtian
d'eau qui les rélout en llqueur ,
&c.
on dtt
de
cette
eau qu'elle efi
fi•rabonda11te
a
la cryftallifation ; une
certaine quamité de terre
Jitrabondante
au corps mu–
qucux, pa
rolt conftieuer !'erre fpécifique du .
c~rps
farineux.
Voy.ezFARI Ni:
&
FARI
t:ux,
(Cimnu . )
U ne cercaine quanii té d'acide n.1arin
&
de mercure,
conftitue un compofé connu Jans
l'~rt
fous le nom
Je
m~rcure
Jitb(illlf t(ottx;
ti
on charge ce compofé
d'une plus g·rande proporrion d'aciJe, ce qui arrive
lorfqu'on convenir le mercure fubl imé doux en un
aurre fel appellé
mercurc jimlimé. corrojif,
certe der–
niere portian d'{lcide qui
rpéci~e
le
1\l~lim.é
corro–
fif, ell dite
jitrabo.•zda11te .
Le fels neutres méralliques font éminernment·
pro~
pres a re furcharger d'acide. ou ¡¡ recevoir daos leur compofition un a cid~ {itra/Jot¡dallf : & les différen,– tes proportio ns de ce príncipe
_/ttr a.bonda.nt, fo ntcon–
lidéfablemcnt varier
teurs effets ,
l~s
pbénomenes
Dd·d d
2.
qu'i ls
fi~teme
cond le géuá.ral qai
d\
le
trojGerue tenu
a
Conl\.antinopl,e
•
lefqueb
dans leu,rs
acclamation.s
S~xpri~oient
de
cene maniere
acr_
rapporc de Labbi tom. 7· Concil. Colum. 1o3f .
.....,,.,,_,
to~'''-r•r
Y~}
a.s-rGL,TO,f:tiVt 'Tiit 'THti.for
Í)IÍ)'If>T;o,
•«}
Wl(,ldtUT;•t!-
Ku~cu'T;,.,
f
~~~ou.-tC'I~ciToc,
ll4l
'%ÍA~I~J•C
i
tioll'lo''t
.,~,
Nur,!l1dt
fU') c:\),1"
-rt
•si
,.,,,,.,.11''T07
" """'')'"
rúu.fu:
c'eR: -1-dire
Ariu.t
(e
foulevoic:
pnur (outenlr la
d1vi6on
~e
la S. Tr
inité l5c(or
le cb.amp Con–
ftaotin
toujouu auguRe
&
le célebre
Sylveft.reraO.:mblerem
dan(
N
icée
ce graod
coacile
fa
refpefuble . Nous
ezpliquerQttJ
encore
p\oe
clairemen t
i
la
dice
Note de
l'article
JSJifHit ,
ce que
nous
uons
dit
de ce
concile
l
lo~g,ard
dee a11tr.:s
alliJ.
convoqué•
P.otlt
le• Princea. (W)
















