
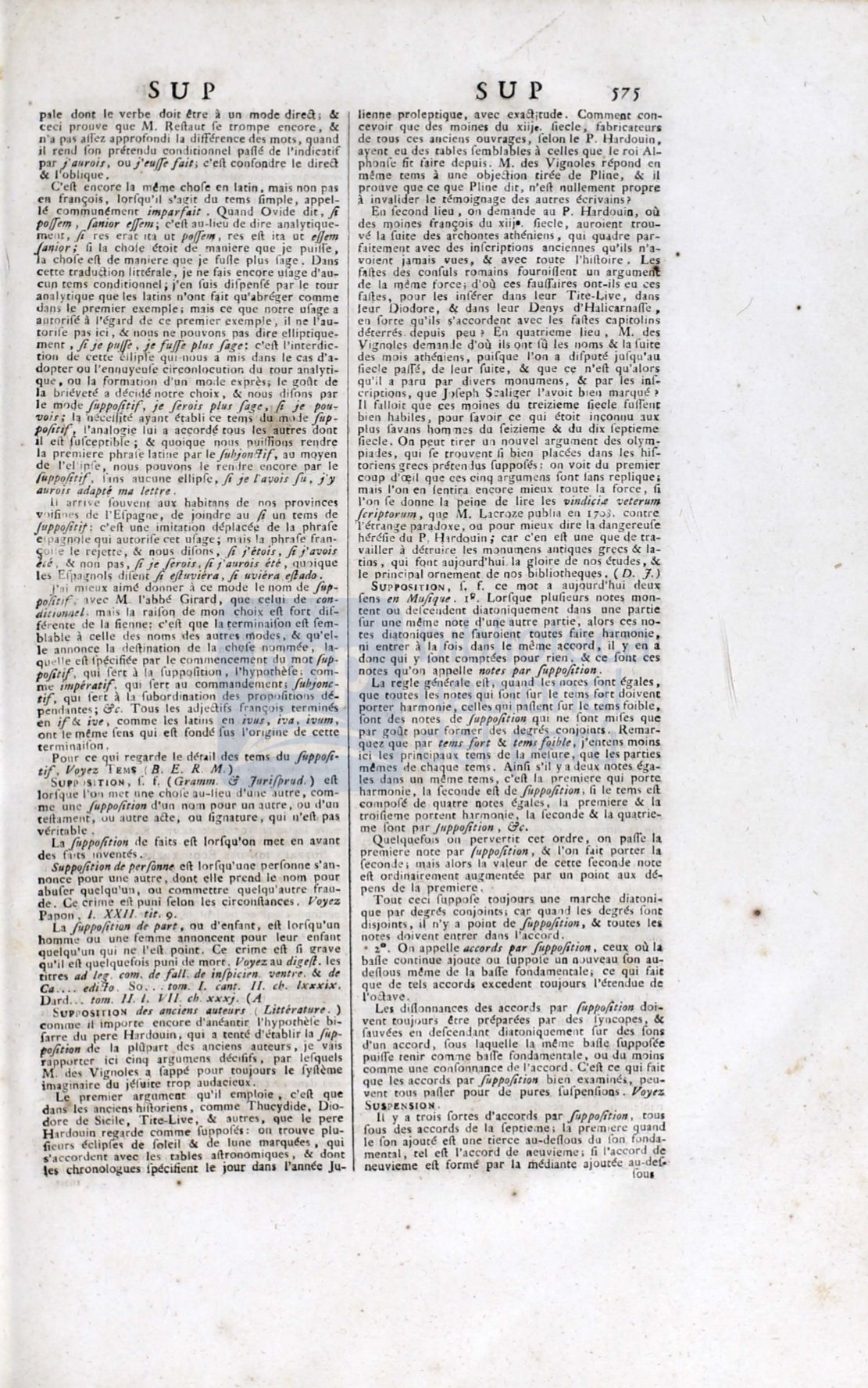
SUP
p!le done le verbe
do ic
~ere
a
un mode díreél;
&
ceci
prouve que M. llellauc fe trompe encare,
&
n'a
pa~
a(fez approfondí la dílfc!rence des mors quand
il rcnd Ion précendu condocíonnel paflé de
l'í~dícacíf
par
j_'auroif,
ou
j'euffi foit ;
c'~(l
confondre le díreél
&
1
obhque .
C'efl encore la
m~me
chofe en latín, maís non pas
eA
fran~oís,
lorfqu.'ol
s'a~í~
du cems limpie, appei–
Jé
con¡mu n~menr
rmpar[•1t
.
Q uand
O
vide die,
ji
po/fof!J
,
{anror effim;
c'ell an-lo"u de díre aQalycíque–
me,~c,
ji
res erae
IC3
ut
J1o/fo1'1 ,
res ell. ica ue
eff_n11
/ai/IO r;
fi
la chofe étoít de maniere que je puolle
1a
cl¡ofe ell de maniere que je fufle plus fage. Dan;
cene traduélíoQ líccérale, je ne
f~is
encore ufaae d'au–
c un cems condiríonnel
¡
j'en fuís dífpenfé par"le tour
analytíque que les lacios n'onr fait qu'abréger comme
tbp
~.e
premier
exemple;
majs
ce que notre ufage a
3)1torofé
~
l•égard de ce premoer I!Xemple,
il
ne l'au–
torofe pas ici,
&
no~os
ne ponvons pas dire ellíptíque–
~enr
,
Ji
_¡e
P'!lfi',
J_e fuffi pltu foge:
c'ell l'interdic–
toou dt: t·ecro: l,iiiple quo nous a mis dans le cas d'a –
doprer ou l'enoouycufe
cir~onl ocu tion
du tour analyti–
q ue , .ou la formatiou d'un morle expres; le go!lt de
la broévcté
a
décodé norre
choix,
&
nous difons par
le _mr>qe
Ji•ppo/itif,
¡e
flroir pllu foge,
ji
je po11-
vou;
1~
"néc.:i!llité nyant établ í ce ten1s do moJe
jirp –
R_ojitlf~
l'a nal o"ie lui a accordf tous les aurres 'clone
JI
efl
¡uíc~p tibfc;
&
quoique nnns puifTioos reo¡dre
13
premie re phra(e latine par le
folljoll''lif,
a
u mqyen
de l'cl 'opfe , nous pouvons le rendre cocore par le
fupp~firif,
r!m aucune ell ipíc,
ji je tavoif
fil,
j'y
aurou
adapt~
ma /ettre .
l l
arr o•e fouvenr
a u ~
habímns de nos provínces
V'>ifi nn.
de
1'
Efpagne , de
joo~drc
a
u
ji
un tems de
juppojir¡j :
c'ell un e ímítarion qép lacét! de la phraíe
Clpagnr¡le qui Gurorife cet ufage ; m1is la phrafe fran–
~o•
e le re¡ecre ,
&
nous dífon< ,
ji j'hoú,
Ji
j'avoú
é é .
&
non pas,
(t
j e firoir,
/i
j'aurois
ét;,
QU') ique
le;
~
"'nols díf"enc
ji
d}rwiéra,
Ji
uviéra ejlado .
J'oi
moeu x aimé donner :\ ce mode le nom J e
Ji•P–
pofitr(.
1vec
M-
l'abbé Girard, qne ceh!i de
con–
diltu/lful .
maís la ra ifor¡ de mon choix ell forc dif–
f~rcnce
de la lien ne:
c'~ll
qt¡e la
~ermínaifon
ell fem–
b lablc
il
celle des noms 'des autres modes,
&
qu'el–
le annonce la clcftination de la chofe nummée,
la–
q uelle ell
rp~cífiée
par le cumrnencement du mot
(up–
pojitif,
qni
fer t
;¡
la fuppqfition, l'h ypothefe; corn–
m e
unpératif,
quo fe rt au commandemenc ;
Ji•bjonc–
t if,
quo fert
a
b
fubordinatíon des propofitions
dé–
p enrlanre<;
&c.
Tous les adjeélifs fran<¡ois
terminés
en
if
&
iue,
comme les latins en
ivus, iva, ivum ,
onc le r[ltme fens qui efl fondé fus l'orogine de cecre
terminaifon .
Ponr
ce
qui re15arde le dh•il des rems du
foppofi·
tif_,
1/pyez
TI!
MS (
8 . E . R . M . )
SurP
JSITION .
e
f,
(
Gramm.
&
Juri/Prlld. )
ell
lorique l'o•• mee une cho(e au-lieu i.l 'une "auere , com–
me une
foppojition
d'un no:n pour un aurre, ou d'un
t eflame11t, <>u aucre aéle, ou ligna cure, q uo n'ell pas
v érocable .
La
Ji•ppojition
ele fa íts ell lnrfqu'on mee en avant
des f1 oc onventés .
Suppqfition de perfonne.
efl lorfqu'une perfonne s'an–
nonce pour une aocre ,
don~
o;lle prcnd le nom pour
abufcr quelqo'un, ou commettre quelqu'aucre frau –
de. Ce crime ell puní feton les circonllances.
Voyez
P 3pon,
l . XXII. eit. 9·
La
Ji•PPofitian
d~
part,
ou d'enfant, efl lorfqu'u n
homm~
ou une femme
~nnqncent
pour leur enfant
quelq u'u n quí ne !'efl
~oínt .
Ce crime efl _fi
~~;rave
q u'il ell quelqucfoos puno de
m~rc . f'~yezao
J¡gefl.
les
rieres
ad leg. com. de foil.
ti•
mJPrcun. V611tre.
&
de
Ca . . .. ediflo .
'o ...
tom.
l.
cant.
1
J.
c/.o.
/x xxix.
D ard...
tom.
11.
/.
V Il. c/J. xxxj.
(A
UPPOSITIO N
dtr ancieiU
4_Ut<Urf
(
Littfrature .
)
comme ot omporte encore d'an6otÍ( l'hypochefe bí–
f..rre do pere H ardouín, qui a _tenté d'o!tablír
!•
Jirp_–
pojition
de 13 piQpart de
ancoens auceurs , ¡e va os
r a_ppurter
ici cínq argumen
décolifs, par lefquels
M . des V ígnoles
a.
fa ppé pour _cou¡ours le fyfleme
imagínaíre do jéfuíre rrop
au~_acoeox .
.
,
Le premier argumeot qu ol
emplooe , e efl que
d ans les ondeos bifloríens, comme Thucydide,
Dio–
d ore de
icile , T íre-Líve,
&
autres , que le pere
H ardouín regarde comme fuppofés : on trouve plu–
íicur
éclipíe~
de foleil
&
de !une marquées , qui
s'accordent avec les
tl bles aflrooomique ,
&
done
\es chronolOj!.ues IPéciiient le jour d.ans l'année jo-
SUP
575
tien n~
prolepcí9ue '· avec
exa.~¡cude.
Comme¡¡t con–
cevoor que des momes do
XII) •·
liecle, fabricateurs
de coos ces arociens ouvrages, fe Ion le
P.
Hardouín
ayent eu des tables femblables
a
celles que le roi Al:
phonfc tic faí re depuís.
ÑJ.
des Vígnoles répond en
meme tems
a
une obje. ion tírée de Pline,
&
i1
pr~uve_
que ce que
~ line
dít, n•en nullement proprl!
a
on va ltder le témoognage des autres écrívains
¡
En fccond líeu, on demande au
P.
Hardouio, ou
des n¡oíncs
fra n~oís
do xiij•.
liecle , auroient trou–
vé la fui re des archontes athéníens,
qui
quadre par–
faitemeo1t
av~c
des ínfcrip.tions anciennes qu'íls n'a–
vooent ¡amaos vues,
&
avec co uce
l'hilloire . Les
[Afies des confuls romaíns fourn íOent un argumerft
de la
ol)~me
f
rce; d'ol) ces faulf•ires ont-ils
e
o .::es
falles, pour les ínférer dans leur T ite- Live , dans
Jeur Oiodore,
~
daos leur D enys d'Halícarnalfe ,
eo forre qu'íls s'accorclent avec les falles capitolios
détcrrés depuis peu
P
En quacrícme jieu ,
M.
des
Yogn()lcs demmJe d'ou íls QIJt
fu
les no ms
&
la fui te
des m ís athéoíem, puifq ue
l'on a difputé jufqu 'au
!iecle palfé , de jeor fu ite ,
&
que
e~
n'efl qu'alors
qu'¡l a paru par dovers monumens ,
&
par les inf–
eripcions , que J ¡feph S :aliger l'avoít b oen marqué
1
11
fJIIoít que ces moíoes do treizíeme ljecle
fulfen~
bien lubí les , pour fa voir ce quí étoit
ínconnu aux:
plus lavans hon¡rnes do feízíeme
&
do dix fep tíeme
fiecle. On
p~ut
tirer un nouvel argomene des olym–
píades, quí fe
~rouvent
(j
bkn placées dans le híf–
coriens arees préren us fuppof'és ' on voít do premíer
coup d'O<il que oes cinq argumens foo¡t lans replique;
maís l'on en
l~ncira
encore míeux coute la force ,
(i
l'on fe donne la pei ne de líre les
vi~~tli;i<L
'•terum
fcriptonm¡,
qu~
M.
Lacroze publo,¡ en e
70>.
comre
l'écrange
pao·~uoxe,
ou pour míeux di
r e
la dangereufe
h~réfie
do
P,
li•trdouín; car
e'
en etl une que <le tra–
vaí ller
ii
décruíre les monumens antiques grecs
&
la–
tíos, qui fo nr aujo urd'huí. la gloire de
no~ ~rudes,
&
le principal ornement de nos biblíorheq4es .
(D. ] .)
SuPPOSITION,
f.
f. ce mot a aujqu rd' hui deux
fen s
m Mu/ique .
rP.
Lorfque plulieurs notes mon–
tent ou de(cel!dent
diaro~iq uem ent
daros une partíe
fur une memc note cj'ul]e au cre partíe, alors ces no–
tes diatoníques ne fauroíen t
toutes faire lurq10oíe,
pi
entrer
a
la fob dans le
m~me
accord,
il
y
en a
done qui
y
tone comptées pour ríen ,
&
ce ione ces
notes qu'ooJ appelle
notu par Ji•ppo.Jition .
La reg le générale efl, quand les
no
res font égales,
que toutes les nnces q uí lo o1t fur le tems for t doivent
poner harmoníe, celles qui paflent fur le tems foible ,
fonr des notes de
juppojitioiJ
qu1 nc fonr mifes que
par goílr pour former de• degré• conjoincs . Rcma r–
qu ei
que par
tmu fort
&
tnns foible,
j'enr~ns
moíns
ici
les principaux rems de la mefure , que les parties
m~mes
de chaque tems. Aínfi s'il
y
a
deux notes éga–
les dans un meme tems' c'efl la
prern.i~re
qui porte
harmonie, la
fecond~
efl de
Ji•ppojition ;
(j
le te111s efl
compofé de qu2tre notes égales,
la
premiere
&
la
troifieme portcnt h.lrmonie, la fecunde
&
la quacríe–
me ÍQnt par
juppojition, &c.
Quelquefuos on per vercit cer ordre, on palfe la
prcmiere note par
fuppojition ,
<1<
l'on f•i t porter la
[econu e;
11\aís alors la valeur de cene fe conde note
efl ordín_airemen t
a,ogmen t~e
par un poinr aux dé–
pens de la premíere-.
Tout cecí Íl\ppore coujours. une marche díatoní,
que par
de~rés
conjoínts; ca,r qua d les degcés fon t
disjoi nt•, il n'y a poínt de
Ji•ppojitioiJ ,
&
tootes le¡
notes doivent entrer daos l'accord.
• 2.
0
•
O n appelle
aecords f>ar jirppojition,
ceux ou la
ba!le contínue ajoute ou fuppole un nclUveau fon au–
de!lous meme de la balfe fondam entale; ce quí faí t
que de tels accords excedent toujours l'étendue de
Po'
3ve .
Les di!lonnances des accords par
fi•ppo¡;tion
doí–
venc touj•>ur>
e
ere préparées par des
fyncope~,
&
fauvées en defcendant díatoníq_uement fu r des fon¡
d'un accord, fous
la,quelle la
me
me ba!le fuppofée
puilfe cenír comme balfe fonda meneale, ou J u mr>íns
comme une confonnaoce de l'accord . C'elt ce quí fai t
que les accords par
fi¡ppojition
bien examiné.;, peu–
vent cous pafler pour de pures fuf.penfions.
Voyn..
S USPI!:NSIOI( .
11
y
a rroís Cortes d'accotds par
.foppojition ,
rous
fous des accords de la feptoeme ; la prem oere quand
le fon ajouté efl une tíerce au-de!lous do fon fonda–
mental, tel efl l'accord de neuvíeme;
fi
l'accord de
neuvicme efl forn1é par la médiame ajoucée au-de[.
ÍOUI
•
















