
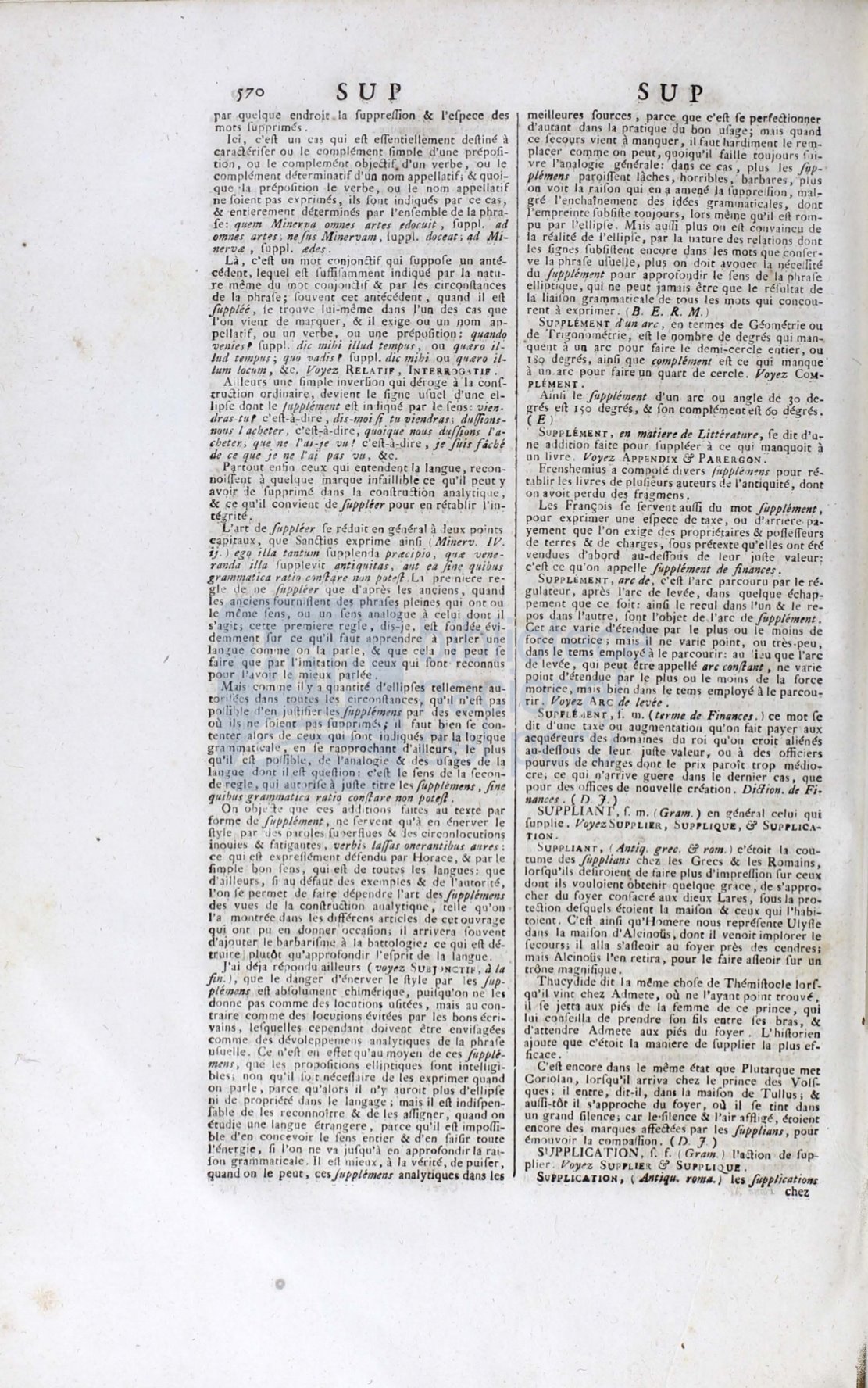
1
S{JJ?
par
quclqu~
endroit la fupprefllon
~
l'cfpece ,des
mors !u¡1primés .
Ici, c'etl: un eas qui etl: elfenriellemenr detl:iné
il
caraélérifer ou le complémenr limole d'une prépoli–
tion, ou le complcméur objeétif. d'un verbe, ou l_e
complémenr dérerminarif d'un
~om appe)l~rif;
&
quo~que
·la
prépofirion le verbe, ou le norn appellauf
ne foienr pas expri més, ils (c¡nr indiqués par ce cas
1
&
enrieremenr
dé~erminés
par l'eofemble de la phra–
fe :
q11em Minerpa
o~neJ
artu ,tlor.uit,
fuppl. '
arl
omnu artu; nejiiS Mmervan;,
lu¡¡pl.
tloeeat; tfrl
Jrfl–
nervte
,
fuppl.
,erles.
La,
c'etl: un inor coojonéHf qui Cuppofe
pn
aoté–
céelent, Jeq ue! .etl: ful!ir:1mmeor iod1qué par
la
n~ru
re merne du m-:>r conj
n~l1f
&
par les .circc¡ntl:ances
de la phrafe¡ fouvenr cer ancécédent,
qua~d
il etl:
.fi
1
pp!M,
(e trouve
lui-m~m7
d1!1S )'un
de~
cas _que
l'on viene de marquer,
&
1l ex1ge o u un
nQm
ap–
p ellarif, ou
u
0
verbe,
011
ur¡e prépufiriQn ;
q1fa11ri9
veniest
fuppl. '
die m!hi ill11rl tel1fpru_.
.
ou
qruró if–
lfld tempr1¡; q11o vmfu
r
fuppl.
d1e mdn qu ·qlldlro 11-
/um toeMll ¡
&c.
Voyez
~ELATIF ,
INTERII.OO•TI F .
A1lleurs une fi'm ple inverlioo qui
<Jé'ro<ie a 'IJ éonf–
truaion onJinaire, deviene le fi,.ne ufuel d'une el–
lipfe donr le
/t1pplqmc1/t
etl: indiqué par le feos :
-Jim.
tiras tllf
e'
ell-a-di re,
tlh-moi
fi
tu vimdrtu ; du(Jio1u–
''""'' /
aebeter ,
c'efl~a-dire;
tj;IOique' notlf dr!{(ions /'a–
cbettr, ;
'1''"
ne
l'ai -je vu!
c'etl:-a-dire ,
je jilis
¡.r,·b#
de
e~ t¡lf~
je
11~
l'ai pas
'""·
&c.
P~ rrour
enfin ceux qui ,enrendel)t la laogue, recon–
noi!fenr
a
quelque marque
inf~ill•ble
ce qu'il peur y
avo1r :le fupprimé dans
la
contl:ru~ioo
analyriq •1e,
&
C~
qu'il COI)Vient
·~eji¡pp/fer
pour
~~~ réta~Jir
)'11,1;
té_~ri ré.
'
- L'Jrt' de
ji¡pplhr
fe réduit en général
a
,feux poirm
capi1aux, que Sa nltius exprime oinfi
( Minerv.
JI/.
ij.) egq ilfa tant11m
fuppleO'h
pr.eeipio,
·
't'"
vme–
randu ilfa
fup levir
antiq11itas, a11t ea
jllle
quib11s
g1·amma!iea ratio em{lt¡re 11un poteP.
L1
¡>re nit:re re–
gl e 1fe ne
(i1ppléer
que d'apre< les anciens,
qu3n~
le
aQ.ciens fourrullenr des
phr:~fes
plcioes qui onr
0 \1
le
mCme
f'ens, ou un
feo~ an~logue
a
celqi door il
s'agi r; cene preiT)iere regle , di¡-je, etl:
fondé~.
évi–
demment fur ce qu'il
f~4t
aoprendre
a
parler un_e
Jan rue comme on la
p:~rle,
&
que cela ne peur le
f ai?e que par l'imir:triOI) de ceux qui fonr · reconnus
pour l'4voir le m1eux parlée.
M ais cr¡mme il y
a
quantiré cf'ellipfes rellemenr au–
to•·dee< daos
rour~s
les circnntl:ances
1
qu'il n'etl: pas
p ofli le d'en jnflifier
le<_{t1pplhnms
par des excmples
oil
ils ne foienr pas fuopnmé•¡
11
faur bien fe con–
t emer alors de ceux qui .fonr indiqués par la logique
gra'llnprkal ~ ,
en fe rap roch1nr
el'aill~.urs ,'
)e plus
qu'il etl:
poffjblc, de
l'analo~ie
&
eles ufages de la
lan~ue
donr il efl queflion : c'etl: ,le feos de la fecon–
d e regle' qui amorife
a
jufle riere le!
fi•pplémens'
fin~
qt~i!nls
grammatica ratio eon{lare non potefl.
'
O
o
obj~''le
que ces 'add•roons
fJitC> au rerre par
forme
ele
jitppléme~~t, ~e
fervenr qu'ii ery énerver le
í\yle par ·ue< p1r¡¡les fu erflues
&
Je<'circon l ocurion~
ino4i~s
&
farigautes,
verbi
laf[at oner01Jtib11s aures :
ce qui efl
expreflém~nr
défendu par tl<?race,
&
p~r
le
íln¡ple bon feos, qui etl de
roure~
les laogues: que
d'ailleurs , fi aq cléfaur
d~s
exemj>tes
&
de l'antoriré,
l'on fe perme.t de fa
ir~
clépendre l'arr ·
desji•fJpUmms
des' yues de la contl:ruóliou analyriqne , relle qu'on
l'a monrrée
dam
les d•fférem articles de
~er
ouvrage
quj onr pu en ¡:lonner ' ocqtion; il !rriyera fouvent
d'ajourer le
barbarifnJ~
a
la
bmol o~ie:
ce
qui etl:
M–
t ouire plurllr qu'approfondir l'efpm de la laugue .
J'ai déja 'rérondu ailleurs (
VOYf Z
S
u n¡
INCT!f.
a
fa
fin .J,
que le dá,iger d'.Snerver le flyl e
pú
les
jup–
p.té'"""f
etl: abfolumem cbimérique, puifqu'ou ne les
donoe pas comme de
locurion! ufitt'es, mais au con–
traíre comme des
locu~ions
évitées par les bons écri–
vains, lefquelles cependanr doivenr erre envifagées
comnie des t!évoleppemens analyriques de la phra fe
u fu elle. Ce n'etl:
er\
efler qu'au
m
oyen de
ces Ji•ppU–
mms,
qne
1 ~<
propofirions ellinrique; fonr inrdllgi–
bl es ; non qu 'il ioir nécellJ ire de les exprimer
qu~nd
on parle , paree qu'al prs il n'r auroir plus' d'ellij>fe
J)i Je propriéré dans le langage;
' mai~
il etl: iodifpen–
fabl e de les rcconnoirre
&
de les
aflig~er,
quand on
érudje une langue érr9
0
gere, paree qu'il etl: impofli–
bl e d'en concevoir le fens enricr
&
d'en faiúr roure
l'énergie, fi l'on ne
va
jufqu·~
en appro(ondir la rai–
fon grarilmaricale .
11
eflmieux ,
a
la vériré,
de
puifer,
9uand on le peut,
ce'f"f/IÜ111611s
analycique¡
dans
les
SUP
'
'
meilleures fources '
p~rce
que .c'etl: fe perfetliom¡er
d'auranr dans la
~ratique
c;lu .bon ufl¡;e ; ·m.1is quand
.ce fecovrs v1enr
~
manc¡uer, ti faut
har~imenr
le rerv–
placer comme <;Jn peur, c¡uoiqu 1il .faille r
0
ujours f,,¡_
vr;
l'lln~logie
générale: c;la9s 'ce _cas, plus
les
fop–
J'lmuns
parQ•Ifent
tac~es,
hombles, · baro1res, "plus
oo vo,it
Ja
r_:¡ifon qui
en~.an1e11é )a
Í\lp~reflion, m~l
gré
1
e~chamement
d.esu;lées
gram~aric~les ,
do1¡t
l'ell!premre fubfi tl:e ro
u¡ours, lors
rn~n¡e
c¡u1il efl rom–
pu p3r l'ellipfe . J\ihis al)fli plus
Q<~
etl: C()l¡yaincu de
la réaliré de l'ellipl'e ,
p~r
la narure des relarions dont
les l)goes fubG.flenr encqre l;Jans les mc;m
qu~
é:onfer–
ve la phr!fe uluelle,
plu~
on diJit
~vouer
la l)écelliré
du
hPPiément
pour approfo•¡dir le fens <)e la phrafe
elliptique ,'qul ne peut ;amais
~rre
que le réf'ultar de
la liai!on gran¡maricale ele rous les mors 9ui concou-
rent
il
exprimer.
(B. E. R. M .)
'
Su?PLÉMENT
d'tm are,
'en rcrmes de
Géom~rrie
011
eje Tr'¡gon'ornétrie, etl: le 'Qombre <,le degrés qui man–
'quenr
a
un JITC po1,1r faire le demi-cercll! enrier, ou
18c¡
degré$, ainfi que
tomptément
·
efl ce qui ma
0
que
a
un are pour faire pn 'quarr de cercle .
Voyez
CoM-
PLÍ'MENJ' ,
.
.
,
' Ai'nti le
fopplément
d'un are ou angle de
30
de–
~rés
etl:
l )o
degrét,
&
Jon complémenrefl 6o dégrés.
(E l
.
'
, ·•
, . ,
· Surp LÉMENT , '"
matitre tlt Litt¿rat11re,
fe dit d'u–
ne addirion faite pour f'uppléer
a
ce qui manquoit
a
un livre .
Voytz
APPENDIX
&
PA llE RGON:·
Frensh~ml'us
a c'ompo(é d1vers
(i1ppümms
pour ré–
ubli~
les livres de
plufiéur~ ~ureurs
e!.: l'andquité, dont
on avoir perdu eje$
fr~gmens.
Les
F,ran~ois
fe [ervenr aufli du ll)Ot
fopplfment,
puur ex primer une efpece de raxe, ou d'arnere. pa–
yement que l'on exige des prqprié¡aires
f¡¡
pvllelfeurs
de tcrres
&
de
ch~rges,
·rous prérexre qu'elles ont éré
vendues el'abord
~u-ciefli
U! de leu r
jutl:e valeur:
c'efl ce qu'on ·appelle
fopptément de finaneu.
'
Su PP L~ME~T,
art tlt ,
c'eij l'arc ¡>a rcouru par le ré–
gulijreu r, apres !'are de levée, daos que)que échap–
pemenr
~ue
ce foir : ainG le recul dans !'un
&
le re–
poi dans l'aurre, fo,¡ r l'objet de !'are de
foppJément .
Cer are varie d'éten4ue par le plus ou le moins de
force morrice; mais il ne varíe poinr. ou rres -peu'
dans le rems employé
a
le parcourir: a
u
'bu que !'are
de levée, qui peur érre appellé
are cotJftant,
ne varie
poinr
d'érend~¡e
par le plus ou le moms de la
force
morrice, ma is bien dans le tems employé
a
le parcou-
' rir.
Vuytz
A
RC
de ft v¿e.
·
Su rPLÉ.•IENT,
(.
111. (
tti'IIU de Financn .)
ce mot fe
dir d'unc taxe ou aug-menrarion qu'on fait
pay~r
aux
acquéreurs des elom:J!nes du roi qu'on
croi~
aliénés
au-de{]ous de Jeur ¡u(le valeur, Oll
a
des officiers
pourvus de
char~es
dqnr le prix paroir trop médJo–
cr~;
ce qui
n'~rrive
g uere dans le dernier cas, que
pour des offices
d~
nouvelle créarion.
Diflio'!. de Fi–
llatzecs. ( {).
1. }
SUPPL!Ai\l·r, f. m.
( Gram. )
en
~énéral
celui qui
fup1>lie. VoyezSuPPLtiR, SuPPLtQU!,
&
SurrLtCA·
110N .
Su PPLIANr,
(
Antiq.
grec.
&
rom.)
c'éroir la cou–
rume des
jilpplian,·
eh~~
les G recs
&
les R omains ,
lorfqu'ils defiroienr de faire plus d'imprellion fur ceux
donr ils vouloient obrenir quelque grace; ele s'appro–
cher du foyer con faeré aux die
u~ ~ares,
fous la pro–
teélion defquels éroient la maifon
&
ceux qui l'habi–
ro•cnr. C'etl: ainli qu'Hnmere nous repréfenre Ulylle
dans la maifon d'Alcino!is, done il yenoir implorer le
fecours;
il
alla s'a fleoir au foyer pres
d~s
cendres;
mais Alcinoüs !'en retira , pour Je faire alleoir fur un
tróne
mag~ifique.
Thucydide dir la
m~me
chofe de Thémitl:ocle lorf–
qu'i l vil)t chez Admere , ou ne l'ayaoc poinr trouvé,
il
fe jerra aux piés de la femme de ce prinee, qui
lui confeil!a de prendre fon fils enrre {e¡ bras,
&
d'arrendre Admere aux piés du foyer .
L'
hitl:orit>o
ajoure que c'étoir la mlniere de fupplier fa plus ef–
ficace. ·
C'etl: encore daos le meme érat que Plutarque met
C oriolan, lorfqu'il arriva chez le prince des Volf–
ques; il enrce, dir-il, d4111 la maifon de Tullus ;
&
aufli-t6t il s'a pproche clu foyer,
m)
il
fe tinr dans
un grJnd fil ence; cJr le-lilence
&
l'air
affli~é .
écoient
encore des' marques alfeélées par les
foppiia1U'
pour
émouvoir la compallion. (
n.
J .
)
SIJPPLICATION,
f.
f. (
Gra111.
J
l'aélion de fup–
pl ier .
Voyez
SuPPLIER
&
SUPPLIQ..U! .
~UIP~ICAliOII,
(
~nti¡u.
rq11111.)
lei
fopplieation~
'
~he~
















