
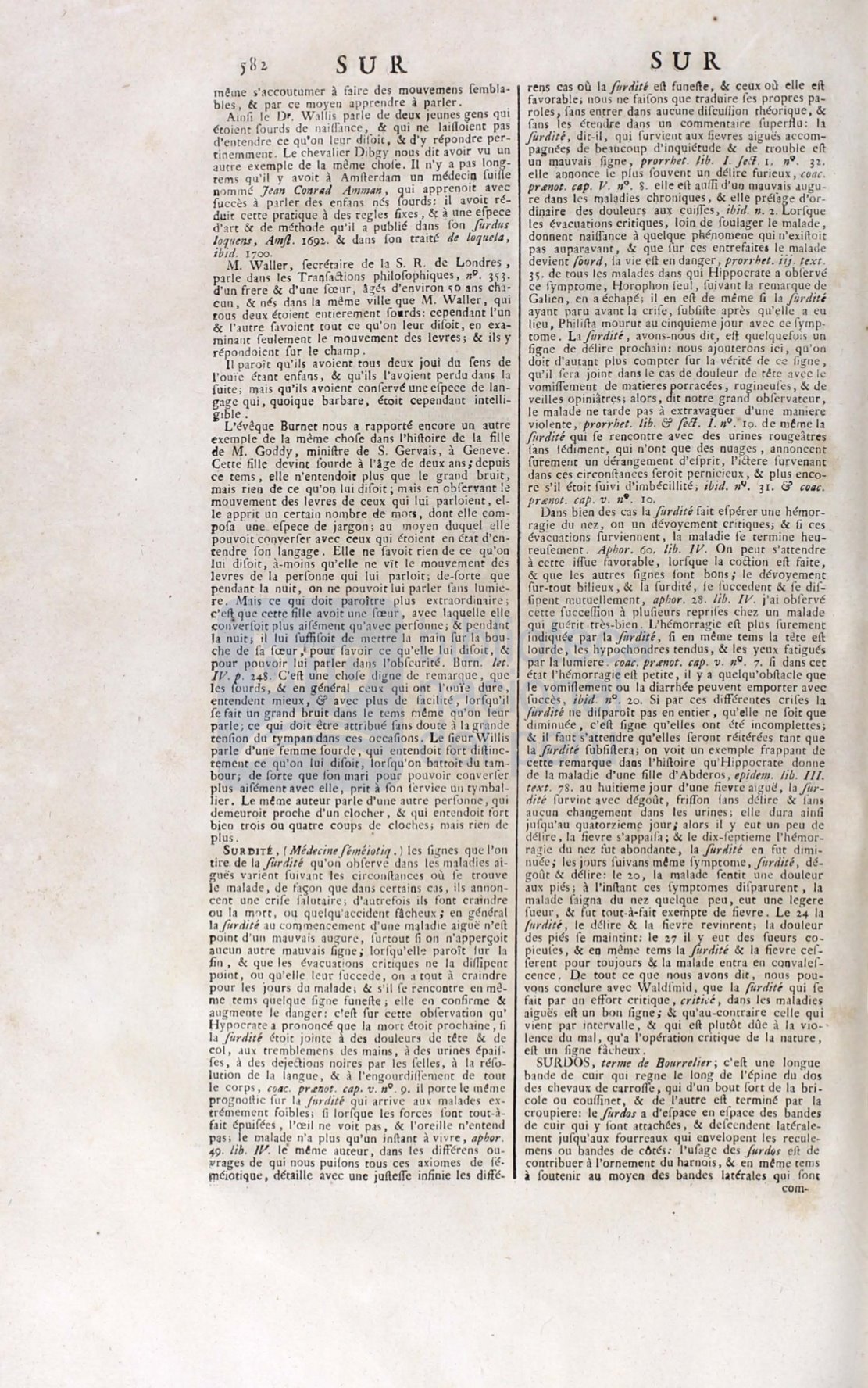
S U R
meme s'accoutumer
a
fait·e des mouvemens fembla–
bles.
&
par ce moyen apprendre
a
parl~r .
.
Ainfi le
J)r.
W aiiis parle de de_ux jeun_es
~ens
qut
étoiem fourds de na•II:1nce,
&
qut ne
lat!lotenr pas
d'entendre ce qu'on leur difoic,
&
d'y répondre per–
t inemmenc . Le chevalier D ibgy nous die avoir vu un
aucre exemple de la meme chofe.
ll
n'y a
p~s lo~g
rems qu'il
y
avoir
~
Amflerdam un médecn¡ fut!le
nommé
]Mn Conr11d Amman,
qui apprenoir avec
fu cces
a
p3rler des enfans nés fot¡rds:
ji
avoic ré–
duir cetre prarique
~
des regle5 ñxes,
&
a une efpece
d'arr
&
de mérhode qu'il a publié dans fon
ji1rdtu
Joq11nu,
Amfl.
I69~·
&
dans fon traité
d~
loq11eJa,
ibid.
1700·
M.
Waller, fecrétaire de la S.
R.
de Londres ,
parle dans les Traof.1élions philofophiques,
n
9 .
H3·
d'un frere
&
d'une fa:ur, igés d'environ
~o
3ns
e
ha·
cun
&
nés dans la mi!me ville que M. Waller, qni
tous' deux écoient
entiereme~t
foards: cependanr l'un
&
l'aurre C:tvoient cour ce qu'on leur difoic, en en–
minant feulemenr le mouvemenr des levres;
&
ils
y
répondoiem fur le champ.
11
paroic qu'ils avoient rous deux joul du fens de
l'ouYe étJnt enfans,
&
qu'ils l'avoien t perdu dans la
fui re; mais qu'ils avoienc confervé une efpece de lan–
gage qui, quoique barbare , étoit cependant intelli–
g•ble.
L'év~que
Burnet nous a rap porté encore un aurre
exemple de la meme chofe dans l'hifloire de la fili e
de
M.
Goddy, miniCh-e de S. Gervais,
a
Geneve.
Cette filie devine fourde
a
l'lge de deux ans; depuis
ce tems, ell e n'entendoir ¡>lus que le grand bruit,
mais ríen de ce qu'on luí difoit; mais en obfervanr l¿
mouvement des levres de ceux qui luí parloient , el–
le apprit un certain nombre de mocs, dont elle com–
pofa une efpece de jargon ; au moyen duque! elle
pouvoic c<>Qverfer avec ceux qui éroienc en écar d'en–
t endre fon langage. Elle ne favoit ríen de ce qu'on
luí difoir, ?i-moins qu'elle ne vlt le mouvement des
levres de Id perfonne qui luí parloit; de-forre que
penda nt la nuir, on ne pouvoir luí parler fans lumie–
re. Mais ce qui doir
paro!cr~
pi us
exrraordinaire ;
(:'efl
~·u
e cett¡:
filie
avoit une freur, avec laquelle elle
~onv,erfoir
plus aifément
qu 'av~e
perfonne;
&
pendant
la nuit; il luí fufljloir de merrre l<t main fur la bou–
che de fa fa:ur
,i
pour favoir ce qu'elle lui difoic,
&
pour ¡>Ouvoir luí parler dans l'obfcurité. llurn.
Iet.
IV.
p.
1.48.
C'efl une chofe digne de remarque, que
les fourds,
&
en général ceux qui onc l'uu'ie dure ,
entendenc mieux,
&
avec plus de facilité, lorfqu'il
fe faic un grand bruic dans le cems
r.t~me
qu'on leur
p arle; ce qui doit ecre acrribué fans doure
a
la grande
tenlion du rympan dans ces occafions.
Le
lieur Willis
parle d'une femme fourde, qui encendoic forr cliflinc–
t~ment
ce qu'on luí di(oit, lorfqu'on battoit Ju tam–
bour; de fo rre que Ion mari pour pouvoir converler
plus aifément avee elle. prit
a
fon l'erviee un cymbal–
lier . Le
m~me
aureur parle d'une aurre perfonne, qui
demeuroit proche d'un clocher ,
&
qui encendoit tort
bien trQis ou quaere coups de cloches; mais rien de
plus.
·
SuRDJTÉ ,
(
Mé.lecilleflméiotiq. )
les lignes que l'on
tire de la
fi•rdité
qu'on obferve dans les m:tladies ai–
gues varient fuivanc les circonnances ot't fe trouve
le malade, de tason que dans cerrains cas, ils un non–
cene une cri(e fa lutuire; d'amrefois ils font craindre
ou la m'lrt , ou qu elqu'accidenr
f~cheux ;
en général
laji1rdité
au commencement d'une maladie aigue n'en
point d'un mauva is
au~ure,
furcout li on n'appersoit
aucun autre mauvais ligue ;
lorfc¡u'ell~
paroit lur la
fin ,
&
que les évacumons critiques ne la diffipent
puinr, ou qu'elle lcur fuccede, on :t tou r
i\
craindre
p our les jours du malade;
&
s' il fe renconcre en me–
me tems quelque ligne funefle; elle en confirme
&
~ugmenre
le daqger: clefl fur cene obferva tion
e¡
u'
flypocrare a prononcé
~ue
la mort écoit prochaine,
(j
la
.furdit¿
étoit jointe a des douleurs de rfte
&
de
col, .tux tremblemens des mains,
a
des mines épaif–
fes.
a
des
d~jeélions
noires par les felles'
¡\
la réfo–
lution de la langue,
&
a
l'engourdiO'ement de
tour
le corps,
CM c.
pr.enot. cap.
v. n°. 9·
il porte le
m~
me
progno llic l'ltr id
jtirdité
qui arrive aux malades ex–
trémemcnr foibles; li lorfque les forces lonr cout-it–
faic
épuif~es,
l'reil ne voit pas,
&
l'oreille n'en tend
pas ; _le
matad~
n'a plus qu'un innant
a
vivre,
aphor.
+9·
lzb.
IV.
le m!me auteur, daos les dilférens ou–
¡vrages de qui nous pui!ons cous ces axiomes de fé·
m,éiotique, détaille avec une juneife infinie les dilfé-
S
U R
reQs cas o
u
la
ji1rditf
efl fu nene,
&
ceux o
u
elle ell
favorable; nous ne faifons que traduire fes propres pa–
roles, fans enJrer dans ancune difcullion théorique,
&
f.1ns
les étendre dans un commencaire fuperflu:
l1
fordité,
dir-il, c¡ui furv\ent aux fievres aigué's accom–
pagnée~
de be3UC0Up d'inqt¡iétude
&
de [l'OUbie efl
un ll)auvais !igne
pr~rrhtt.
lib.
J.
jttl .
I,
11 9 .
31..
elle anoonce le plus (ouvent un délire furieux,
caac.
P>'4/Jot.
cap.
V. n°. 8.
elle efl auffi d' uo
m~uvais
dugu–
re cfans les
mal~dies
cl¡roniques,
&
elle préfaO'e d'or–
dit¡aire des
douleur~
a
u~
cuilfes,
ibid.
11. 2.
l:.orfque
les évacuations critiques, loin de fou lager le malade,
donnenc nailfance
a
quelq_ue phénomene qui u'exilloit
pas auparavant,
&
que lur ces encrefairea le malade
deviene
(our4,
f:t vie efl en danger,
pror,./,et. iij. ttxt .
H·
de
tou~
les malades dans qui Hippocrate a oblervé
ce fymprome , Horophon reul, fuivan t la remarque de
Galien, en a échapé; il en efl de
m~
me
t'i
la
j11rdit;
ayanr paru avanc la crifc, fubfifle apres qu'ellc a eu
lieu, Philifla mouruc a
u
cinquieme jonr avec
~e
fymp–
tome.
L:tfin·dité,
avons-nous die, etl quelquefo1s un
ligne de délire prochain: nous ajourerons ici, qu 'on
doit d'auraor plus comprer fur
la
vérité de ce ligne,
qu' il !'era joinc dans le cas de douleur de
c~re
avcc le
vomiifement de matieres porracées, rugineufes,
&
de
veilles
opini~tr~s;
alors , die norre granó obfervaceur,
le malade ne tarde pas
a
extravaguer d'une maniere
violente,
prorrbtt. lib.
&
(e{!.
J.
nu.
Io. de
tlt~me
13
jl<rdité
~ui
fe rencontre avec des urines rougeilcres
fans
lédtmenc, qui n'ont que des nuages, annoncenc
furement un dt!rangemenr d'efprit, l'iélere furvenanc
dans ces circonflances feroir pernicieux,
&
plus enco–
rc s'il éroic fui vi d'imbécillité;
ibid.
11".
31.
&
coac.
pr.enot. cap.
v.
11~ .
xo.
Dans bien des cas la
fin·dité
fai t
efpére~
uuc hémor–
ragie du nez, ou un dévoyement critiques;
&
fi
ces
évacua tions furviennent, la maladie le termine heu–
reufcment .
Apbor. 6o, lib. JV.
On peur s'mendre
a
certe i(fue favorable, lorfque la coélion en faite.
&
qne les aun·es lignes !out bo•!s
¡
le dévoyemenc
(ur-rout bilieux,
&
la furdité, le luccedenr
&
fe dif–
ftpent mutuellement,
apbor.
28.
lib.
IV
j'ai obfervé
cerre fucceffion
i\
plulieurs reprtl'es chez un malade
qui guérit tres-bien. L'hémorragie efl plus furement
indiqué~
par la
fi¡rdité'
ft en meme tems la rete en
lourde, les hypochondres rendus,
&
les ycux fatigués
par la lumiere.
coac. pr.etJot. cap.
v.
11° .
7·
li dans cec
écar l'hémorragie etl
p~tire,
il
y
a quelqu'obflacle que
le vomifl ement ou la diarrhée peuvent emporter avec
fucces,
ibjd.
11°.
1.0.
Si par ces dilférentes crifes la
frn·flité
ne dilparolr pas en enrier, qu'elle ne foir que
dtminuée, c'efl ligne qu'elles onr
ét~
incomplerres;
&
il fauc s'attendre qu'elles [eron c réitérées ranr que
la
.furdité
fublinera; on voit un exemple frappant de
cette remarque daos l'hifloire qu' l-lippocrare donne
de la maladie d'une filie d' Abderos,
epidem. lib.
111.
text.
78.
au huitieme jour d'une fievre atgue,
lajilr–
dité
furvint avec dégout , fritron fans délire
&
fans
aucu n changemenr dans les urines ; elle dura ainfi
jnfqu'au quarorzieme jour.; alors il
y
eur un peu de
délire, la fievre s'appaifa;
&
le dix-feprieme l'hémor–
ragie du nez fue abondante, la
fimlité
en fue dimi–
nuéc; les jours fuivans
m~me
fymprome,
ji1rdité,
dé–
goQc
&
délire: le
1.0,
la malade fentit une douleur
aux piés;
a
l'inflant ces fymptomes difparurent , la
malade faigna du nez quelque peu, euc une legere
fueur,
&
fue wut-ii-fait exempre de fievre . Le
24
la
(tn·dité,
le délire
&
la fievre revinrenr; la douleur
des piés fe maintinr: le
27
il
1
euc des fueurs co–
pieutes,
&
eo
mem~
rems la
j tlrdité
&
la fievre cef–
ferenr pour toujours
&?
la malade entra en coovalef–
cence
1
D.e tour ce que nous avons dit, nous pou–
vQns con
el
ure avec Waldlinid, que la
(i1rdité
qui fe
fair par un elfort critique,
criti.:é,
dans
l~s
maladies
aigues efl un bon ligne;
&
qu'au-contraire celle qui
viene par iptervalle,
&
qui efl plutllr d(}e
ii
la vio–
lence du mal, qu'a l'opération critique de la nature ,
efl un ligne raeheux .
SURDOS,
terme de Bourrelitr;
e'
efl une longue
bande de cuir qui
re~ne
le long de l'épine du dos
des
chevaux de carro!le, qui d'un bouc forr de la bri–
cole ou couffinet ,
&
de l'aucre efl terminé par la
croupiere: le
.furdos
a d'efpace en e(pace des bandes
de cuir c¡ui
y
fon c arr2chées,
&
defcendenc latérale–
ment jufqu'aux fourreaux qui envelopenc les recule–
mens ou bandes de c6cés: l'ufage des
fimws
~fl
de
conrribuer
:l
l'ornement du harnois,
&
en
m~me
tems
1
[outenir au moyen des bandes
lat~rales
qui fon t
com-
















