
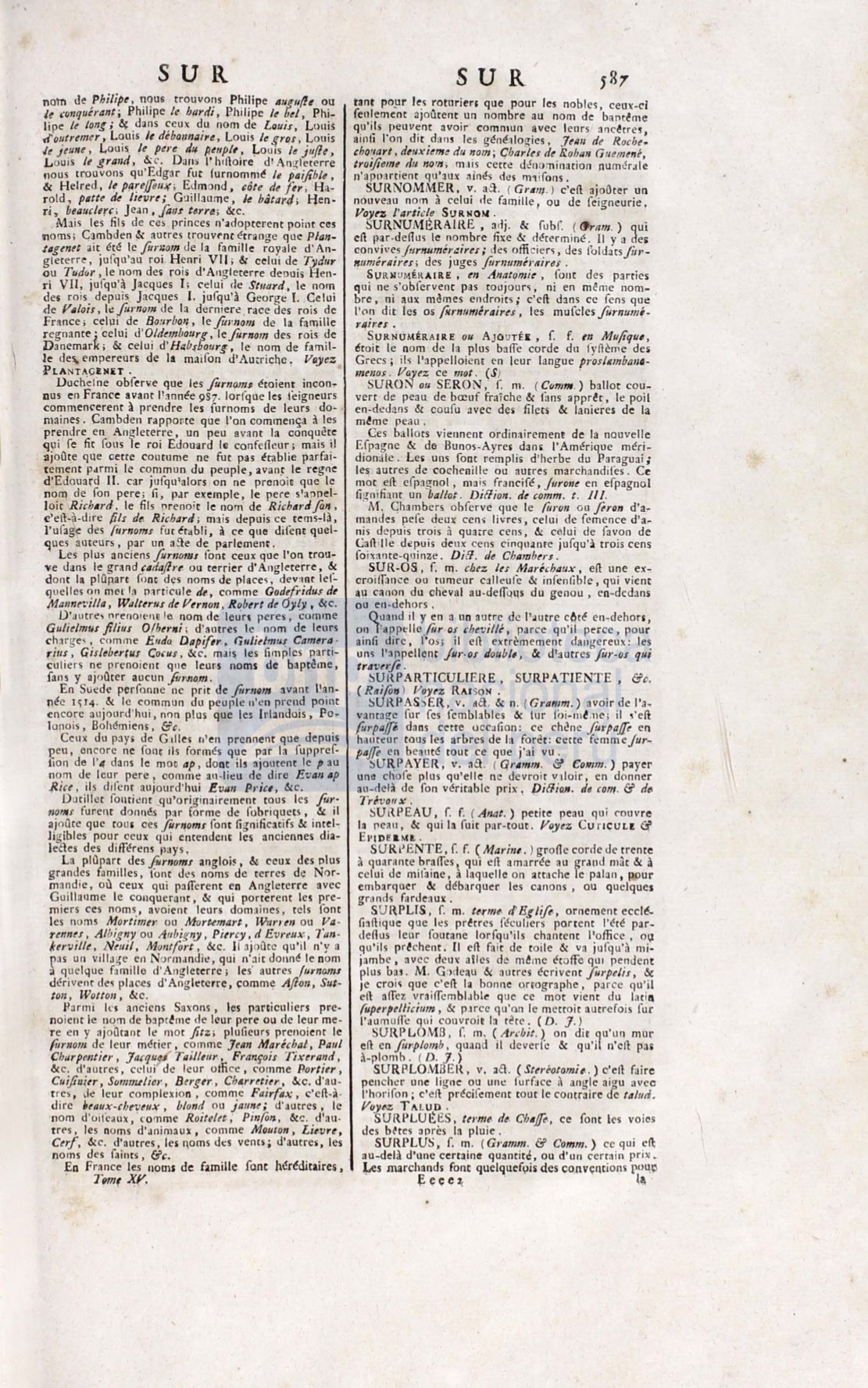
S
U R
notn de
Philip~,
nqus rroQvons Philipe
411,!tt/!t
ou
/( (Ottquhant;
P.hilipc
le hardi ,
P.hilipe
le bei,
Phi–
Ji pe
1~
lon,t;
~
.dons
~cux
d.u nom de
Louis,
Louis
.J'o/ltremcr,
Lou1s
ü
deboltn/11~~.
Louis
le ,trqs,
Louis
Jt
jeune,
J..oui~
Je pere áu ¡:¡mp¡,,
!-ouis
le
j'!fl~,
L ouis
le gr1111d,
&e.
Da11s
1'
htlloire d• 1\n<rlererre
nous rrpuvons qu'Edga r fut !urnommé
lt p_"aijiblt,
&
Helr~d, 1~ Pll~ejfettJ( ;
Edmond,
cote de
f~r ;
Ha–
roid,
plltte de
luvr~; G~illaurne,
Je batar.<f;
Hen–
r¡,
be11uclerc;
Jean,
fou.t
t~rr~;
&c.
. M ais les tils de ces princes n'adopter.cnt poinr ces
noms ;
C~mbden ~
aurres trouvrnr <!rrange que
Plon–
lllgmet
a
ir. á!é le
jim~om
de .la fa mili e royale d' An–
glererre, 1ulqu'all ro1 Henn
VIl;
& eelu i de
Tyáur
ou
Tud&t",
le nom des rois d'Anglererre deouis Hen–
ri
VIl,
jurqu'i\ Jacques
l ;
r elui rle
9tttard,
le nom
des rois depuis J acques
l.
jurqu'a G eorge
l.
.Celui
<le
V11lois,
1~
fi•rnom
de
la
durnier~ .
race des rois de
France; cehli de
8ourbo.1¡,
le
.foMom
de
la farnille
rcgnanre
i
"Gelui
tl'Oidmtbottrg,
le
fornom
des rois de
Danemark;
&
celui d'
Httb{baur,t,
le nom de fa mil–
le tle!;, cmpereurs de la mairon tl'Au¡riclw.
Voyez
PLANTACI:liiLT •
.
Vuchefne obrer\<e que les
forn?11U
étoienr inoon.
aus en France avanr
ll~nnée
987.
lorfque les teigneurs
commencerenr
~
prendre les furnoms de leurs do–
m~ines.
Cambden
rappor.reque l'on
oommen~a ~
les
prendre en Angl
ererre, unpeu avanr la oonquere
q\li re fir rous le roi Edouard lo confe(Jcur; mais "
lljoOre que oerre courume ne fut pas
~rablie
parfai–
t cment pHmi le commun du peuple, avan.r le regne
d'Edouard
11.
car jurqula lors on ne prcnoin que le
nom de ron pere ;
li,
pdr exemple, le pere s 1appel–
loic
Richttrd.
le tils prena·c le no
m
de
Rl&h4rtl
[a11,
c'eil-i\-dire
fils
d~
Richard;
ma is depuis ce
rems"l~,
l'urag.c des
(i¡rnoms
fur érabli, :\ ce que
difep~
quel-
c¡ues auteurs, par un a.:le de parlemenr .
·
Les plus anciens
fortUJtiH
ront ceux que l'on rrou–
ve daos le grand
f•daflre
ou rerrier d'
Angl~rerre,
6f
donr la piOnan fonc
d~s
noms de place•, dev:tor lel–
quelles on m
N
la oarricule
dt.,
comme
Gode{ridus de
MatmM:illa, Walttrus d( Verno11, Roberf de 6yly,
é¡c.
J)•aurre,
nrenoren~
le nom ele "leÚrl peres, coinme
Qulidmtu fllius 0/htrlli ;
d'aurres le no
m
de leups
charge• , cnmme
Eudo. Dapifir,
fiulidm11~ Cam~rll ·
ritu. Gisltbe.r(IU
CO(U~ .
&c.
mdi~
les limpies
partl–
cu lier~
ne prenoienr q ue leur-s noms de baprchne,
fans y ajoOrer aucun
.for.no.m.
En Suede perranne nc prir de
Jimzom
avant
1
1
~n!1éc
11!4·
&
le commun du peuple n'en prend pomt
encare a<1jour.d' hui, nnn plus que les lolantlois, Po.
lqpois, Bohémiens,
&e.
Ceqx du pays
~e
Gtlles u'en prennent que_ depuis
peu, encare ne !ont ils formés que par la lupprer–
fion de l'4 daos le moo
ap ,
done ils ajourent le
fJ
au
nom de leur pere, oomme au-lieu de dire
Et~atzllp
./liu ,
ils d1feor aujourd"hui
I!.wm P.t·iu,
&c.
Durillar romi<lot _qu'originairemenr rous
les
for_·
tlo11u
fu"ent donnés par (arme de rubriqucrs,
&
,¡
ajoQre que tOU5 ocs
fornoms
ront fig nificaoifs
&
intel"
ligibles pour ocux qui el1tendem les anoiennes dia–
leéles des différens pays ;
La pliiparr des
fornoms
aogloi~,
&
~eux
des plus
grandes familles, loor des noms de rcrres de Nor–
maodie, oil ceux qui pa(J'erenr en Angleterre avec
Guillaume le conquer.anr,
&
qui porrerent les pre–
miers ces noms, avoienr leurs domaines, rels loor
les noms
Mortimtr.
ou
Morumart,
~tn·m
o u
Va –
rtnnu, Albigny
ou
Aubigny, Pitrcy, d
E!.wem:.,
Tan–
/<ervillt, Ntuil, Mont(ort,
&c.
11
ajoQrc qu'il n'y a
pas un village en
Normandi~,
qui n'ait donné le nom
a
quelque f•mille d'Anrrlecerr.e;
les· autres
/urnom.t
déri venr des plac.e.s
d'Añgl~rerre,
¡:ommt;
Ajhm, Sut–
ton, Wottou,
&c.
!larmi
les ancicns Saxons, les paroiculiers pre–
noient le nom de
bapr~me
de leur pere ou
ele
leur me –
re en
y
ajoáranr le mor
jitz;
plufieurs prcnoient le
filmom
de leur mérier, comme
]ean Maréchal, P1111l
OIJurpentitr, J ru;qu6
Tailltttr, Ft·an.fois Tixer11nd,
&c. d'aurres, cclu i"
de
leur otfice , comme
Portitr,
Cuijiui,tr, Som11uliot:, B(rgtr.,
Chllrrttit~,
&c. d'au–
rre>, ¡le leur complexio n ,
com~é
Fairfox ,
c'ell-a·
<lirc
luaux-cbtveiiX, blond
o u
JRIIIIt;
d'aurres, le
nom d'oifcaux, ·
comme Roitelet.; Pin.fon,
&c..
d'au.
eres, les noms d'animaux, comme
Mou&on, Lu.vre,
Ctrf,
&c. d'aurres, fe¡ n,oms
d~s
venes; d'aucres, les
noms des rainrs,
&&.
.En France le.s noms de familte fo,nc hérédicaires,
·
1wr
xr.
S
U R
tant popr le.s rorurien que .pour les nobles, ceux-d
renlemeor a¡oiirent un nombre au nom de
bapr~me
qu'ils peuvenr avoir commun avec leurs
anc~rres
ainli l'on dit .d:tns
les généa logies,
]tlm de Rache:
cho'!art, dtuxume du
~om;
qharlts dt E.ohan
Guemtnf,
troifieme
du
notn ;
mJ1s cecre
tl~nominacion num~r•le
n·~poartienr
qu'aux
~Inés d~s
mairons.
SURNOMMER, v. aél.
(
Grtw¡.)
c'ell ajoOrer un
nouve:w no.m
a
celui ele farnille
1
o
u de feigneurie
1
Voy~z
l'artt.:le
SuRwo~ .
S
URNUMÉRAlRE , adj. &
rubr. (
~am. )
qui
ell ¡
¡ar.de(Jus le nombre fixe
&
dérerminé .
ll
y
a
clei
aonv
ivesjt~riiNtnht:iru;
des otficiers, des i'oldatsfist•–
~umérairt.n
des juges
jiJrlltllllértiÍr~;
.
• SURli U!1ÉRAIRI! •
tn
Anatomie'
rom des parrics
qui ne s'obrervenr pas roojour•, ni en meme no
m~
bre, ni aux m6mes endrnirs; c'ell daos ce fens que
I'Ctn dit les os
fornttltJérai~t.t",
les muleles
fi~rnumi
r.ifir.u.
SpllNOMÉRAIRE
ou
AJOUTÉI,
Í.
f.
tn
M11(iqu• ,
6roit le nom de la plus ba(J'e carde du ry!leme dei
Grecs
¡
ils l'appelloienr en [eur langue
prosllunbano-
mmo• .
f/ayez.
ce
mof .
(S)
·
SURON
o11
SERON,
f.
m.
(
Co111111. )
bailar cou.
vert de pea
u
de bccuf fraiche & lans
appr~r,
le poi!
en-dedans
&
ooufu
a
vec des fileti
&
lanieres de la
m~me
pea
u ,
Ces ballors vienneor ordinairemen! de la nouvelle
Erpagne
&
de Bunos-Ayre¡ dans
1'
Amérique méri–
dion:lle . Les uns ronr rempl is
d'herb~
du Faraguai;
les aurres de cochenille ou aurres marchandiles. Ce
mor ell
crp~gool,
ma is franciré,
juro11e
en efpagnul
ngnifianr un
ballot . Dif!io11. dt comm.
t .
JI/.
· M
<;ham bers ohrcrvc que le
/isro11
o u
flron
d'a.
mamles pefe deux ccn< liv"es, celui de femence d'a.
nis depuis trois
a
qua¡re cens.
&
c~lui
de ravoo de
Uall•lle dipuis denx cens cinquanre jurqu•a rrois cens
roixante-quinze.
Dif!.
de
Chambtrs .
SUR-OS., r.
1'11·
chez lu Martcha11x,
ell une ex–
oroi!fance ou rumeur calleule
&
inrenfible, qui vient
~~~
canon du oheval au-de!fQIIS du genou , en-dcdans
ou en-dehors .
Ouand il y en a un aurre de l'autre el¡té en-dehon,
on
l•~pp~lle .ft•r
ot
ch~viiN,
paree qu'il perce, pour
ainfi dire. l'os;
il ell exrrememenr clangereux : les
uns
l'appell~nt
jur.osdoubl1 ,
&
d•aurres
for-os
qui
travt~:fe .
SUilPARTICULIERE, SURI'ATIE TE,
&o.
(
Rrrifon ) Voytz
RAISON •
SURPAS "E[\, v.
aét
&
o.
((Iramm.)
avoirde l'a.
vanrage rur fes fcmblables
&
lur
loi-m~ .ne ;
il s'eft
fo~pa./Jé
dans cene ucc"fian:
ce
chene
.fu•·paffi
en
hanteur tous les arbres de la forer: eecre
f~mmejur
paffi
en beauré rout ce que j"ai vu .
SURPAYER, v. aét.
1Gr11111111.
&
Co111tn1. )
paye~
un~
cliofe ·plus qu'elle oc devroir v1loir, en donner
au-delil de ron véritablc prix '
Piflio.n.
d~
COf11.
&
d~
Tr¿.v~""' .
SUi.l.PEAU, f. f. (
Atzat.)
perite peau qui couvre
la peau' & qui la ruit par-COUL
Voytz Cv
nc u
u;
~
El•!DEilM!:.
SURi' ENTE,
r.
f. (
Marhrt.. )
gvo(Je carde de trente
a quarante bra(J'es' qui ell
amarr~e
au grd(ltl mat
&
a
cclui de mi(aine,
a
laquelle on arrache le palan, pour
embarquer
&
débarquer. les canons , ou quelques
grancls fardeaux.
SU RPUS , r.
m.
t~rme.
rf
Bg
/ifl.,
ornemenr ecclé–
Gallique que les
pr~rres
récullers portenr l'éré par–
de!lus
leur ro.urane lorrqu'ils chanrent l'otfice '
0\1
qu'il s prtchenr.
ll
ell fait de roile & va jul"qu•a mi–
jambe, avcc deux a!les de
m~rnc
éc:.Jffe qm pendent
plus bas . M.
Gade~u
&
amrcs écrivenr
forpeJis,
&
¡e
croi~
que c'eft la bonne o.nographe, paree qu'il
eft a(J'eL vra i!femblable que ce mor vienr du
lacift
(up~rptllicimr.,
&
pJrcc qu'on le merroit autrefois fur
l'aumutle qoi couvroit la
r~re.
(D.
] . )
SURPLOMB , f; m.
(ArdJit. )
on di! qu' un mor
ell en
jitr-plomb,
quand il deverlc
&
qu'il n'cll pas
a-plo mb .
( D.
] .
)
SURP.LOMBER , v. aét. (
Sttr~tomie. . )
c'ell faire
pencher une ligne ou une furfJce a angle aigu aveo
l'horiro n; c'ell préciremenr tour le conrraire de
tal11d.
VoJM-
TA t uo .
SURPLUÉES,
Ut•me. de. Chttjfo,
ce fonr les voios
des
b~res
aores la pluie .
SURPLUS, f. m.
(
Gramm.
&
Comm.)
ce qui
ctl:
au-dela d'une cerraine quanriré, ou d'un cerrain pn:..
Les
marchands font
quel~uefl)ii
des oo,nver1rlons
J'OII,~
.
~e~e:,
~~
















