
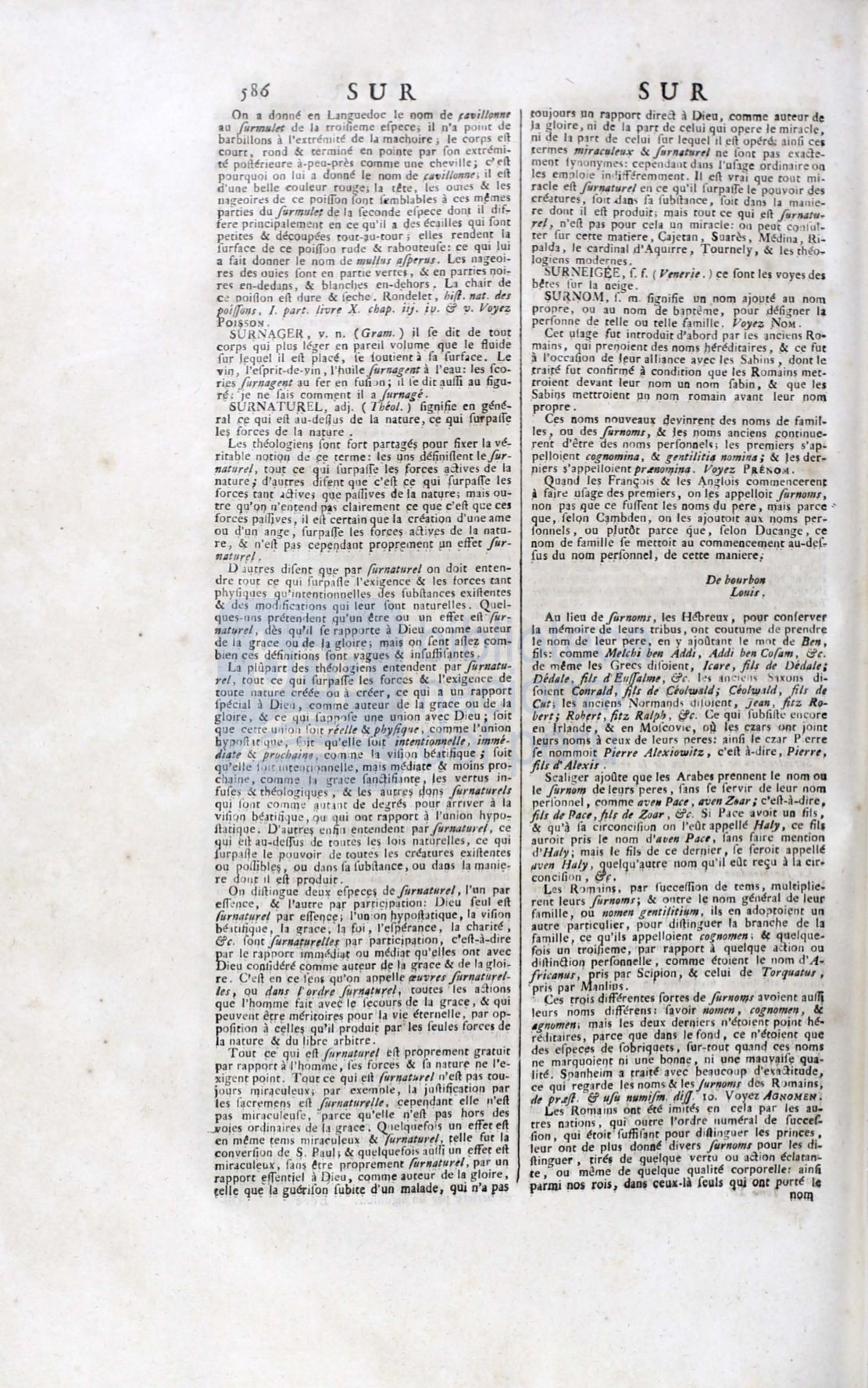
S
U
R
On
a
donné en unguedoc le oom de
p:oi/lq1111t
au
furmNkt
de la rro!lieme efpece; il n'a poltlt Je
blfb1llons
á
l'enrénmé de
Id
machuire; le corps
ell
courc, rood
&
terminé en poime par fon cnrémi–
té poiUrieure a-peo-prb comme une chevllle;
e'
efl
pourquoi on lui a donoé le nom de
c11oillomu,
il
efl
d 'une belle eouleur rouge; la
t~te ,
les
o111~s
&
les
01geoir~s
de ce poi!fon
(oQ t
li>mblables a ces
m~mes
parries du
formultt
de la feconde efpece dom il dif–
fere priocipalemem en ce qu'il a des éc-J1lles qui fon r
p erites
&
découpées rour-au-rour; elles renden.r
1~
furface de ce poi!fon rode
&
raboureufe: ce qUI lu1
a
fa ir donner le nom de
mullur l!.fPrrtu.
Les nageoi–
r es des ouies font
en
parne venes ,
&
en p3rtit"s r¡oi–
r e< en-dedJps,
&
blancl¡es en-dJ!hors ,
La
chair de
e~
pniflon en dure
&
feche. Rondelec ,
hi(l. 1111t. du
poí/foi/I,
J.
p11rt. líwe
X.
tbap. iij. jv.
&
'!'·
Voyq.
Po1 so;, .
S R1
I'}GER,
v.
n. (
Gram.
)
il fe dit de tour
corps qui plus
l~er
en Jlareil volume c¡ue le Bu ide
fur l!!quel il en
pla~é,
le
foutienr
a
fa furface. Le
v il), l'efprir-de-yin, l')mile
(urnagtnt
a
l'eau: les fco–
ries
forn11grnt
au fer en fuiiJ n; •l
fe
die auffi au 6gu–
r~'
·je ne fais
comm¡!n~
il a
..[urn11gé .
·
SUR
ATU_I~EL ,
ad¡. (
1btol. )
figr¡ifie en géné–
n l
t:(!
qui eO au-deijus de la narure ,
e~
qui fuy-pa!f!!
le~
forces <le la na.ture .
·
·
Les rhéologiens fon r fort
parragé~
pour 6xer la vé–
rirable notiQJ) de· !>=!!
terme :
l~s
uns
dé~niflenr
lefor–
natunf,
rou~
ce qui fu r paQ"e le$ forces
~él:ives
de la
narure
¡
d
1
~urres
diftl)t que c'!!ll
f!!
RUi {urpa!fe les
fo rces ran.r Aél:ive; qt,t!! paffives de la
nar~re ;
mais ou–
tre 9u'QI)
!l'eo~end p~~
cl airemenr ce que c'efl qce ces
forces paf!¡ves, il el! cerrain que la créarion d' une ame
o u
cj'~n
ange; furpa(fe les
forae~
aél:iyes de la nata–
re ,
&;.
1
n·e~
pas
cep~l)d~nr propr~m~~t
¡m
~lfer
for -
"llturr
.
·
·
D
Jl¡t¡es difent qu!' par
(i1rnaturd
on doit encen–
dre
~our
ce qui furpa ll e l'exigence
&
les torces tant
phyhques qu'rmenrionnelles
iles
fubnances exinentes
&
dq
1]10cldicltions qui leur fqnt naturelles . Q uel–
q ues-nns prérenrlen r ,qu'un
~ere
ou un elfer en
) ür–
natqre/,
des
ql!ld fe rappurre
~
_Dieu comme aureur
de la grace o¡¡
e¡~
)a
gloin;; n¡ars
Qr¡
fe!'t
afie~
f Om–
b ier¡ ces dé6nirions font
v~gues ~ infuffi f~nres ,
La plupart des théqlo"iens entendenr par
ji1m11tu–
re/,
rqur ce qui fur pa!fe les forccs
&
l'exigence de
too
re nacure créée ou
a
créer, ce qui a un rapporr
fpécinl
a
D ien , comme aureur de la g race ou de la
gloire ,
~
ce qt¡i fupp..,fe une uniory
a v~¡:
p ieu ; foir
qu~
cene uqio" foi r
d ellt
&
ph.Jfi'l'" ,
con¡n¡e l'union
by
r¡n lt•qll<',
(o
ir · qu'elle· fo•r
inte'ltion~t/le ,
immé–
tll'!!t
~ pr~chfiÍI!e,
con¡
me
13 viliQn
bé~rifique
;
fui~
q l!
1
elle
j.m
mtenp :melle ,
m~is
médiate
~
moins pro–
choir¡e , comme
h
grace
f~r¡~ifiJOr~,
)es
verrus in–
fu(~s.
&
rhéologiqul!s ,
&
les
atWf~
¡jQM
forntJturrii
qUJ lqn t comme #UC.lll t de Jegrés pOt¡f
.~rnver
a la
vilj~n
béatiljque 1 q u qui ont rapporr
~
l'union hypoo
ílaq que.
D'a utr~
en tjn enrendent par
furnaeunf,
ce
qui ell: au-
qe(fusJe rourc¡..
l~¡
lois nacureJies , ce qqi
f urpaqe. le
p.ouvoir de routes les créarures ¡!xillenres
oq
pofl1bl~,
pu
dl ns fa fubnance, ou daos la
mani~-
r e don¡ rl
~ll
produit .
·
On
dillingue deúic
efp,ec~~
de
ji1rnatllrel,
l'un par
e!f~nce , ~
i'aurre
·par
plrfi>i P~rion :
Dieu
f~ul
efl
(ur~¡q~'!re!
par
e!feqc~;
l'u!!;OIJ
pypo~arique,
la vi!io'!
bé:rphqne, la
grace ,
1~
foi ,
l'~fpéral!ce,
la chamé,
&c.
foqr
for.t~a_furdü¡
par
·particjp~tion,
c'!!n-a-dire
¡Jar le rapporc
imméqi~t
ou n¡édiar qu'ciJes onr avec
D ieu'copijdéré
~OOÍIT)e
aqt!!Ur
~~- ~~ gr~ce
&
de la gloi–
re . Clell en j:e
l~o¡
qu'on appellr
rzuvru jim¡tJturei–
Ju
1
ou
rfan!
1'
qrtfrr
.fof!lil!*Tf !
1 roures
les
a!tion~
que l'hon¡me fa it aveE le
f~cours
ge
la
grac~,
&
q01
pcuvent
err~ mériroir~
pour !a
vi¡:
éternelle ' par op–
pofition
~ c~lle~
qo!iJ
produi~ p~r
les feules forces de
la na cure
&
du
li~re
arbitre .
. T our ce'
~ni
·en
.(i~rntJtllrel
el!
prQprement graruit
par rapJlQrt
a
l'homme .. fes forces
&
fa r¡arur¡> (le l'e–
;<igent pqinr . T our ce qui !lll
(iJr'la.t:.r~l ·~'efl ~~s
cou–
)Ol!rs
n¡ir~cul ~ux ;
par exemple, la
¡unr~~ar•on
par
les
f~crem~ns
el!
.fornf!tllr,{le ,
f epe!jgant elle n'efl
p as
m iracule~fe ,
··paree qu'elle
'!'!;!fl pas /lors des
..JIOjes or.<Jiqaires de
1~
g race. Q••e l<¡uefois un
effe~ ~lt
en
m~me
Fems
n¡iracol~u~
!x
·¡,,rnaturd••
f~J!e
fut la
converGon de
~ -
ll~ul
¡
&
gn~lquefois
auU1 un ¡:lfet ell
miracul¡:ux, fans
~tre
propremenr
/ilriiiJfUrfl ,
pa~
UIJ
rapporr
~(fenr¡el ~
Qieu,
cqmn¡~
aureur de
1~ g~01re,
~~~~~ ~u~
!a
~ué¡-i(QQ fu~it~
g'un
malade,
qu¡
n
~ pa~
SUR
roojou.rslln. rapport dire
a
Oieu , comme
au~ur
de
¡~ alo~re,
01
de la pare de celui qui opere le mirJcle,
01
e
13
p~rr
de ceiUJ
fur lequel 11 en opérc!.: a1nfi ce,
cerme
mtrac11/~ux
&
jiun• Nutl
ne lont pas e
ade–
ment
lyquny_m~.:
ce endnuc daos
l'ufa~e .ordina~re
on
les em lo:e '"'·llféremment. ll efl vra1 que coot mi–
racle efl
fort~~uurtl
en ce qu'il furJlaffe le pouvo 1r c,les
créarures.' fo11
.dan•
fa fubibnee, fo1r dlm la mJnie–
re
do~t
•1 efl produic; mais t<?u t ce qui en
fornat<
1 •
rcl,
n efl pas pour cela un mrracle: on
eu 1 co:tful–
cer fur cerre mariere , Cajeran , S oares,
•lédina
lti–
pal~3,
le cardinal d'.'\qUJrre, J'ournely ,
&
les r'héo–
log:ens modernes.
b
U R.:'\'EIGÉ E,
f.
f.
(
PmtrÍt . )
ce font les voyes
de'
~re~
lur la oe!ge .
/)U~
•.
0 .\1 ,
l.
m. ligni6e uo nom ajouré au nom
propre, qu au nom
de
blpreme , pour
péfi
ner
la
perfonne de telle ou relle famllle .
Voyn
J
OM .
c;er
ub~e
fur
~nrroduir
d'abord par le
anc1~n
Ro·
rna:n ,
qur
prei)Oienr des noms hérédiraires,
&
ce fur
a
l oct"llfion de
J~ur
alliance avec le
ahins
done le
tra~~
fut confirn¡é a condirion que les
Rom~ins
mer–
rroJ_ent
deva n~
leur nom un nom
fabin,
&
que les
SabiQS mcrrroJent
~~~
ryom romain avanr
leur ,nom
propre .
Ces noms nouveaux ¡jeyinrent des .noms de famil–
les
o~,
des
fornomr,
&
)es I)Oil)S
anci~ns
t on'rinue–
renr _d erre des nnms perfonoel< ; les prep¡iers s'ap–
pe)lo•.enr
cogMmina,
&
gentiliti4 nomin4;
&
Jes
der–
,nicrs
$'appelloiencpr..rno11¡Ípa . Voyez
P,.t ·o ."ot.
9_uand les
Fran~;¡is
&
les !).n"lois commencerent
~
fa ,re p fag.e des premiers, on
l~l
app.elloir
fornomr,
non pas .que ce fu!fenr les ooms 4u pere
1
mais paree ·'
gue,.felqn
C~l))bc!en ,
on
les
ajouro•r aux noms per–
lonnels, ou p)utOr paree que, feIon Ducange , ce
nom de famille fe merroit au
commeoceme1¡~ ~u-d~f·
fus du nom pe¡fonnel , de cene maniere;
De
bourho11
fAuir ,
Au lieu de
fornomi,
les Hébreux, pour cooferver
Ja mt!moire de leurs tribus, onr courume de prenclre
le nom de leur pere, en y ajoOcanr le m r dé
B~ll,
61s: comme
Mekhi bm Add1, Addi ben Co(izm, &c.
efe
mlme les Grecs diloienr,
Jure,
fii-s
de DM111t;
DM11Ie ,
fiü
d'
Eulfolmc , &c.
l·.·s sn
·~~~~
1xon
di–
fo•enr
ConrtJiif,
jij:"
¡fe (:1oi!J14ld; r:;;olw.•ld,
/iif
dt
C11t;
les
a nci~ns Norma~d~
drjoJenr,
] un , fitz Ro–
b~r!(' J?o~rrt ,
/itz Ralpl! , (!c.
Ce qui iubfinc en.core
en
rl~nd~,
&
en Motcov,.,,
.ni}
1~ ~~r~
onr ¡ornt
le¡¡rs non¡s a ceux de leurs peres:
~infi
le czar P.crre
fe nommoit
Picrre
Al~xÍfYI»Ítz,
c'efl a-dire,
Piure,
filr
d'
Altxir
:
Scal iger ajoOte que les Arabes prennenr le nom oa
le
fornon¡
~e l~yrs
peres , fans fe fervJr de leur nom
perlonnel, comme
tlvt/1
P11ce , tl1Jm Zo11r;
c'ell-a-dire,
fiü
de-PtJu,filr
d~
Zo11r , &c.
Si Pdce avoir uo 6ls ,
&
qu'a fa circoncilion on l'eOr apJlellé
fll:ly,
ce fils
auroir pris le nom
d'11om Pa",
fans faiTe menrion
d'
Ha/y;
m~is
le 61s de ce der(lier, fe feroit appellé
¡JVrn
Ha/y,
~qqelqq'~u~re
110111 qu'il eilr rec;u
~
la
e
ir.
concifi on ,
& F,
·
Las
Rot}11in~.
par lilcceaion de tems, multiplie.
ren·t Jeurs
ji1rnom1;
&
?'!r~e
le _nom général _de leur
famille
1
pu
11omen
gentt/ttlf/11/,
1ls en adopfOI nr un
~utre p~rticqlier,
pour dil}iru:uer la branclle de la
fan¡ille
1
ce qu'ils
~ppeiiQienr
fOfnD111tn ;
~ q~elque
fois un rrc¡ij1eme, par rapporr
a
quelque aél:1on o
u
dilliné}ion perfonoelle , comme éroienr le nnm d'
A–
frica_nur·,'
pris.
p~r
Scipion
1
~
celui
d~
'[orqutJtur,
' pris par
M~nhus.
•
~es
rrqis dilférenres forres de
for11011!I
avoienr au!_li
leurs noms ditférens: favoir
1/QIIIttl,
cogno1f1m,
l!t
11
gn~mm ;
1]13Í~
·les deux
der~iers
n'étoient pojnt hé·
réd•ralres,
p~rce
que daos le fond, ce o'étpient que
des ·efpec¡!s
~~
fobri9qers, fur-rour quanq
ces
11oms
ne
marqqoi~r¡~
ni une
bonn~,
r¡i une
mauy,if~
qua–
lité .
S
anheiiT)
a
rr.airé
avec
J>eaucoup
d'e~aélirude,
ce qui regarde les noms
~
les
jllr(IOI1Jf
des
R
Jmains,
d~
prJjl.
f!
l!fo
11Uf1!i{t11.
rfifl.
10.
Yoyez
AoNoMEH.
· L
es Romains onr été im1rt<s
~n
cela par les
au.
cre·s
oario.ps;qui oucre
l
1
ordre numéral de Cuece(..
.fion, qui éroit. fuf!ifant
p~ur
di!linguer les princes_,
leur onr
~e plu~ ~ona~
·drvers
fornomr
~our
les dr–
flinguer, rirt<t de gu¡!I!Jue verru ou aél1on éclaran–
te
ou
m~me
de quelque qualité corporellt: ainú
pa;lllÍ
pos
rois
1
dan&
ceux-la
feuls llli) ooc
pon~
Le
·
pom
















