
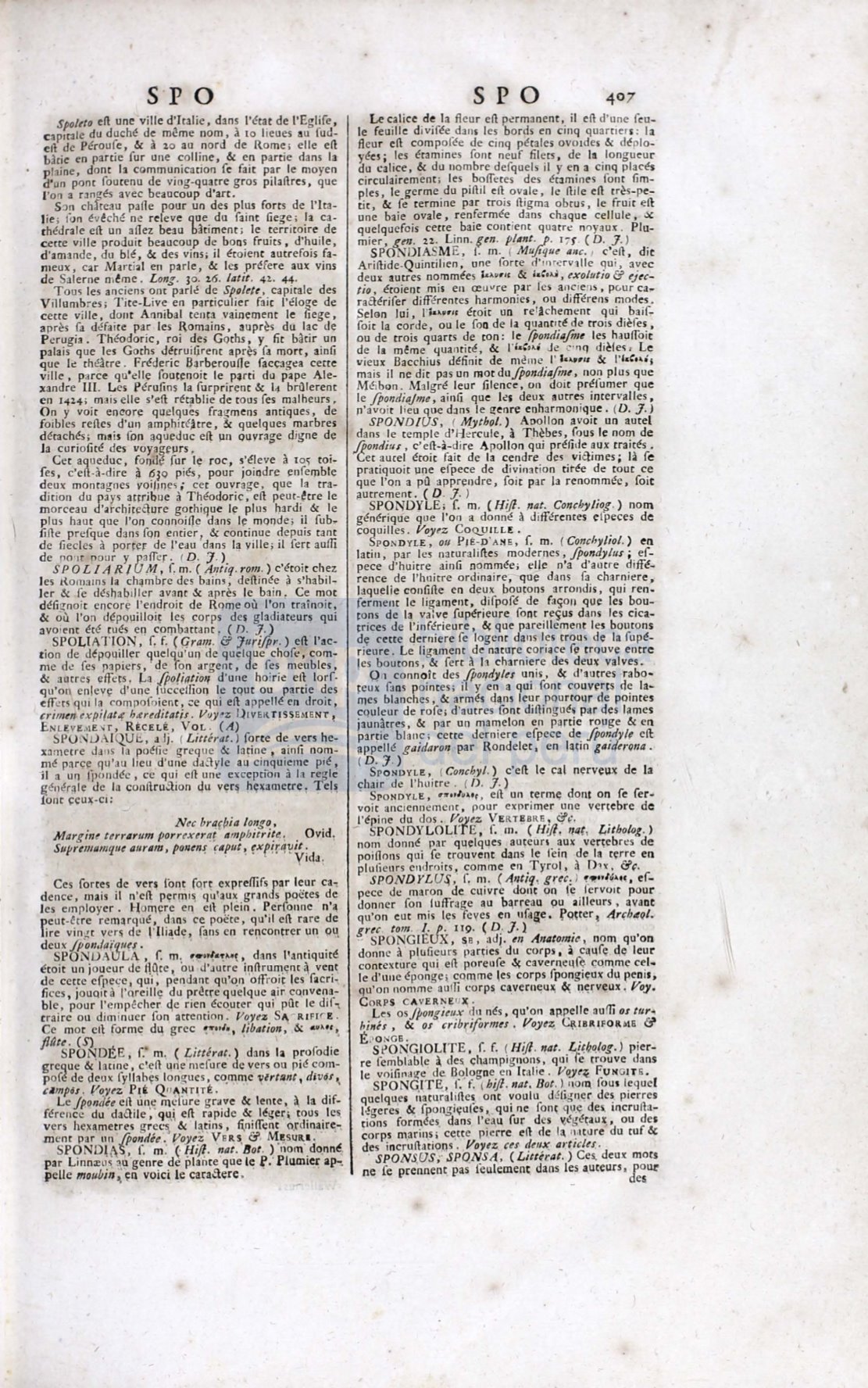
s·p o
Spo/tto
en une vi!le d'Italie, dans l'état de I'Eglife,
caprcale du duché de meme nOm,
a
lO Jieues au fud–
efl de Péroufe,
&
a
20
au nord de Rome ; elle en
b~cie
en parcie fur une colline,
&
en parrie dans la
p laioe, dom la communication fe fait par le
m
oyen
d'un pone fou cenu de viog-quacre gros pilanres, que
l'on a rangés avec beaocoup d'art.
S:>n
chl teau pafle pour un des plus forts de l'lta–
Jie ; fon
év~ché
ne releve que du faint liege; la ca–
thédrale en un aflez beau bariment ; le territoire de
certe vil!e produit beaucoup de boas fruirs , d'huile,
d'amande, du blé,
&
des vins;
il
étoient autrefois fa–
meux, car Marcial en parle,
&
les préfere aux vins
de Salerne
m~me .
Long.
JO.
26.
latit.
4•·
44·
Tous les anciens om
parl~
de
SpQütr,
capitale des
V illumbres ; Tite-Live en particulier faic
l'~loge
de
cecre ville, dorrt Annibal renta vainement le liege,
apres fa défaite par les
~omains, aupr~s
du lac de
Perugia . Théodoric, roí des Goths, y lit batir un
palars que les Goths détrur(irent apres fa more, ainli
que
1~
chéarre . Frécjeric Barberoul)e facr;au.:a cene
ville, paree qu'elle foufcnoit le partí do PaPe hle–
xandre
IIL
Les Pérulins la furprirenc
&
l4
bnllerenc
en
1424;
ma is elle s'e!l récablie de cous fes malheurs,
On y
voir
eneor~
quelqués fra •mens anciques , de
foibles renes d'ur¡
~mphitéltre,
&
qudques marbres
décachés; mais fon
~qu~duc
en
¡m
ouvraue
digne
de
la curiolité des voyagc11rs ,
·
"
Cet aqueduc,
fo~dll
fu r le roe, s'éleve
a
to; roí–
fes, c'efl .i\-dire
~
6JQ
piés, pour joindre cnfer¡¡ble
deux montagnes
voifj~es ;
cet
ouvrage, que la
tra–
dition du
pays
anribue
a
Théocloric, en peur-erre le
morceau d'ard¡ircé)ure gochique
1~
plus
nardi
&
le
plus haur que l'on
connoiq~
dans
lt
monde;
il
fub.
tille prefque dans fop encier
1
&
concinue depuis ranc
de fi ecles
a
porrer de )'eau daos
'ª
yille¡
il
[ere
auffi
de r o•rr r ur y paffer.
( D .
J.)
S PO
L
1,.,
P./
U
M
1
f.
m.
(
/11¡tiq. rom. )
c'étoit chez
les Romarns la
ch~mbre
des bains, de!linée
~
s'habil–
ler
&
fe désl¡al¡rJier avaqr
&
apres le bain. Ce mor
délignoit
e~core
l'endroir de Rqn¡e ou l'on trainoit ,
&
ou l'on
dépouilloi~ le~ ~orps
de$ gladiateurs qui
avorenc éré ¡ués e
o
CO!)lbarrant
1
(
[).
J. )
SPOI,lATIOt • f,
f. (
Gram.
&
l_t~riJP,.)
efl l'ac–
tion de dépouiller 9uelqu' u1] de quelque chofe, com–
me
d~
fes papiers,
~e
fon argenr, de fes meubles,
&
a1ltre$ affers , /...a
jfo!intio1¡
d'une l¡oirie ell lorf.
qu'ol\
enlev~
d'une luccelfior¡ le rqut ou partie des
etT~r
qur la compoíoient, ;:e qui en appellé en droir,
&rimen
o:pi{at~
lldtreditatis. Vuyez
Ur
YEit
ns~Eh!ENT
1
E NLI:YE.,,l!: 'IT, RtcELÉ,
V oL .
(A)
~POt
O
1 U
E. ,
a
Jj. (
Littérat.
J
forre de vers he–
xomecre da 11s la poéCie greque
&
la~ine
1
ainli nom–
mé
par~~
qu•au lieu d'une daélyle au cinquieme pré,
í l a
u~
ljwndéc , ce qui en une excepribn
a
la re"le
générªle de la conflru.:l:ion cju
y~r~ r~~ametre'
Teh
fonc
ceu~-c1:
N ce brac{lia longo,
Margine terrllrllm porrtxtrf!(
11mphi<ri~~ :
.
Ovid,
Sllprtmamqllt atlrtJm, pouens c111p11t, exptr.aVJt.
· · ·
· · · " " Vida ,
Ces forres de vers l'o'1t
fqrt
expreffifs par leur ca,
dence, mais il n'cn
peqnr~
qua
u~ grand~
pqetes de
les employer .
lium~re
en etl plein . Perfonne
n·~
peut-étre remarqué, daos ce poere, qu'il efl rare de
lire vin\{t
ver~
de l' lliade, fans en rencontrer un
QU
deux
jj)on.lai'que¡.
·
'
'
SP01 OA\JLA,
f.
m.
~~.,~·~••t,
daos t•antiquité
étoir un joueur de f!Qte
1
o
u
d'1urre
¡¡~flrum.~nt ~
vent
de cene efpec;e, qui, pendant
qu'~n
olfroic les facri–
tices, jouqir
a
('qreill~
du prerfe quelque air
conv~na
ble, pour l'empecher
~e
rien
éc~uter
qui pur le dif.,
traire ou dim inuer fon acrenrion.
V~yez s"~ RIF!rl~.
Ce mor etl forme dq grec
~"'•,
tibation,
& •••" ,
fliJte.
(S}
·
'
SP0/1\DÉE,
f.'
m, (
Littérat.)
daos la profodie
greque
&
laune, c!efl une mefure de vers ou pié com–
poíé de deux
fyllab~s
long ues, comme
wrtant
1
divos,
&ilmp6s . Voyez
Prt
Q •IANTITÉ . • ..
·
•
·
'
Le
fMndée
en une rnélilre gr•ve
&
lente,
a
la dif–
férence du daélile :·qu¡ en rapide
&
·~~r· ~ous le~
vers
he~~metres
g recs,'
&
lacios, fi.nifl'ent o.rdinaire.,
mene par
un . fi>ondée ·.
Voyez ' VeRs
&-
M!suu, ·
'
SPOND!(\!i', f.
m:
'(
Hifl.. 'nat. '!Jot.
)
'nom·
donn~
par Linn:eu au genre de planee que le
f :
Plumier
a~
pelle
moubin
;,'~n
voici le cara.:l:ere . · ·
·
/
S PO
Le
calic~
de la flcu r efl permanent, il efl d'une feo–
le feuille divifée dat15 les bords en cinq qoamers : la
fleur en compofée de cinq pécales ovo rdes
&
déplo–
yée5; les écamines fon t neuf fil ets, de la long ueur
du calice,
&
du nombre defquels il
y
en a cinq placés
circulair
emenr; lesbofferes des éramines fonr lim–
pies, le
germe.dupiflil en.
ov~le,
le flrle efl
cr~s-pe
rit,
&
f
e rermme par trors flrgma obtu>, le fru it efl
une baie ovale, ren!ermée. daos chaque cellule,
.x
quelquefois cetre bare conrrent
quarr~
nnyaux . Plu–
mier,
gm.
u.
Linn.
¡m. pltmt.
p.
r
; r
(D.
:J.
J
SPONDIA M E ,
l.
m. (
Mt~jiqt~e
1111c. 1
c'efl, dit
Ariflide.Quinrilren, une forte d' mrerv11le qui, 3 vec
deux aurres nommées
~<•••><
&
l&Cou,
exolutio
&
rjec–
tio,
écoieoc mis en reuvre par les
anc1ens, pvur ca,..
rattérifer ditTérentes harmonies, ou ditTérens mor!es.
SeiGn lui, 1'1•...,. écoit un
rel,lchemenc qui baif–
foir la corde, ou le fon de 1¡ quant•!é de rrois diefes,
ou de rrois quarts de con: le
fPondu¡ftne
les haufl'oit
de la mEme <juantiré,
&
1'1•'•••
Je
·nq dieles , Le
vieux Bacchius délinir de m
eme
1'
r..,,
&
1'1•'"'
1
mais il ne dit pasun
rnocdufPonrliafiJJe,
non plus que
Méibon . Malgré leur fiience, on doit pré(iJmer que
le
JPondi'!fme,
ainli que
ks
deux
~ocres
inrervalles,
n'avoir lieu que d3nS le l!'enre
~nharmorJique.
(D.
:J.)
SPOND/US,
(
Mythpl. )
Aoollon avoit un aurel
dans le temple d'I-Jercule,
a
Thebes, fous le nom de
jjo1JtiÍ11s ,
c'efl-~-dirc
Apollon qui préfiole auKtraités.
Cet aucel étoit fait de la cendre des vitlimes ;
1:1
fe
praciquoit ¡me efpece de divinarion titée de tour ce
que l'on a pu
appr~ndre,
foir par la renommée, foit
¡¡urremenr.
(D.
J .
)
SPONDYLE;
C.
m.
(
Hijl.
nat. Conrkylio¡. )
nom
générique que l'on a donné
~
ditTérenres elpeces de
¡:oquilles .
f/oyrz
COQ...UILL! .
SP9NDYLE,
011
P¡É-P ' MIE,
f.
m. (
Conchytiol. )
en
lariu , par les narural ines modernes,
JPondy/us;
ef–
pece d'huirre ainCi nommée;
~ile
n'a d'autre ditTé–
rence de l'huirre ordinaire, que dans
ía charniere,
laquelie conlifle en deux bou¡ons arrondis, qui
ren–
ferment le ligarr¡ent, difpofé de fac,;o11
que
les bou–
cons de la vaive fupérieure fonr rec,;us dans les cica–
rrices de l'inférieure.
~que
parei llement les bourons
d~
cecte
~erniere
fe logenr dans les trous de la fupé–
rieure. Le ligamenc de narure
cori~ce
fl! trouve entre
fes bourons,
&
fert ;\
h
charniere
de~
deu" valves.
Q
conno1t des
./Po•¡dyles
unís,
~
d'autres erabo·
¡eux fo os poinres;
il
y
en a qui fon t couvfrr <le la–
rr¡es blanches ,
&
armés
d~m
leur pourro11r de pointes
cquleur de rofe; d'aurres fi>nt di f!inguéo
p~r
des lames
jauniltres,
&
par un mameIon en partíe rouge
&
en
par~ie
blanc ; cette derniere efpece de
JPondyl~
efl:
appellé
gaidaron
par Rondelet. en
l~¡in $ai4~1'QIII/ .
( D.
J . )
SroNDYL!,
(
Conc~yl. )
e'
en
le
cal
n~rvelll(
de
la
chair de l'huirre . (
n.
:J.)
' SroNDYLE,
nnl•••¡ ,
efl un term¡; \font on fe fer•
voi t anciennemenr, pour exprimer une
v~nebre
de
l'épi ne du dos .
f/oyrz
VERTEBRE,
&r;.
-
SPONDYLOL{TE ,
f.
m. . (
Hifl,' tlat, l,ithqlog. )
nom donné ¡>ar
qt~elques
aureurs aux vertebres de
poiflons q ui fe trquvef1t dans le lei11 de la
t~rre
en
plu!ieurs endrnits, comme en Tyrol,
~
[),. ,
&~.
SPONDYL US,,'
f.
m.
(A,•Ith¡,·grei-. J
! .....
.;,,1,
ef–
pece de maron de cuivre donr 011
(e lervorc pour
donner fon
lutTrage au
b~rreau
QU
ailleurs , avant
qu'on eur mis les fcyes en ufaGe.
f~llt~r ~
A.rfhteql.
grtc. tom.
!.
p.
119.
(
D. ].}
'
" SPO
1
GlfUX,
so,
ad¡.
m Anatomic.,
nom qu'on
donne
a
plufieurs par¡ies du corps
1
a
C~11fr: <1~
Jeur
contexture' qui efl poreufe
~ cavert<e'1~
<;ommc;- cet.
le d' une éponge; comme les corps
fpongi~ux
d1,1 penis.
qu'on no
m
me au•Ti corps
c~vern~u>; ~
9.c;rvc;ux ..
1/oy,
CoRPS
CAVl!:RNEu~.
Les
osJPongietiX
du nés, qu'on appelle auffi
os
tllr~
¡,¡,;s
'
&
os cribr,ifonnes
.
f/oyez,
C~IBRIFO!lblE
e
É PO GS.
S PONGlOLITE, f. f.
(
Hifi.
nat.
Li~l¡~(o_!.
J
pier–
re ferñbla bl¡¡
3.
des
t;harr¡pignon~,
qui /'e crouve dans
le
voili11a~e
de Bologoe en lralte .
Voy~~
Fu>CGIT&.
SPONGITE,,
·~~· f.
(
hifl. nat, Bot. )
•tOill,
fous Jeque(
quelques riarural ifles ont voulu délig nc;r des pierres
tégeres
&
fpo11,gi~ules,
qui ne
fon~
qv.« des. Íl\crufla–
rions forinées. daos l'ea.u fur des
"égé~au".,
ou des
corps
m,arir~s;
cette pi erre
en
de
l'\
·~·•tu
re du tuf
&
des incruflariOQS.
f/oytz ces dmx;, artJC/es .
.
SPONS,US
;-
SPONSA.,
(
Litt~cat.)
Ces. deux mou
ne fe
prennenr pas
!eulemen~
daos les a.ureurs , pollt'
_
de$
















