
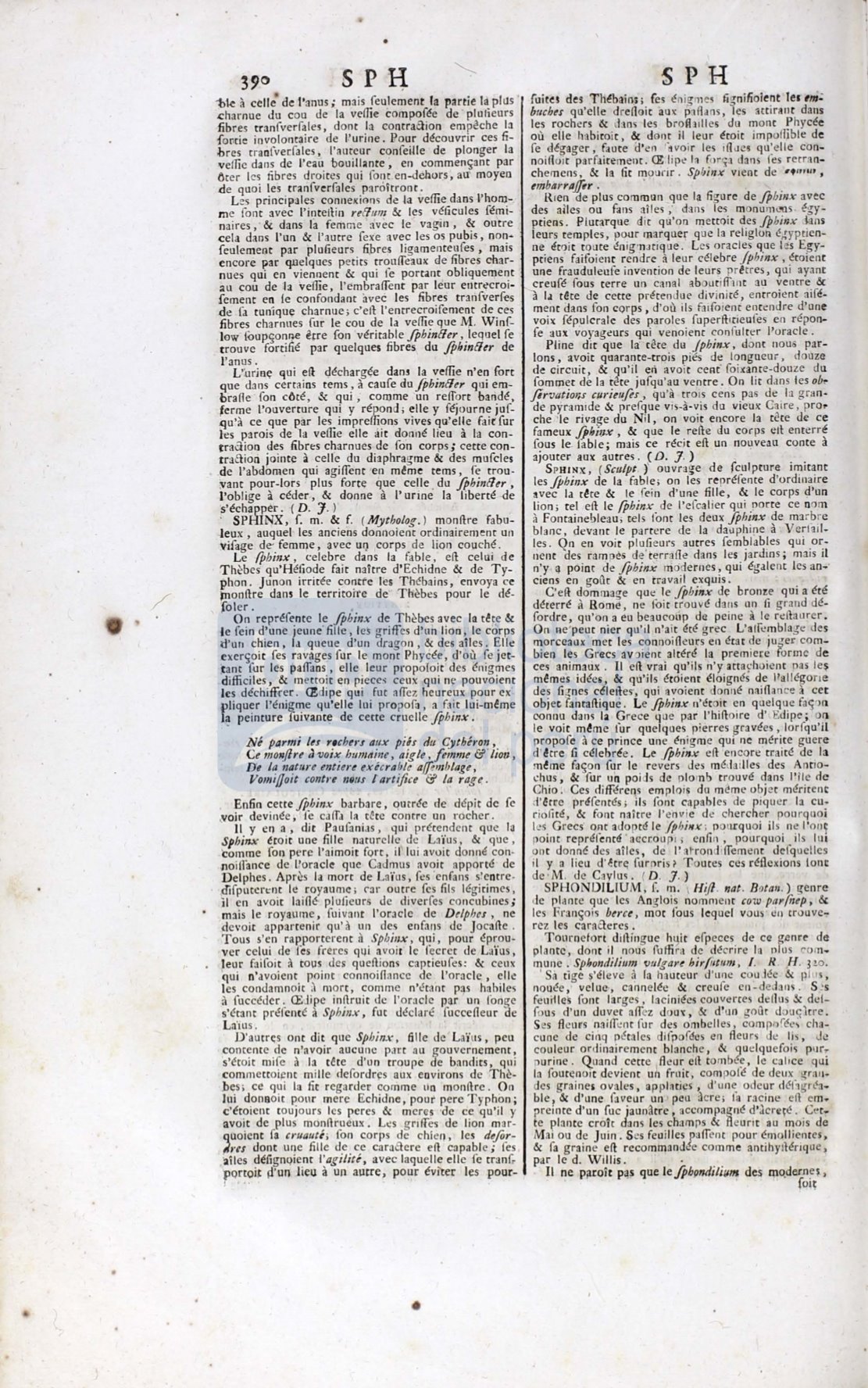
/
1>~
a
celle' de l'anus; mais feulement la partie la pllls .
charnue du cou de la ve!fie compofée de . plulieurs
fibres rranfverfales, dont la contraélion
emp~che
la
fontie involonraire de l.'urine. li'our découvrir ces
li–
-bres rraafverfales,
l'aureur confeille de plonger la
ve!fic dans ele I.'eau bouillante, en commensant par
1\rer les iibres droires qui fonr en-dehors, all' mayeo
¿ e quoi les rranfverfa les parolrronr.
Les principa les conne«iGns de
la
veífie daos i'hom–
mc
fon r
avec
l' inrellin
reflm11
&
les véficules fémi–
naires ' .
&
dans la femm e avec le vagin '
&
ourre
cela dans l'un
&
l'aurre fexe avec les os pubis, non–
fculemeor par pluiieurs fi,bres
ligamenteufes , mais
encore par qllelques perirs rrouffeaux de libres char–
nues qui en viennent
&
qui re portant obliquement
au cou de la ve!fie , l'embraffenr par leur emrecroi–
femenr en fe confondanr avec les libres tranfverfes
de fa runíque charnue; c'ell l'enrrecroifemeor de ces
fibres charnues fur le cou de la ve!fie que
Jl4.
Winf–
low !oupson,e erre Con vérirable
.fPhinfler ,
Iequel fe
t rouve fortilié par quelques libres du
JPhinfler
de
l'anus.
·
v:urin~
qui efl
décharg~e
dam la ve!fie n'en fort
que dans certains rems ,
a
caufe du
.{phin8er
q ui em–
braíle fon cOté,
&
qui , comme un re!l'orr bandé,
ferme l'ouverrure qui y répond ; elle y féjourne juf–
.qu'a ce que par les impreiTions vives qu.>eHe fa ir fur
les parois de 'la vellie elle ait donné líeu
a
la con–
traé.lioo des librts charnues de fon corps ; cerre con–
traélion jointe
a
celle du diaphragme
&
des mufcles
de !'abdomen qui agiffenr 'eu mc!me rems, le rrou –
:vant pour-lors · plus forte
i¡ue celle . du
.(phinfler,
l'oblige
a
céder'
&
donne
a
l' urine la liberté de
's'échapper . (
D.
J.
J
· SPHINX, f. m.
&
f.
( Mytbolog . )
monnre fabu–
Jeux, auquel
les
anciens donnoienr ordinairemenr un
vifage de- femn¡e, avec
UQ
corps de lion couché .
Le
fPbinx ,
celebre dans
la
fab le, en celui de
Thebes qu'Héliode fait nairre d'Echidne
&
de
Ty–
phon . Junon irrírée conrfe les Thébains, envoya ce
)nonnre dans le rerriroh'e de" Thebes pour le clé-
'foler .
•
On repréfenre le
./Pbinx
de Thebes avec la
r~re
&
le fein d'une jeune'lille' les griffes d!un !ion, le corps
ti'
un chien, la queue d'un
dragan,
&
des ailes . Elle
.exersoit fes ravages fur le monr Phyéée, d'otl fe jer–
~an t f<~r
les paífans, elle leur propoloir des
~nigmes
diflicíles,
&
merroir en píeces ceux qui
ne
pouvoienr
les déchiffar . <Edipe qui fue a!fez heureux pour ex·
pliquer
l'éni~me
qu'elle lui propofa , a fli t
lui-m~me
1~
peinrure
luivanr~
de cerre cruclle
jphinx.
Né
p4rmi /u rtcherf a11x pih
tltt
Cythéro11,
Ce fiiORjlre
a
voix lnmuline' afgle' femme & 'tiotl '
IYe la 11atllre entiere e.xhrablc a([e111blage,
Vomiffoit contre llftJS
r
artífice
&
la
Yf!ge..
Enfin cerre
JPbinx
barbare, qutrée de dépit de
Ce
,voír devinée ' fe ca (fa la tére conrre un rocher.
11
y er¡
a ,
dit Paufanias, qui prérendcnr que
1~
Sphinx
étoir une filie naturclle de Lai'us,
&
que,
comme fon pere l'aímoi¡ forr , il fui avoir donné con–
noi!lance de t:oracle que Cadmus avoir apporré de
Delphes.
Apr~s
la more de Lai'us, fes 'en fans s!enrre–
,difpurer~nr
le roya
u
me; car ourre fes fil s Iégitimes ,
il en avoir la iílé plulieurs de diverfes concubines ;
mais le royaume, fuivant l'oracle de
Ddphcs
,
ne
de\'Oit apparrenir qu'
a
un des enfaos de j ocane .
Tous s'en rapporterenr
il
Spbinx,
qui , pour éprou–
ver celui de fes fret·es
q~i
avoí1 le lecrer de Lai'us,
1eur faifoir
a
rous
des
quenions caprieufes:
&
ceux
qui n'avoienr point connoiílancc de l'ora cle, elle
les condamnoír
i\
more, comme n'éranr pas habiles
a
Cuccéder. CEJipe innruit de l'oracl c par .un fo nge
s'érant préfencé a
Sphinx,
fue déclaré Cucce!leur ae
La'ius .
·
D'aurr~s
onr dit que
Spbinx,
fi lie
de
Lai'us, peu
contente de n'avoir aucune pacr
a
u gouvernemenr ,
s'éroir mife
i\
la
rére d'un rroupe de bandirs, qu i
commerroi~m
mille
defordr~s
aux eovirons de The–
bes; ce qui la lit regarder comme
lío
monnre . On
l~i
d_onaoir
~our
mere li:chidne ,'pour pere Typhon;
e
éro1enr cou¡ours les peres
&
meres ·de ce qu'i l y
avoir de plus monnrueux.
L~s
urlffes de !ion mar–
quoient fa
e~·uauté;
fon corps
d~
chielJ,
les
dqor–
f/I'U
done une filie de ce caraaere en capable ; fes
2iles défignqienr
1'
agilité,
avec laquelle elle fe rranG
'portoi.t ¡!'un lieu
a
un aurre, pour évi'ter les pour–
l
.
•
~
P
H
fuit~!
des Thébain.1; fes énig111es fignifioient
le1
tm;
b11chu
qu'elle dre!loi r aux poAans, les atriranr dans
les rochers
&
dans les brollallles du monr Phycée
ou elle habiroic,
&
d"nr íl leur éroir impoílible de
fe dégager ' faure a'en 'itvoir les iíl ues qu'elle con–
noifloit parfairemenr.
CE
lip~
la for<;a dans les rerran–
chemens,
&
la fir mourir .
Spbi11x
v1enr de ''"'"',
tmbarrajfor
.
·
R1en ae plus commun que la fig ure de
JPbÍisx
avec
des alles ou fans alles; dans
les monumi!Qs .
~gy
priens. P.lurarque dit qu'on merroir des
jphinx
hns
leurs temples, pom marquer que la religlon é¡{ypticn–
ne éroir roure énig•nJtique . Les oracles que
les
Egy–
priens faifoienr rendre
a
leur célebre
.fphinx'
éroíent
une frauduleufe invenríon de leurs prerres , <¡ui ayant
creufé fous rerre un canal ab uri!rtnt au venere
&
a
ll
rere de cette prérendue divinicé' enrroienr aifé–
menr dans fon cor ps, d'ou lis faifo1en r encendre d'une
voix fépulcrale des parol es fuperlbrieufes
en
répon–
fe aux voyageurs qui venoienr conful rer l'oracle.
Pl ine die que fa· cece du
jphinx,
done nous par–
lons, avoit quaranre-trois piés
de
longueur, douze
de circuir
1
&
qu' il eri avoit cem' foixanre-douzc du
fommer de la rete jufqu'au venere. On lit ddns fes
ob.
jírv11tio11s curimfls,
qu'a rro1s cens pas de la gran–
de pyram1de
&
prefque
vis-a-vis
du
vieu x
Caire, pro.
che ·Ie rivage du N il, on voir encare la rete de ce
fa meux
.f}hiux,
&
que le reil:e du corps c:ll enterré
fous le. fabl e; mais ce récir en un nouvea
u
conre
a
ajourer aux autres.
(D.
J.
)
SrHINX, (
Sculpt
)'
ouvrage de fculptur.e
imirant
les
./Pbi11X
de la fable; on les repréfente d'ordinaire
avec la rc!re
&
le fein d'une filie,
&
le corps d'un
!ion; rel en le
{phinx
de l'efca lier qui norte ce nom
a Fomainebleau; rels Iom les deux
JPhinx
de marbre
blanc, devanr le
partere de
1~
dauphine
a
V
crtiul–
les . Qn en voir
plu.liem·s aurres
Cem~Iab!es
qui
.o~nenr Cles ram
e
s deierraíle dans les ¡ardms ; ma1s 1!
n'y
11
poinr de
./Phinx
niddernes, qui égalent les an.·
ciens en goOr
&
en iravai l exqllís .
C'ell dommage que le
.fpbinx
di! bronte qui a été
dérerré
a
Ro
me ,
ne foi r rrouvé daus un
1i
grand dé–
fordre, qu'on a eu beaucoiíp de peine
a
1~ r~naurer.
On ne·peur nier qu'il n'ait
ér~
grec L'alfcmblage des
morceaux mer les connoi!leurs en érar de
ju~er
com•
bien les Grecs av:lienr
alr~r~
la
premien~
torme de
ces animaux . Il en
vrai
qu'ils n'¡r atla>hoienr nas
le~
m~rnds
ídées,
&
qu'il&éroienr éloignés de llallégone
des
fi~nes
clfletles·, qui avoienr donné nai!lance
a
cet
objec tanranique. Le
JPbinx
u'éroir en quelque fa1'l n
ronnu dans la Grece que par l'binoi re d' Edipe ;
n
le voir mc!me !ur quelques pierres gravées, lorfqu'il
propofe
il
ce prince une
~nigme
qui ne mérire guere
d' ~rre
fi
c~lebrée.
Le
,fphinx
en encore rr.airé de la
m~me
fason fur le revers des mé,fatlles des AnriO–
~hus '
&
fur un poids de plomb rrouvé dans l'lle
ele
Chio. Ces diff.!rens
emploi~
do
m~me
objer mérirent
d'erre préfenrés; ils fonr qpables de piquer
la
cu–
riolíré,
&
fonr nairre l'envie de chercher pourquoi
les Grecs' onc adoprá le
fpbiHx ;
pourquoí ils ne
l'on~
poinr repréfenrá ' aqcr.oup1; enfir1, pourquoi ils lu1
onr donné des a?les , de I:atrond;(femenr defquelles
il y a lieu
d' ~rr~
fur ris
¡
T oures ces réflexíons lont
de ·M . de Caylus .
( D.
J. )
SPHONDILIUM ,
f.
m.
1Hijl . nat . Bota¡¡. )
genre
de plante que les Anglois nommenr
cow pap{nep ,
&
les Fransois
btrce,
mor fous lequel vous en rrouve–
rez les caraéteres .
Toucoefort dilling ue h':)it efpeces de ce ganre da
plante·, done il nous fuflira de décrire la olus
('0111·
mune.
Sphonditium !JIIIgane hirfi1t11m, l .
R .
,H.
J!o.
' Sa rige
~'éleve ~
fa haureur d'une couJée
&
pi·• ,
nouée, velue , cannelée
&
creufe en-dedans.
S ~s
feui1Ies fonr larges, laciniées couverces deOus
&
del–
fous d'un duver aífez doux,
&
d'un
~our
douc;1rre.
S
S
fleurs naiífcnr fur des oml>elles' compr>fée\ cha–
cune de
cinq
péml es difpofáes en fleu rs de
lis, Je
couleur ordinairemenr blanche,
&
quelquefoi~ pur~
ourine . Q uand cerre fleur en tombée, le callee qui
la fourenoir deviene
uh
fruir, compole de deux "rau–
des graine¡ ovales, applatí!!s , d'un': odeur
déligr~a.
ble
1
&
d'une faveu r un peu k re; la racine
ell
em.
premre d' un fue jaunílrre, accnmpagn.é
d'acrf~é.
Cer.
te plante croir dans les cbamrs
&
l!eum
a
u mois de
Mai ou de ]u in . Ses feuilles paífenr pour émoll ienres,
&
fa graine en recommandée comme anrihyllérique,
par le d. W illis.
·
.
·
·
Il ne
p~roit p~~
que le
fpbpndiliu"'"
de$ mqderne1,
·
foit
















