
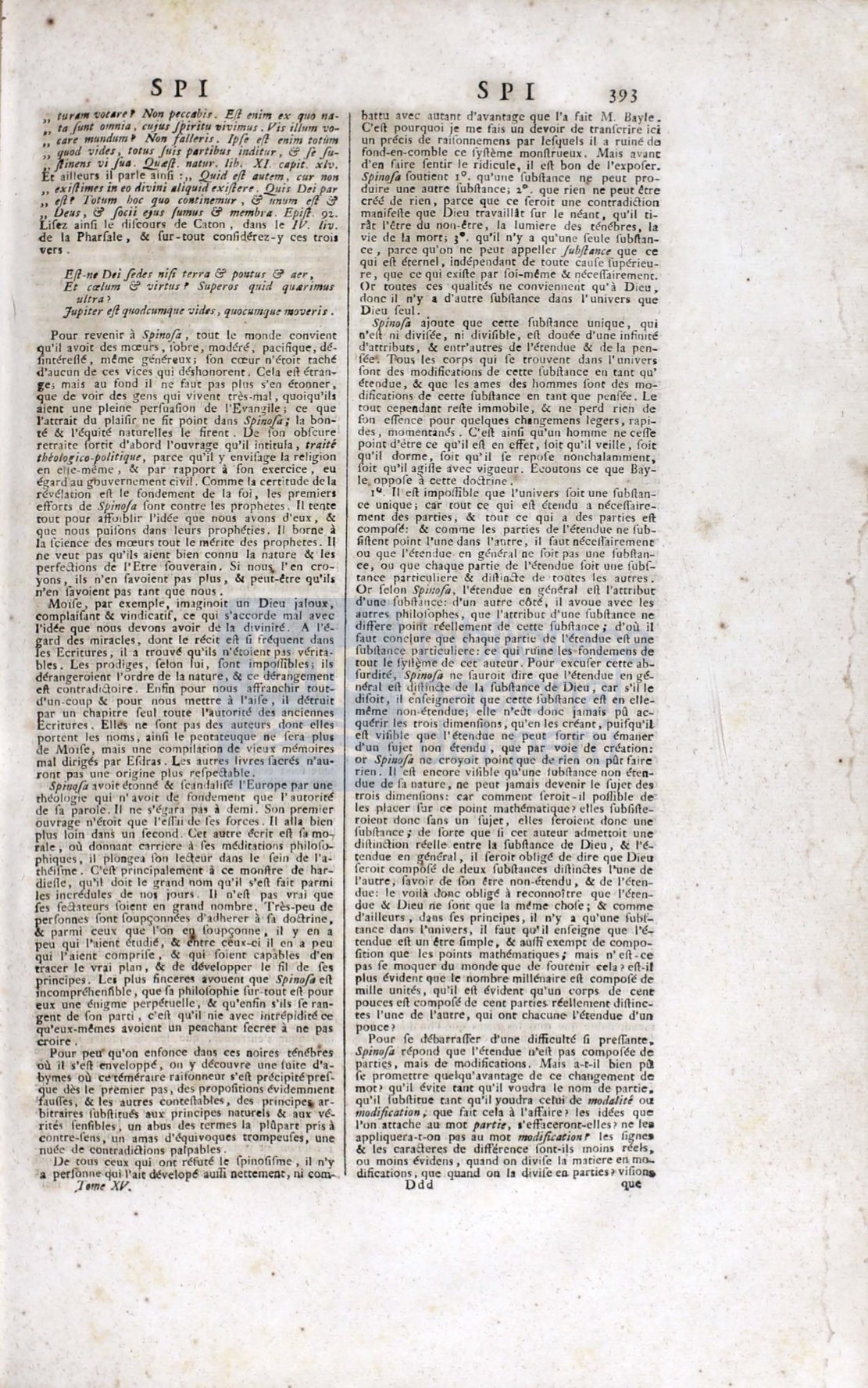
S PI
,.
turll"'
'1/0till'!
1
No_n
pe~~~~
ir . .
EJ!
~11im
ex t¡uo
1111·
.,
t11.font omma, <UJUr fpzrll'f 'IJIVImtu . Vir illum vo–
'"''
mtmdtmJ' Non
Jizll~rtr.
lp{e efl enim totum
;;
qu_od vid!.t, totur fuir p11rtibur. inditur,
&
fl
Jit–
'
jlmenr
VI
jü11 . Q!.ufl. natm·. ltb.
X/.
c11pit. xlv.
fl.r ailleurs
il
parle ain(i :,
f2!tid efl autem , cur non
,
exi(/imn
in
eo tlivini 11/iquid exijhu . f2!tir D•i par
,.
e/l
f
Totum
IJoc
!fUO
continemtlr
,
&
unum efl
&
,
beur,
&
.foú
i tJIII fumur
&
membr11 . Epij1.
91..
Lifn ainú le rli(cours de Caton , dans le
/V.
liv.
de la Phar(ale,
&
fur-tour conli<lérez-y ces rrois
vers.
l!fl-n,
o,;
.feder ni{i ,,,.a
&
poutur
&
tur.
Et ctrlum
&
virtur
f
Superor quid qtJIIrimur
ultra?
Jupiter
eft
quodcumque
-;;ides,
quoctJmque
1110v~ri
r .
Pour revenir
il
Spinofo
,
tour le monde conviene
qo'il avoit des ma::urs, (obre, modéré, pacifique, dé–
fintérellé,
m~me
généreux; Ion creur n'étoit
rach~
d'aucun de ces vi ces qui dt'shonorent . Cela ea étran–
re; mais au fond
i1
ne f:1ut pas plm s'en érooner,
c¡ue de voir des gens qui vivent tres-ma l, quoiqu'ils
aient une pleine perfuaúon de I'Evan<Tile; ce que
l'amait du plaifir ne lit point dans
Spi~oía
¡
la bon–
té
&
l'équité narurelles le firent .
De
ton
obfcure
retraite forrit d'aborel l'ouvrage qu'il intitula,
trait;
tMolo,rico-politiqt~e,
paree qu'il y envifage la religion
en
el le- m~me'
&
par rapport
a
ron exercice' eu
égard au glluverncment civil. Comme la certitude de la
r~v<!lanion
ea le fondement de la foi, les premiers
el!"ores de
Spinofa
font contre les prophetes .
11
rente
rout pour alfu•blir l'idée que nous avons d'eux,
&
que nous puifons dans leurs prophéries.
11
borne
a
la fcience des mreors rout le mo!rite des prophetes.
ll
ne veut pas qu'ib aient bien connu la nature
&
les
perfeélions de
1'
Erre fouverain. Si nou\
1'
en cro–
yons, ils n'en favoient pas plus,
&
peut-~tre
qu'ils
n'en
iavoient pas tdnt que nous.
Mo"ife, par exemple, imdginoit un Dieu jaloux,
complaifant
&
vindicatif, ce qui s'accorde mal avec
l'id~e
!JUe nous devons avoir de la divinicé .
A
l'é–
gard des miraeles , dont le récit el!
G
fréquent daos
fes Ecritures, il a
rrouv~
qu' ils n'écoient
p~s
vérita·
bies. Les prodlges, felon lui, font impoffibles; ils
dérangeroient l'ordre de la nature,
&
ce dérangement
eft contrddiéloire. En fin pour nous atrranchir tout–
d'un-coup
&
pour nous mettre
a
l'ai(e. il détruit
Jlar un chapitre feul route
l'~utoriré
des anciennes
Ecritures . Ell..-s ne font pas des aoteUl'S rlont elles
porrent les ¡1oms, ainfi le ¡>enrareuque ne fera plus
de Mo"1fe, mais une conlptl>ttion ele
vi
eux
mémoires
mal dirigés par Efilras. Les aurres livres facrés n'au–
.ront pas une origine plus refpeélable.
Spi11o.(d
avoir étonné
&
fcandalifé
1'
Europe par une
rhéolog•e qui n' avoit de fo ndement que
l'
autoricé
de fa paro!e.
11
ne s'égara pa•
ii
demi. Son premier
ouvrage n'éroit que l'e(fai
ue
res (orces.
ll
alla bien
plus loin dans un fecond .
Cet
autre écrit ea fa mo
rale, ou donnant carriere
a
fes méditations philofo–
phiqoes. il plongea ron leé\eur dans
le
fe in de l'a–
rh<!ifme. C'etl" principalement
a
ce monflre de har–
dielle, qu'il doir le grand nóm qu'il s'ell fait parmi
les incrédules de
110 1
joors .
ll
o•ea pas vrai que
fes (ethreurs foienr en gran
ti
nombre . Tres-peu de
perfonnes fonr
fou~nnées
d'adherer
a
Ca dofrrine,
&
parmi ceux que l'on e11. foupc¡onne, il y en a
peu
qu~
l'uient étu_dié,
&:
t'h~re
c_eux-c-i
il.
en a peu
qui
l'
:uent compnfe,
&
qut fo1enr capables d'en
tracer le vrai plan ,
&
de dávelopper le fil de fes
príncipes. Les plus fincert!! avouenr que
Spinofo
ea
mcompréhenfible, que fa philofophie fur-tout ea-pour
eux une énigme perpétuelle·,
&
qo'enfin s'ils fe ran–
genr de fon parti , e'en qu'il nie avec intrépldité
ce
qu'eux-m~mes
avoient un penchanr fecrer
a
ne pas
croire .
Pou• peu· qu'on enfonce daos c;:es noires té'nébres
QU 11
's'ell enyeloppé, on
y
décoovre une (uite d'a–
<byme~
pu ce•rémérn1re raifonneur s'ea précipité pref–
que des le pfemier pas , de!> propofitions évidemmenr
'fauffes,
&
les aurres contel!abtes, des priocipe ar–
bitraires fubairué's
&Ulll
príncipes namrels
&
ame v€–
rirés fenfibles :
un
abu
des
termes la plüparr pris
il
contre-fens, un amas d'équi voques
;~ompeufes,
une
nuée de comradiélions pafpables .
De
tous ceux qui ont réfuté le (pinoúfme, il n'y·
a
perfonne <jui l'a1t dé-velop6c
a.u!TI
nerremenc,
ni
com–
)ime
XV.
S
P I
393
battu avec
au~ant
d'avantage que l'a fait M. Bayle •
C'el! pourqu01 Je me fais un devoir de tranfcrire ici
un précis de raifonn.emens par lef<¡uels
i1
a ruiné el"
fond-en-comble ce tyaeme monarueux . Mais avanc
el'en f~ire
fentir le ridicule,
i1
ea bon de l'expofer.
Spillo.fo(oucient
1°.
qu'une fubaance ne peut pro–
duire une. aurre fubaance;
l.".
que rien · ne peut
~tre
eré~.
de nen, pa_rce que _ce feroit une conrradiélion
rna01fene que D•eu trava•llit fur le néant, qu'il ti–
rae
l'~tre
du
non-~tre'
la
lumiere des ténébres
la
vie ele la more;
J•.
qu'il n'y a qu' une feule
fubtÍ~n
ce .• paree
qu'o~
ne
p~ut
appeller
jubjl1111<e
que ce
qu1 en éternel_, mdépendant. de toure caufe fupérieu–
re, que ce qUl ex1ae par
fo1-m~me
&
néceffairemenr.
Or mutes ces qua lit¿s ne convienne•it qu'
a
D ieu
clone il n'y • d'autre fubaance dans
1'
univers
qu~
D ieu (eul.
Spi11o{a
ajoore que cette fnbl!ance unique, qui
o·ea ni
divil~e.
ni divifible. ea douée d'une infilllté
d'attributs,
&
emr'autres de l'étendue
&
de la pen–
fée . Thus les corps qui fe trouvent dans
1'
univers
font des modifications de cette fubaance en tant qu'
étrndue,
&
que les ames des hommes lont des mo–
dificarions de cecee fubaance en tant que penfée. Le
tou~
cependant
reae
immobile,
&
ne perd rien de
fon effence pour quelques ch1ngemens legers, rapi–
dos, momentanés. C'ea ainli qu'un homrne ne ceffe
point d'erre ce qu'il ell en clfet, loit qu'il veille, foi t
qu'il dorme, foit qu' il
fe repo(e nonchalamrnent,
foit qu'il
a~ille
avec vigueur. E.:outons ce que Bay–
le, oppofe
a
cette doélrine .
t".
11
ea impoffible que l'univcrs foi t une fubaan–
ce unique; car tour ce qui el! étendu
a
oécellaire–
ment des parties,
&
tout ce qui a des parties ell:
compofé:
&
comme les parties de l'étendul" ne fub–
linent point !'une dans l'atltre, il faut nécellairement
ou que l'étcndoe en général ne foit pas une fubllan–
ce, o
u
que chaque partie
de
l'étendue foit uue lubf–
tnnce particuliere
&
dinin.:le ele toares les aun·es .
Or felon
Spi11tij(J,
l'érendue en généra l en l'attribur
d'une (ublhncc: d'un autre cóté, il avooe avec les
a
utres philolophes, que l'atcrib ur d'une fu baance ne
dilrere point réellement de cene fu bllance ; d'ou il
faut conc¡ure que chaque parric de l'étendue en une
(ubllance particuliere: ce qui rUine les fondemens de
rour le
tytl~me
de cet aureur . Pour excufer cene ab–
furdité,
Spinofo
ne fauroit dire que l'étendue en gé–
néral el! dininéle de la fubllance de Dieu , car s'if le
difoit, il énfeigneroit que cette lubllance ell en elle–
meme non-étendue; elle n'eOt done jamais píl ac–
quérir les trois dimenfions, qu'en les créant, puifqu'il
ea
vilible que l'étendue ne peut fortir ou émaner
d'uo t_ujet non éreudu, que par voie 'de création:
or
Spmofo
ne croyoit p·oint que
d~
rien on pfit faire
rien. JI en encore vilible qu'unc lubllance non éten–
due de
f.1
nature, ne peut jamais devenir le fu jet des
trois dimenfions: car commem feroit-il pollible de·
les placer fue oe point mathématique ? elles fubúae–
r:oienr done fans un
fu jet , elles leroient rlonc une
tubnance; de force que li cet auteur aelmettoit une
diainélion réelle. entre la fubaance de Dieu,
&
l'é–
tendue en
~énéral,
il feroit obligé de dire que Oietr
fcroit compofé
de
rleux fubaances diainéles !'une de
l'autre . favoir
ere
ron
c!rre
non-étendu.
&
de l'éten–
due: le
voil~ tto~c
obligé
a
recomlOitre que l'éten–
due
&
Dieu ne font que la
m~me
chole; & comme
d'ailleurs, daas fes príncipes, il n'y a qu'une lubt:.
rance daos l'univers, il faut ql)' il en(eigne que l'é–
tendue
ea
un
~rre
fimple,
&
auffi exempt de compo–
lition que les poims mathématiques; mais n' ea- ce
pas fe moquer du monde que de fourenir
~el
a? ea-it
plus évidem que le nombre millénaire en compofé de
milie un ités, qu'il ea évictent qu'un corps. de cent
pouces ea compofé de cent partles.
r~ellement
dillinc–
tes !' une de l'autre, qui onr chacune l'étendue d'un
pouce?
.
Pour fe débarraífer d'une difficutté ú prelfante.
.Spinofo
répond que l'étendue nl'ea pas compofée de
partí~,
mais de modificatioos. Mais a-t-il bien
p~
fe promettre quelqu'Jvantage de ce changement de
mot! .qu'il évite tant qu'il voodra le nom de partie.
qu'il fubairue tant qu'i l youdra cetui de
modalité'
Oll
modification;
que fait cela
a
l'alfdire? les idées que
l'on attacbe au mot
parti~,
s'elraceront-elles ? ne lea
appliquera-t-oo
(Y.!
S
au mot
modi/ication
r
les úgnelll
&
les
caraéler~
de diff'érence IÓnt·ils moins réets.
ou moins évidens, quand on divife la
matiere ert mo..
dificatioos , que
qu.an.d
on ls qivife eo.
parti.es,i vifiona
Ddd
~e
















