
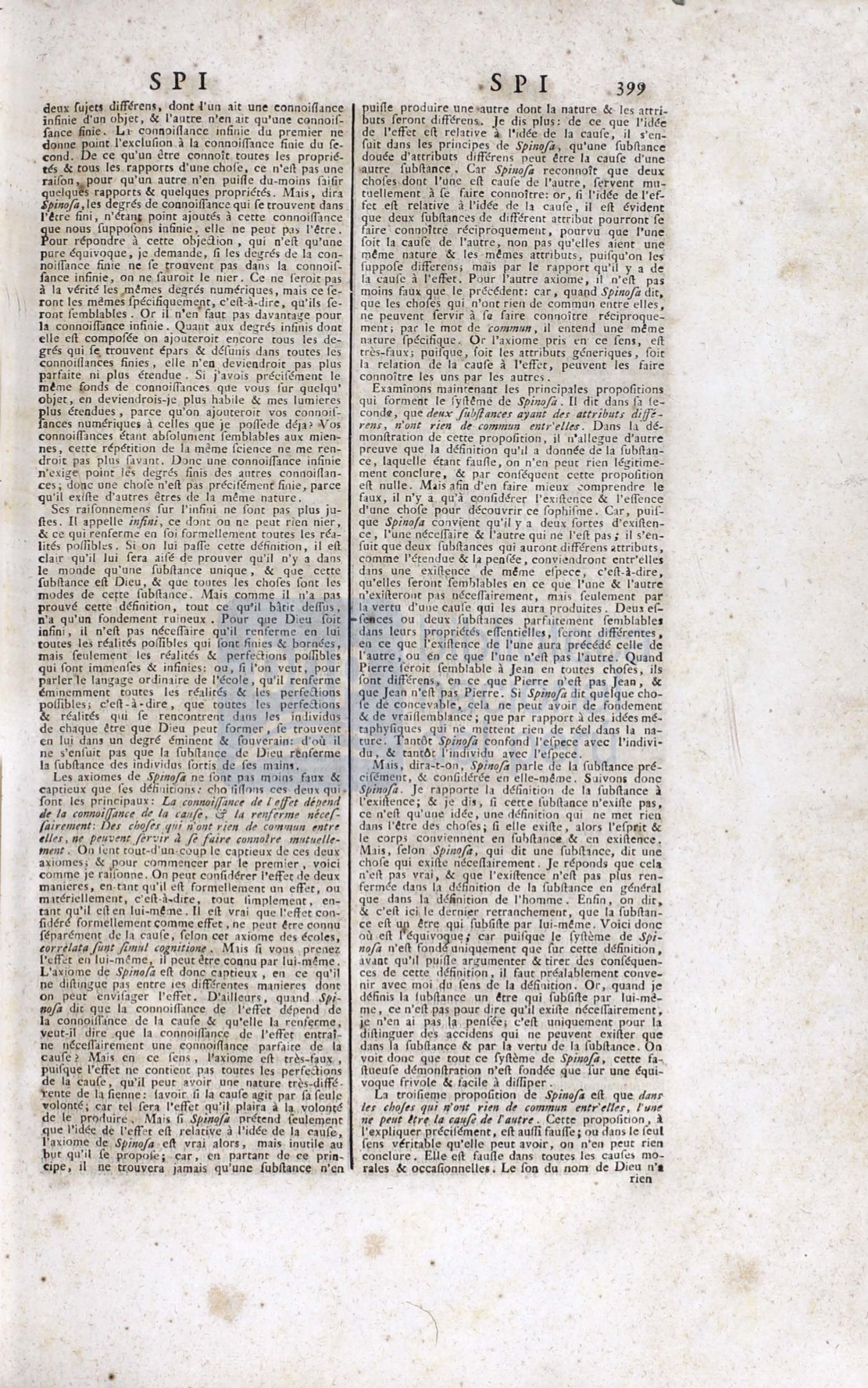
1 \
S P 1
deux fujers dilfércns,
~onr
1'un
~ir_
une eonnoillancc
infinie d'un ob¡er,
&
1
aurre n'en a1r qu'une conno!l–
fance finie . L :t- connoiflance infinie du premier ne
donne point l'excluGon
a
la connoil!'ance finie du fe–
cond . De ce qu'un erre connoir roures les proprié-
. tés
&
rous les rapporrs d'une chofe, ce n·en pas une
raifon, pour qu'un aurre n'en puille du-moins faifir
quelques rapporrs
&
quelques propriérés. Mais, dira
Epinojñ
,les degrés de connoil!'ance qui fe rrouvenr dans
l'~cre
fini, n'éranc poi
m
ajourés
~
cette connoil!'ance
que nous fuppofons infinie, elle ne peur
1"1>
l'érre.
Pour répondre
a
cette objeélion , qui n•en qu'une
pure équivoque, jc demande,
ti
les degrés de
13
con–
noil!'ance linie ne fe rrouvcnr pas
d~ns
la connoif–
fance inlinie, on ne fauroir le nier. Ce ne !eroir pas
il
la vériré les
~~mes
de<Trés numériques, mais ce fe–
ronr les mi!mes fpécifiqueme,nr, c•en-i\-dire, qü'ils fe–
ronr femblables . Or il n'en faur pas d,tvanrage pour
la connoillance infinie. Quanr aux dea rés inlinis donr
elle en compofée on ajou reroir encore rous les de–
grés qui fe. rrouvenr épars
&
défunis dans mures les
connoillances finies, elle n'en deviendroir pas plus
parfaire ni plus érendue . Si j'avois préc::ifémenr le
mlme fonds de connoiffitnces que vous fur quelqu'
objer, en deviendrois-je plus h:tbile
&
mes lumieres
plus érendues , paree qu'on ajomeroir vos connoif–
fances numérique5
:1
celles que je pollede déja? Vos
connoil!'ances
~ranr
abfolu01enr femblables aux mien–
nes, cert'e
r~péririon
de la meme fcience ne me ren–
droir pas plus favJnt. D one une connoil!'ance infinie
n 'exigt" poim les degrés finis des anrres connoillan–
ces; done une chofe n•en pas précifémenc finie, paree
qu'il exlne d'aurres
~eres
de la
m~
me narure.
Ses raifonnemens fur l'inlini ne fonr pas plus ju–
fies.
Il
appelle
i11ji1Ji ,
ce done o
o
nc peur rien nier,
&
ce qui renferme: en foi formellemenr mures les réa–
lirés pollibks. Si on lui pal1'e cerre défin irion, i
1
en
cla ir qu'il lui fera aifé de prouver qu'il n'y a dan
le monde qu'une fubnanc::e unique,
&
que cerre
fubnance en O ieu,
&
que
ro
ures les chofes íonr les
mudes de ce¡re fnbllance. Mais comme il n'a pas
prouvé cerre définirion,
rour
ce qu'il barir defi;us,
n'a qu'un fondemenr ru ineux • P our que D ieu
fojr
inlini,
il
n•en pas nécel!'aire qu'il
rcnferme en lui
toures le5 réal¡rés pollibles qui fonr finies
&
bornées,
mais feulemenr
les
réalirés
&
perfeélions pollibles
qui fom immenfes
&
inlinies: ou,
ti
l'on veur, pour
parler le langage ordimire de l'école, qu'il renferme
éminemmenr mures
les réalirés
&
les perfeélions
po$bles ; c'en-
a-
dire , que roures
les perfeélions
&
réa lirés qui
fe
renconrrenr dans les
individus
de chaque
~rre
que D ieu peu c former, fe rrouvenr
en luí daos un degré éminenr
&
fouverain: d'ou il
ne s'enfuir pas que la fubnance
de
D ieu
r~nferme
la fubnance des individus !(mis de fes mains.
Les axiomes de
Spi11ofi¡
ne lonc pas
m
ins faux
&
caprieux que fes déliniríons: cho"lillrms ces deux qui ,
fonr les principaux:
La co1lnoi!f!!nce de I'•Jfet drpmd
Je la connoi/Tancc de la •·a,¡fl,
&
la ret¡{erme
1Jéc~({airement: De.r chqfos
qtti
n'ont rieJt de
coJit'J~ml
e11tre
e/les,
ne pe!IVmt.férvir
a
fl
foire
CUIJIJ01re 1JIIItt1el/e–
tntllt .
On lenr rour-d'un-cou,p le caprieux de ces deux
axiomes ;
&
pour cnmme!lcer par le prem ier , voici
comme je raifonne. On peur contirlérer l'effer de deux
manieres, en-tanr qu'il en formellemenr
Ull
elfet, OU
marériellemenr, c•en.a,dire, rouc limplemenr, en–
ranr qu'il ell en
lui-m~me.
ll
en vrai que l'ef{er con–
fidéré fo¡·mellemenr .comme effer, ne peur én:e oonnu
féparémenr d!! la caule, lefon cer axiome des écoles,
eon·etat{l fo1)t
./imul
cog11itio11e
.
M
1is
íi
vous
prl)ne~
l'effer en lui-me!lle, il peur
~rre
coqnu par
lui-~~me.
L'ax.i,bme de
Spmo(a
ell done caprieux , en ce qu'il
pe diniC1gU.e pas entre
1es
différenres ml\nieres donr
011
peur
'envífager
l'effer. D 'ailleurs, quand
S
pi:..
rzofñ
dir qu¡:_
la connoiffimce de
l'effet dépend
de
la conóoil!'ánce de la ca,ufe
&
qtl'elle la
renf~rme,
:veuf;il dire .que la
connoiff~n<;~
de l'effer enrra)–
ne nécel!'airemenr une cÍqnooillanc,e parfaire
9e
la
caufe : Mais en
ce fen> ,
l'a~iOI]le
en
~r~s-f~u
,
puifqu~
l'etfet ne conrieor pas roures les perfeaiqns
de l'! ' cau(e, qu'il peur avoir une
n~rure rr~s-9ilfé.
l'ente de la tienne : favoic
ti
1~
caufe agir par fa feulf!
,olqnré; qr tel
[er~ l'c;tf~t ~q'jl p~aira
a
1:¡_
,volg
~é
~e
le prQduire . Mais.
ii S¡¡'-nifo
pr<~~end
teuleo¡ent;
que l'idé.e de l'effec en
relarí.ve¡¡
l'idée de la
cá\lfe,
l'a ~iol]le
de
Spinq(a
ef
l vra~ 'alors, mais inurile aú
J>~r
9u'il
fe
.p.ropofe ;
i:~r ;
¡:11
parrant de ·.,e
prin~ '
cipe,
i1
!l,e ti',ouvera' jamai:> qu'une fubfiance n'en
S P 1
39~
puille produire une •aurre donr la narure
&
les arrri–
bucs fcronr différens.
~e
dis plus : de ce que l'idée
de l'effer en relarive
a
l'idée de la caufe, il s'en–
fuir dans les príncipes de
Spinqfo,
qu'une fubnance
douée d'arrriburs différens peur
~rre
la caufe d'une
aurre [pbnance • Car
Spi11ojñ
reconnolr que deux
chofes donr l'une en caufe de l'aurre. íervenr mn–
ruellemenr .
a
[e
faire connoirre: or,
ti
l'idée de l'ef–
f~r
en relarive
a
l'idée de
11
caufe' il en éyident
que
deu~
fubnan ces de drfférent arrribur pourronr fe
faire ' connolrre réciproquement' pourvu que l'une
foir la caufe de l'aurre, non pas qu'elles aienr une
r¡¡~me
narure
&
les
m~mes
arrriburs, puifqu'on les
f¡¡ppoíe differens; mais par le rapporr qu'il y a de
la caufe ii l'effer. Pour l'aurre axiome, il n'en pas
moins faux, ,que le
pn~cédenr:
car, qua(ld
Spinofo
dir,
que les chp(es qui n'onr rien de commun en rre ell es,
11e
peuvenr fervir
i\
(a
faire connoirre
réciproq ue–
menr;
par le mor de
commun,
il cnrend une meme
norure
fpécifi9.ue. Or l'axiome prjs en ce fcns, en
rres-fa
ux.; puifque' foir les arrriburs géneriques' foit
la
relarion ele la ca ule
ii
l'effcr, peuvent les faire
connoirre les uos par les aurrcs.
Examinaos mainrenanr les principales propotirions
qui formen c le
fyn~me
de
Spi>Jo.fit .
[1
dir dans fa le–
conM, que
de!IX .fi!bfla>zces 11)/a/1& des attribllt>·
d~tf.¿l'e/1$ ,
tz'o11& rtm
d~
commun mtr'elle4'.
Dans la dé–
monnrarion de cerre propotirion, il n'al legue d'aurre
preuve que la délini rion qu'il a donnée de la fubna n–
ce, laquelle éranr faufle, on n'en peur rico légirime–
menr con
el
ure,
&
par conféqucnr cerre propotirion
en nulle. Mais
a
fin d'en faire mieux
.::omprendre le
faux, il n'y a qu'ii contidérer l' exrnence
&
l'el!'ence
d'one chofe pour découvrir ce fophifme. Car,
pu i!~
que
Spinq(a
convi"ent; qu'il y
a
deux for res d'exinen–
ce, l'une nécel!'aire
&
l.'aurre qui ne l'en pas; il s'en-
fuit que dcux fuhnances qui auronc différens arrribucs,
comme l'érendue
&
la penfée, conviendronr enrr'elles
1
daos une 'exi(lence ele méme
e(
pece, c'en-a-dire ,
qu'elles feronr 'lemblables en ce que l'une
&
l'aurre
' n'exillerour pas néce11'airemenr, mais feulemenr par
la verru d'une caure qui les aura produires. Deu> ef–
fet~ces
ou deux [ubnances P.arfai remenr
femblables
dans leurs propriérés el!'enrielles, fcronr différenres,
en ce que l'exinence de l'une aura précédé celle de
l'aurre, ou én ce que l'une n'en pas l'aurre. Quand
Pierre fcroir íembtable
a
Jeao en ronces chofes, ils
fonr différens ' en ce que Pierre n
1
eft pas JeaR,
&
que J ean n'en pas Pierre. Si
Spimifa
dir quefque cho–
fe de concevable,. cela ne peur
avoir
de fondemenr
&
de vniillemblance; que par rapport
a
des idées mé–
raphytigues qui ne merrenr rien de réel daos la na–
cure . Tanror
Spi11qfo
confond l'e(pece avec
l'indivi–
du,
&
rantÓ \ l'individu avec l'efpece.
Mais, dira-r-on,
Spinojñ
parle de
13
fubnance pré–
cifémenr,
&
confidérée en elle-OJéme. Suivon5 dono
Spi11ojñ .
Je rapporre la délioirion de la fubnan ce
a
('exi!lence;
&
je dis,
ti
cene fubna nce n'exille pas,
ce n'en qu' une idée, une eléfinirion qui ne mer rien
da11s
l'~cre
des chafes;
ti
elle exine, alors l'efprit
&
le corps conviennenr en funnance
&
en exinence.
Mais, felon
Spimifir,
qui dir une fubnance, dir une
chofe qui exine nécellairemenr .
]e
réponds que cela
n·~n
pas vrai,
&
que l'exinence n'en pas plus ren–
fermée dans l¡t délinition de la fubnance en général
que dans la déñn irion de l'homme. En!in, on die,
&
c'en ici le
derni.~r
rerranchemenr, que la fubnan–
ce en up er-re q11L fubGne par lui-m!!me. Voici done
ou en
1
équivÓSI,U~;
car puifque le fyneme de
Spi–
tzofo
n•en fondífuniquemenr que fur cerre délinirion,
avanc qu'1l pu[ll e argumenrer
&
rirer des conféquen–
ces de cerre
' .Jé~{li~ion,
il faur
pr~alablemenr
conve–
nir avec moi ¡ju fens de la
délini~ion.
O r, ,quand je
définis la
1
ubfla
nce un
~rre
qui fubtine par lui-mi!–
me, ce n'en p;¡s
go.ur~ire
qu'il exine nécel!'airemenr,
je n'en ai pas
l
í\ _penleé; c•en uniquemenr pour la
dinlnguer
d~'s
accidens qui ne peuvenr e,..iner que
d~ns
la fubllance
&
par- la verru de
la
[ubnance. On
voir done
gqe
cout ce fyneme de
Spino(a,
cerre fa-.
nueufe démonnration n•en fondée que iur une équi–
voque frivÓie
&
faci le
a
dilliper .
La
croi!ieme propotirion de
SpitJojñ
en que.
dallr–
lu &boja qt•i n'o11t rim de commrm entr'dtu, l'unt!
11e pmt l(rf. la· carifo de
f
autn .
Certe propotirion , :\
l•e¡cpliquer
~récilement.
en auffi fa u!fe; ou dans le (cul
íens
v~rirable
qu'elle peur avoir, on n'en peur ríen
"conclúre' .
E~le
en fa u!le dan.s roures les ca
uf~$
mo–
rales
&
occalionnellei. Le íon du nom de Die';! n'a
nen
















