
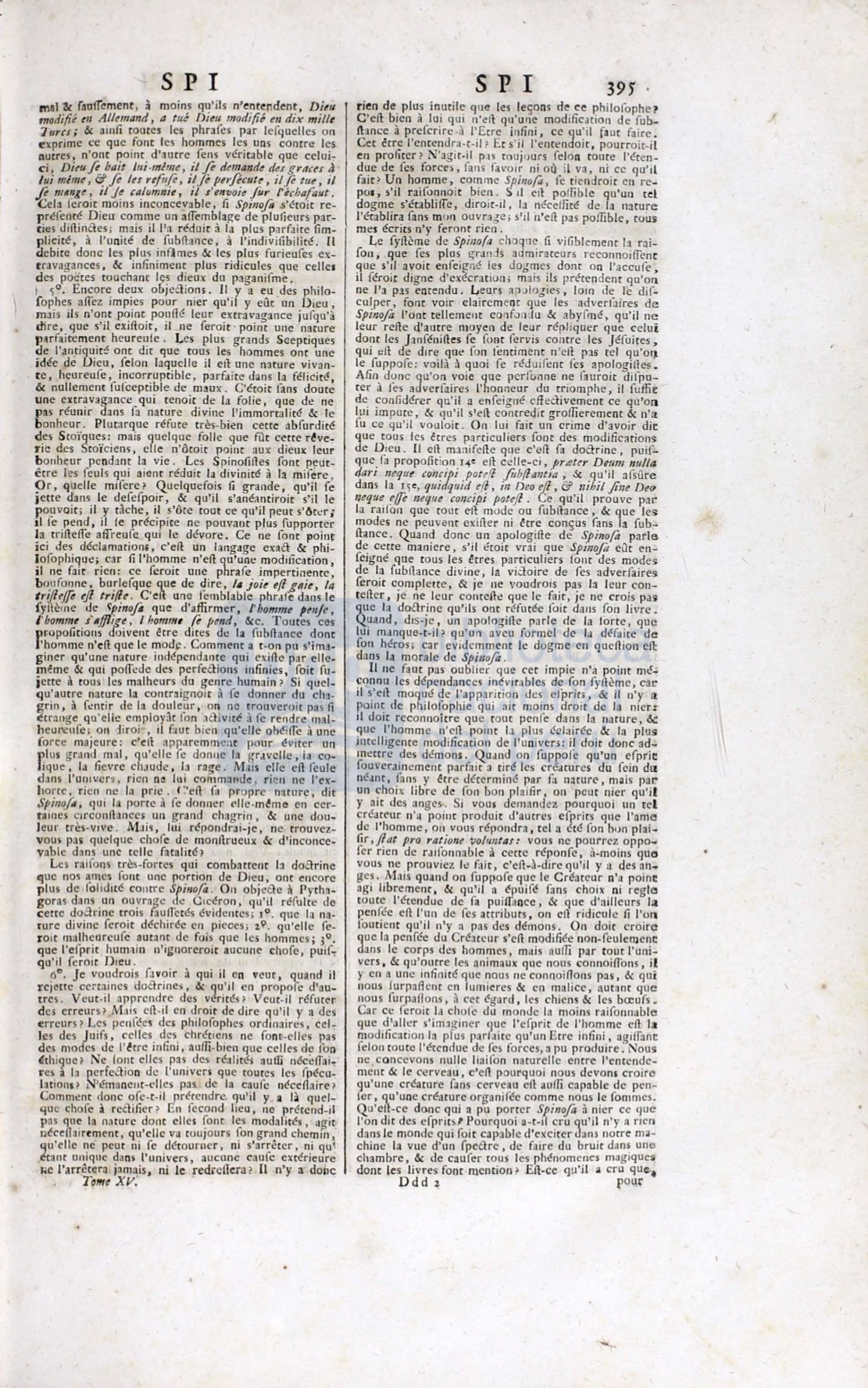
S PI
mal
&
rau1Tement,
a
moins qu'ils n'entendent,
Dim
modifié m
All~mand,
a trté Diert modifié m dix milit
'] 11
rcs;
& ainli routes les phrafes par lefquelles on
exprime ce que font les hommes les uns contre les
nutres, n'ont point d'autre fens véritablc que celui–
ci,
Dieuft bait lt<i-mime, it
ft
demand~
des g racu
A
tui méme,
&
fl
tu rifi!fe,
il
fl
P•rflcrete, il
ft
tu~,
il
Ji
m1nge, ilje
calomni~.
it s'envoie
for
l'icbafaut.
Cela feroit moins inconcevable, li
Spimifñ
.s'étoit re–
préfencé Dieu commc un a!femblage de plufieurs par–
ties diflinéles ; mais il l'a réduic
a
la plus parfaite lim–
plicité'
¡¡
l' unité de fubflance'
a
l'indivillbiliré .
[J
debite dona les plus inqmes
&
les plus furieufes ex–
rravagances ,
&
inliniment plus ridicules que celles
d es poetes couchanc
~~~ d~eux
du paganifme.
1
s
0 •
En~or<:
de_ux ob¡eélwns. ll _y a eu des J?hilo–
fophes aflez 1mp1es pour nter qu'JI y eilt un l)ieu ,
rnais ils n'onr point poullé leur extravagance jufqu'a
di
re, que s'il exifloit, il ne feroir · point une 'nature
parfaitemenc heureule . Les plus grands Saeptiques
de l'antiquit!! ont dit que tous les hommes ont une
idée de Uicu, felon !aquella il efl une natu•e vivan–
re, heureufe, incorruptible, parfaitc daos la félicité,
&
nullement fuCoeptible de
m~ux .
C'étoit fa ns doute
une extra vagance qui cenoit de la folie, qua dt! ne
pas réunir daos fa nature divine Jlimmortalit<l
&
le
bonheu r . Plucarque réfute eres-bien cette abfurdité
des Sroi'qucs: mais quelque folle que file cette
r~ve
J'ic des Stoi'ciens, elle n'oroit point aux dieux leur
b ouheur pendant la vie . Les Spinofifles font
p~ut
etre les feu ls qui aianc réduir la divinicá
~
la mifere '
Or, qllelle mifere? Quelquefois li grande, qu'il fe
jcne daos le defefpoir, & qu'i 1 s'anéanriroic s'il le
pouvoit; il y dehe,
il
s'llte tour ae qu'il peuc
s'ót~r
¡
ti
fe pend, il fe précipite ne pouvant plus fupporter
la triflefle afrreuf11 qui le dévorc. Ce ne font poinr
ici
des déclamations, c'efl un langage exaé\
&
phi–
lofophique; car li l'homme n'efl qu'une modificacion,
il ne faic
ricn: ce feroit une phrafe impertinente,
boufonne,
burlefqu~
que de dire,
l• joie
e/1
gnie, /4
trifleffi
tjf
trifle.
C'efl une lemblable phrdfe dans le
fyflerne de
·~einofo
que d'affirmer,
f
homme 'mfe,
l 'homme l11jj1rge,
1
bomm1
(e
pcnd,
&c. Toutes ces
f.
r.opolitions doivent erre dices de la fubflance done
homme n'efl que le mod!! . Comment a r-on pu s'ima–
giuer qu'une nature indépendante qui exifle par eqe–
rneme
&
qui po!fede des perfeélions infinies, foir fu–
jetre
a
tous les malheurs du genre humain? Si quel–
qu'aurre narure la contraignoit
a
fe donner du cha–
grín,
a
fentir de la douleur, on ne trouveroit pas
f1
ctrange qu'elie employat fon aélivir-é
a
fe rendre mal–
heureufe ;
011
diroi·· '
il
f~ut
bien qu'elle obéi!fe
a
une
force majeure: c'ell apparemmeat pour éviter u
11
plus grand mal, qu'elle
(e
donne la grave! le, ia co–
ligue, la
li~vre ch~ude ,
la ra<>e. Mais el re efl fe ule
dans
l'unt~<ers,
rien
n~
l11i
co~1mat•de ,
ríen ne l'ex–
horcc, rien ne la prie .
1
:•ef! fa pmpre nacure, dit
Spimlj4,
qui la porte
a
fe donner elle-m<!me eri oer–
taines CJrconflances un gra nd chagrín ,
&
une dou,
Jeur tres-vive . Mais, fui
répondrai-je, ne, trouvez–
vous pas quelque chofe de mo11flrueux
&
d'inconce–
vable daos une telle fatalité
l
Les raifoqs eres-forres qui combattent 13 doélrine
"lue nos ames fonc une porrion de Dieu, onc encare
plus de folidité COil[(e
Spinofa .
On objeéle
a
Pyrha–
goras dans un ou vraa-e de C tcéron, qu'il réfulte de
cette doélrine trois f:;u!fecés évidemes;
1°.
que la na–
rore
divin~
feroir déchirée en pieces;
1.9.
qu'elle fe–
roit malheoreufé aurant de fois que les hommes; 3"'·
que l'efprit
hum~in
n'ignoreroit aucun" ehofe,
puif~
qu'il feroit Dieu .
6".
Je voudrois fa voir
a
qoi il en veut, quand
il
rej~tte
cenai nes doélrines,
&
qu'il en propofe d'au–
trcs. Veut-il apprendre des vérités? Veut-il réfurer.
des erreurs? Mais efl-il en droir de dire qu'il y a des
erreurs? Les penfées
des
philofophes ordinaires, eel–
les des Ju ifs , celles des chréciens ne fonl'-elles pas
des modes de
l'~tre
inlini, aulli-bien que
ce
!les de fon
'thique
¡
Ne font elles pas des céalités auffi
néce!fai~
res
a
la perfeélion de l'univers que cauces les fpécu–
Jacions
¡
N'émanent-dles pas de la caufe nécefl aire?
Comm~nr
done ofe-t-il précendre. qu'il y a la
que!~
que chofe
a
reélilien En fecond lieo, ne prétend-il
pas que la narure dont elles font les modalirés, a,gir,
nécellairemenc, qu'elle va coujours fon grand chemm ;
qu'elle ne peur ni fe décaurner, ni s'arnher, ni qul
étanc unique dans l'univers, aucune caufe extérieure
¡¡e l'arretera
jam~is,
ni le redre!lera? ll n'y a
don~
"(om~
xr.
S P I
39) .
rien de plus inurile que les le'ions de ce philofophe
~
C'efl bien
a
fui qui n'efl qu'une moditicdtion de fub-
1lance
a
prefcrire
a
l'Etre infini, ce qu'il fauc faire .
Cet erre l'emendra-t-il ? Et s'il l'entendoic, pourroit-il
en profiter ?
l
'agic-il pas coujours fe lon cauce l'éten–
due de fes forces, fans lavoir ni oi) il va, ni ce qu'il
fait? Un homme, comme
Spinofa,
le tiendroir en re–
pCJJ, s'il raifonnoit bien . S
JI
efl poffibl e qu•un
tel
dogme s'ét,tbli!fe, diroit-il,
la
nécellité de la nature
l'écablira fans muo ouvrage; s'il n'efl pas pollible, tous
mes écrics n'y feront ríen .
Le fyfleme de
Spi!Jo(a
choque li vifibl emem la rai–
fon, que fes plus grands admiraceurs reconnoi!fenc
que s'il· avoit enfeigné les dogmcs done on l'accufe
il féroit digne d'exécracion; mais !ls préte 0 ciem qu•o,;
ne l'a pas entendu. 4eurs ap logtes , Iom de le dif–
culper , fonr voir alairemel)t que les adverlalres de
Spinofo
l'ont rellement conf,m tlu
&
abyfmé, qu'il ne
leur refle d'autre muyen de leur répl iquer que cel ut
done les Janfénifles fe font fervis conrre les
Jéfui~es,
qui <tll de dire que fo n lentiment n'efl p1s te! qu'oiJ
le fuppofe:
voW\
a
quoi fe réduifent fes apologilles .
J\fin done qu'on voie que perlonne ne fau roit difpu–
ter
a
fes adverfaires l'honneur du triomphe' il fuffie
de confidérer qu'il a enfeigné cff eélivement ce qu'o11
lui impute,
&
qu'il s'ell: concrec.lit grollieremenc
&
n'a
fu ce qu'il vnuloi t. On luí faic un arime d'avoir dit
que caus les erres parciculiers foot des modilicarions
de D!eu . ll efl manifefle qt]e c'ofl fa doélrine, puit:..
que_fa propofition
I-+<
efl cclle-ci,
pr<Cter D•tmJ nrel/a
rfa,-,
neqlf~
concipi pote(l Ji•bflautin,
&
qu 'il afsílre
daos la
1
se,
quidq11id efl, in Deo e(l,
&
nihil fine De(}
t¡equ~ ~/fe
tJeque co1rcipi potejf.
Ce qu'il prouve par'
la radon que tour efl mode o u fubflance,
&
que les:
modes ne peuvem exifler ni
~tre
con<3us fans la fub–
flance. Quand done un apologifle de
Spinofa
parle
de cecee maniere ,
s'il
étoit vrai que
Spinifrt
eOt en–
feigné que rous les
~tres
particuliers lont des modes
de la fubflance di
vine,
la viéloire de fes adverfaires
feroit aomplette,
&
je ne voudrois pas la leur con–
tefler, jé ne leur contell:<! que le fait, je ne erais pas
q_ue la doélrine qu'ils onr réfutée foit daus fon livrc .
t.¿~and ,
dis-je, un apologiQe parle efe la !orce, que
lú1 mdnque-t-il ? qu'un aveu forme! de la défaice de
fou héros; car cvidemrnent le dogme en queflion efl:
daos la morale de
Spinofo .
11
ne faur pas oublier que cer impie n'a point mé–
c~nnu
.les dépendances inévirables de ron fyfleme,
ca~
11 s_'ell moqué de l'apparition des elprirs,
&
il
n'y a
powc de philofophie qui air moins droit de la nier:–
il
doit reconnoitre que rout penfe dans la narure,
&:
9ue l'homme n'efl poinc la plus éclairée
&
la plus
)Jltelligenre modificacion de l'univers: il doic done ad–
mecrre des démons. Qudnd on fuppofc qu'un efprit
fouverainement
parf~i t
a tiré les créacures du fein d11
nédnt, fans y
~tre
déterminé par
¡;,
n~ture,
mais pac
un
~hoix
libre de ron bon plailir, on peut nier qu'il
Y aJt des anges.. Si vous demandez pourquoi un tel
créateur. n'a poiuc produit d'autres efprits que !'ame
de l'homme, on vous répoudra, tel a été ton bon plai–
lir,Jfat pra rntione 'fiolrmtas :
vous ne pourrez oppo–
fer rien de rdifounablc
a
cette réponfc, ñ-moins qua
vous ne _prouviez I<J fa ir,
c'efl.~-dire
qu'il y a des an–
ges. _Mats quand on fupp.ofe 'lue le Créateur n'a poinc
ag1 llbrement,
&
qu'il a épuifé fans choix ni regle
route l'étendue de fa pui!fa 0 ce,
&
que d'ailleurs la
penfée efll'un de fes attributs, on efl ridicule li l'o11
loutienr qu'il n'y a pas des démons . On doit croire
que la penfée du Créateur s'efl modifiée non-feulemenc
daos le corps des hommes , mais aulli par tour l'uni–
vers,
&
qu'outre les
~nimaux
que nons connoiflons, if
y en a une infinité que nous ne connoi flons pas,
&
qui
nous furpaflent en lumieres
&
en matice, aucanc que
nous fur_paílons,
a
cec égard, les chiens & les bceufs.
Car ce feroit la chofe du monde la moins raifonnable
que d'aller s'imaginer que l'efpri t de l'homme efl la
modificarían la plus parfaite qu'un Erre infini, agi!fanc
feion cauto l'étendue de fes forces, a pu produire. Nous
ne concevons nulle liaifon naturelle emre l'emende–
ment
&
le cerveau' c'efl pourquoi nous devom croire
qu'une créarure fans cerveau efl aulli capable de pen–
fer, qu'une créature organifée comme nous le fommes.
Q u'ell-ce done qui a pu porrer
Spinofo
a
nier ce que
l'on dit des efpritst Pourquoi a-t-il cru qu'il n'y a rtcn
daos le monde qui foit capable d'excicer dans nocre ma–
chine la vue d'un fpeélre, de faire du bruit
dan~
une
chambre,
&
de caufer rous les phénomenes magtques
done !es liyres foot mencion ? Efl-ce qu'il a cru que.•
Ddd
~
l'0\!4'
















