
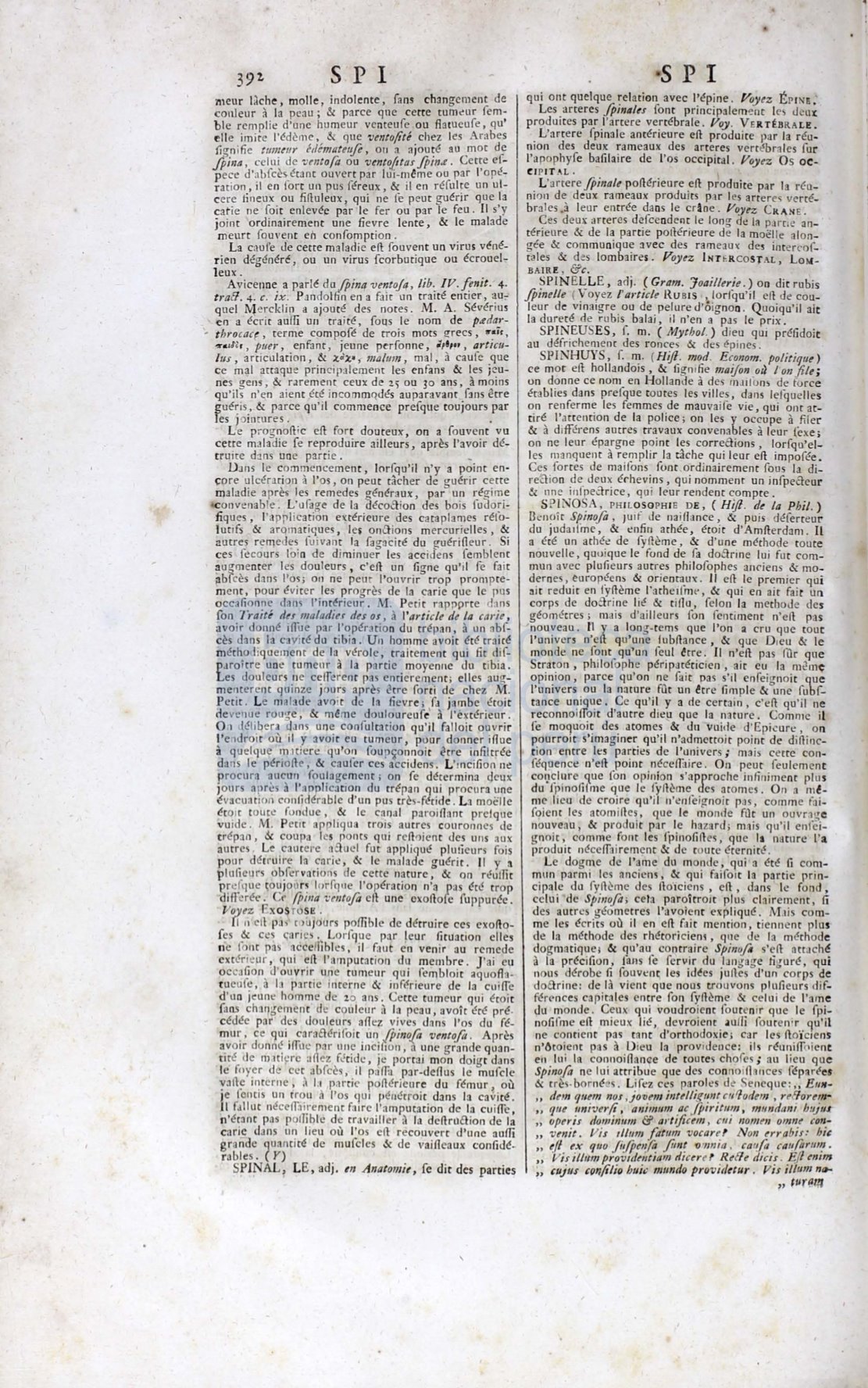
S PI
¡neur lache, molle, indol.ente, faf!s
changement de
conleur
a
la peau;
&
paree qne cerre cumcur fem–
ble remplit! d'une humeur venteufe o u fl atoeufe, qu'
elle imite l'édeme,
que
ventofit¿
chez les Arabes
fio-nifie
tiiiiWJr MhtJutet!fe,
011
a
ajouté
a
u mot de
.[pina ,
celui de
vento
(a
o u
ventojttas JPitu.
Cette ef–
pece d'abfchétanc ouvert par lui-meme o u par l'opé–
r acion, il en fort un pus féreux,
&
il en ré(ulte un ul–
cere lineux o u fiflu leux , qui ne te peut guérir que la
catie ne foi t en
levé~
par le fer ou par 1e feo .
11
s'y
joint ordinairement une fievrc
lente,
&
le malade
meurt fouvent en confornption .
.
La cau f'e Je cette maladie efl fouvent un
v~rus
véné–
rien dégánéré, ou un virus fcorbutique ou écrouel–
leux.
A vicenoe. a parlé
dufPim¡ ventofq, liú: I V.ftnit.
4·
trafl.
4·
c. tx.
P andolríri en a fait un tralté ent1er, au,
quel 1\llercklin
a
ajoo té des notes.
M. A.
Sévérius
en a écrit auffi uu craité, foqs le nom de
ptedar-
•
throcaq,
cerme compofé de ttois mots grecs, ...
¡, ,
.,....,1,,,
puer,
epfanr, jeune perfonne,
;,e,.,,
artictJ–
Ius,
articulation,
&
;t.l;to,
malmn,
mal,
a
ca
u
fe que
ce mal attaque
princip:~lement
les enfans
&
les jeu–
nes gens,
&
rarement ceux de
2)
ou
30
ans,
3.
moins
qu'ils n'en aient écé incommr¡dés auparavant f:ws erre
gué~is_,
&
paree qu'il commence prefque wujours par
les ¡omtures.
.
L e prognoflic ell: for t douteux, on a fo uvent vu
cette maladie fe reproduire ail leurs, aprés l'avoir dé-
t raite dans une parti
e .
_
DJns le commencement, lorfqu'il n'y a point en–
<:ore ulcérarion
a
l'os' on peut tiicher de guérir cette
maladie apre$ les remedes
g~n~raux,
par un régime
•c onvenable. L'ufage de la Mcotlion des bois fuilori–
fiqu es ,
l'application exrérieure des cataplames réi'o–
lutlfs & arqmatiques, les oni.lions mercurielles, &
aurres rell)edes fu 1vJnt la fagacité du guériOeur . Si
ces fecours loin de diminuer les accidens femblent
au o-menter les douleurs, c'ell: un
fiane qu'il fe fait
~bfces
dans l'os; on ne peu
l'ouvrir
0
trop prompte–
ment, pour éviter les progres de la carie que le pus
occofionne dam l'intérienr.
M.
P eti t rappprte d:tns
fon
7i·ait¿ des maladiu des os'
a
l'article de la carie'
avoir donné iílue por l'opération du trépan'
a
un abf–
ces dans la cayjcé du tibia
.r
Un homme avoit été traicé
ínéthodiquement de lo vérole, traitement qui lit dif–
paroitre une tumenr
a
la partie moyenne du tibia.
Les Jouleurs ne ccfrerent pas enrierement; elles aug–
mencerenc quinze jours apres erre forti de chez M .
Petit . Le malade avoit de lo iievre; fa jambe étoit
<levenu
e
rouge'
&
méme douloureufe'
a
l'é~térieur .
O
délibera CIJns une confultacion qu'il falloic ouvrir
l'e droit ou il y avoit eu tumeur, pour donner illue
a
quelque m ltÍere
qu'o~
fouplonnoi t erre infiltrée
dans le périoll:e,
&
caufer ces accidens. L'111cition ne
procura aucun foulagement; on fe détermina cjet¡x
jours apres
a
l'.applicarion du trépan qui procura une
évacuation conhdérable d'un pus tres-fétide . Ll moelle
étOit toure fondue,
&
le cal)al paroiílant prelque
vuide . M. P em ap li9ua trois autres couronnes de
trépan,
&
coupa les pones qui refloient des uns aux
autres . Le cautere ai.luel fur appliqué plu!ieurs fois
pour détruire la carie ,
&
le malade guérit.
JI
y a
}Jiufieurs obfervatiolls de cette nature,
&
on réullit
p~e!que \Oujour~
lorfque l'opératiol) n'a pas été crop
·d,fkrée.
Ce {pma
vmtifa
eft une exoll:ofe l'uppurée.
Voyez
Exos rose .
Il n el1 pa'
e
>u¡ours poffible de détruire ces exoflo–
fes
&
ces <;anes .
Lorfq~e
par ¡eur
tituation elles
oe
fi
nt pas accelllbles, 11
faut en venir au remede
exténeur, qui efl l'ampuration du membre. j'ai eu
occaºon, d'ouyrir.
u~e
rumeur _qui fell)bloit aquofla–
t ueole, a la parne mterne
&
mféneure de la cu ifre
d'uo joune humme de
20
ans. Cetre tomeur qui
~toit
[allS
changement de couleur
a
la peau' avoit été pré.
-
cédée par des Jouleurs aílez
vives
daos l'os du fé–
mur , ce 9ui carai.lérifoi t ún
fPino.[a ventifrt.
A 1m!s
a_voir
dunn~
ifrue par
un~
incilion, a
~1ne
g rande quan–
m é de
mat1~1·e
allez f¿t,dc, ¡e portal mon doigr dans
le foyer de cer abfces, il parra par-deílus le mufcle
vafle interne,
il
1:!
,parrie poflérieure du
f~mur
oii
je fentis un irou
a
l'os qui pénérroit daos la
ca~ité.
11 fallut nécefrairement faire l'amputarion de la cuifre,
n'érant pas poffib le de rravailler
a
la deflrui.lion de la
carie dan$ un lieu ou l'os ell: recouvert d'une auffi
grañile qoancité de mufcles
&
de vaiíleaux contidé–
rables.
(Y)
SP1NAL 1 L E, adj.
m Anatomie, [e
die des parties
S PI
qui ont quelque
~elatien
avec l'épine .
Voytz
ÉPINE.'
Les arteres
fpmalu
fon t
principalem~nt
les deox:
produites par l'artere vertébrale.
Voy.
V
u
TÉBRALE _
L'artere fpinale antérieure efl produite par la réu–
nion des deux rameaux des arteres vertébrales fur
l'apophy(e
b~tilaire
de !'os occipital .
f/oyez
Os oc-
CI PITAL .
1
. L'artere
fiinalt
poflérieure _efl produite par la
réu–
mon de deux rameaux produrts par les arrere< verré–
brales
.3
leur entrée daos le
cr~nc . f/~yez
Ck-\NE.
Ces deux arteros dcfceodenr le Ion" de la pJl'tJe an–
térieure
&
de la partie potlérieure de la moelle alon–
gée
&
communique avec des rameau< des intercn(–
cales
&
des lombaire5.
Voyez
INT>.RCOSTAL,
Lot.~BAIR!,
&c.
SPLN EL LE, adj.
(Gram. ]oaillerie.)
on ditrubis
JPinelle
(
\ioyez
farticle
Ru srs , lorlqu'il efl de coo–
leu r de vinaigre o u de pelure d'oignoo . Quoiqo'il ale
la dureté de robis balaí, il n'en
a
pas le prix.
SPINEU ES, f. m. (
Mythol. )
dieo qui prétidoit
au défrichement des ronces
&
des <'pines .
SPir HUYS,
f.
m.
(Hijl .
mod. Econom. politiqrtd
ce mo t ell: hollandois,
&
fign•fie
maijon or'J ton lile ;
on donne ce nom en Hollande
a
des m.ulon; de torce
érablies dans prefque toures les villes , dans lelquelles
on renferme les femmes de mauvaifc vie, qui onr ae–
tiré l'olttelltion de la police; on les y occupe
a
filer
&
il
différens
a
utres travaux convenables
a
leur (exe;
on ne leur épargne point les correi.lions,
lorfqu'el–
les manquent a remplir la
t~che
qui leur ell
impof~e.
Ces (orces de maifons font ordinairement fous la di–
rec ion de deux érhevins , qui nomment un infpeéleur
&
nne infpeélrice, qui leur rendent compte.
S
!t
o~
'
PHilO_SOPHI E.
DE' (
Hijl .
de la P!Jil. )
n~nOJt
Sptnofo'
JUif
Je na •ílance'
&
puis déferteut'
du judadine,
&
~nfin
arhée, étoit d'Amll:erdam.
11
a été un athée de
(y
fleme,
&
d'une
m~thode
toute
nouvelle, quuique le fond de fa doélnne luí fue com–
mun avec plutieurs autres philofophes anciens
&
mo–
deroes,
europ~en>
&
orieoca.ux.
JI
ell: le premier qui
oit reduit en !yfleme
l'athe1!m~,
&
qui en ait fa ir un
corps de doi.lrine lié
&
tiOu, lelo
u
la methode
des
géométres; mais d'ailleurs fon fcncimenr n'efl
pas
' nouveau. tl y a long-tems que l'on a cru que touc
l'univers n'ell: qu'une lubilance,
&
que D 1eu
&
le
monde ne font qu'un feul
~tre .
11 n'ell: pas f'Or que
Straton , philofophe péripacéticien , ait eu
la meme
opinion, paree qu'on ne fait pas s'1l enfeianoir que
l'univers o u la nacure fUt un
~ere
fimple
&
bune fubf–
tance unique. Ce qu'il y a rle cercain, c'efl qu'il ne
reconnoiO:oit d'aotre
die~
que la na
tu
re. Comme il
(e
moquo•r des atomes
&
Ju vuide d' Epicure , o n
pourroit s'imaginer qu'il n'admettoit point de diflinc–
tion entre les
parti~s
de l'univers ; mais cette con–
féqoence o'ell: point nécefraire . On peut feulemen t
conclure que fon opinion s'approche infiniment plus
du ·
fpinotitme é¡ue le fyfleme des atomes. O n a ml–
me
li.eude croire qu'il
n'~nfeignoit
pas, comme fai–
foi
ent les atomifles, que le monde fílt un ouvrage
nouveau
~
&
prodoit par le hazard; mais qu'il en(ei–
gnolt, comme font les f'pinoíifles, que la nature
\'a
produir
nécefrairem~nc
&
de
tu
ute éternité.
Le dogme de l'ame du monde, qui a été íi com–
mun parmi les anciens,
&
qui faifo1t la partie prin–
cipale du fyfleme des flo'tciens , ell: , dans le fond,
celui de
Spi11ofo;
cela paroirro1t plus clairement,
íi
des aurres géomerres l'avolent expliqué . M.1is com–
me
les
écrits oil il en ell: fait mention, riennent plus
de la méthode des rhétoriciens , que de la mérhode
dogmatique¡
&
qu'au contraire
Spin¡ifil
s'efl attaché
a
la précition' fil>JS
[e
fervir du
lan~age
fig uré' qoi
nous dérobe fi
fouven~
les
id~es
jufles d'un corps de
do rine: de la viene que noos trouvons plulleurs dif–
~rences
capitales entre ron fyfleme
&
celui de \'ame
du monde . Ceux qui voudroieot fou te01r que le (pi–
nolifme eft mieux lié, devroient auili fourenir qu'il
ne contiene pas
tant d'orthodoxie; car les fto'iciens
n'6toienc pas
a
Dieu la prov•Jeuce: ils réunifroient
en luí la connoiílanee de toutes chofes ; au lieu que
Spinofo
ne lui attribu'e que des connoiílances féparées
&
ere -borné
S.
Lifez ces pa roles de Seneque: ..
Etlll•
dem quem nos ,jovem inulligmlf mf/odem
,
rd lorem·
que nniver(i, aiJimum
llC
fPiritum, tn/l.fJdmti
buju~
uperii
dominum
&
artifictm , cuí nomen omne con–
vmit. Vis tllflm fatflm vocare! N o11 errabis: hit
ejl
ex
quo jiifPcnfiz jimt
omnia, carifa caq(arw'!–
Vis i/lr1m prowdentiam diure! Refle dicis .
F,(l
emm
cujus co11/ilio bui,; mllndo pro1litletur . Pis i/ltrm not-
1,
fiii'(ITfl
















