
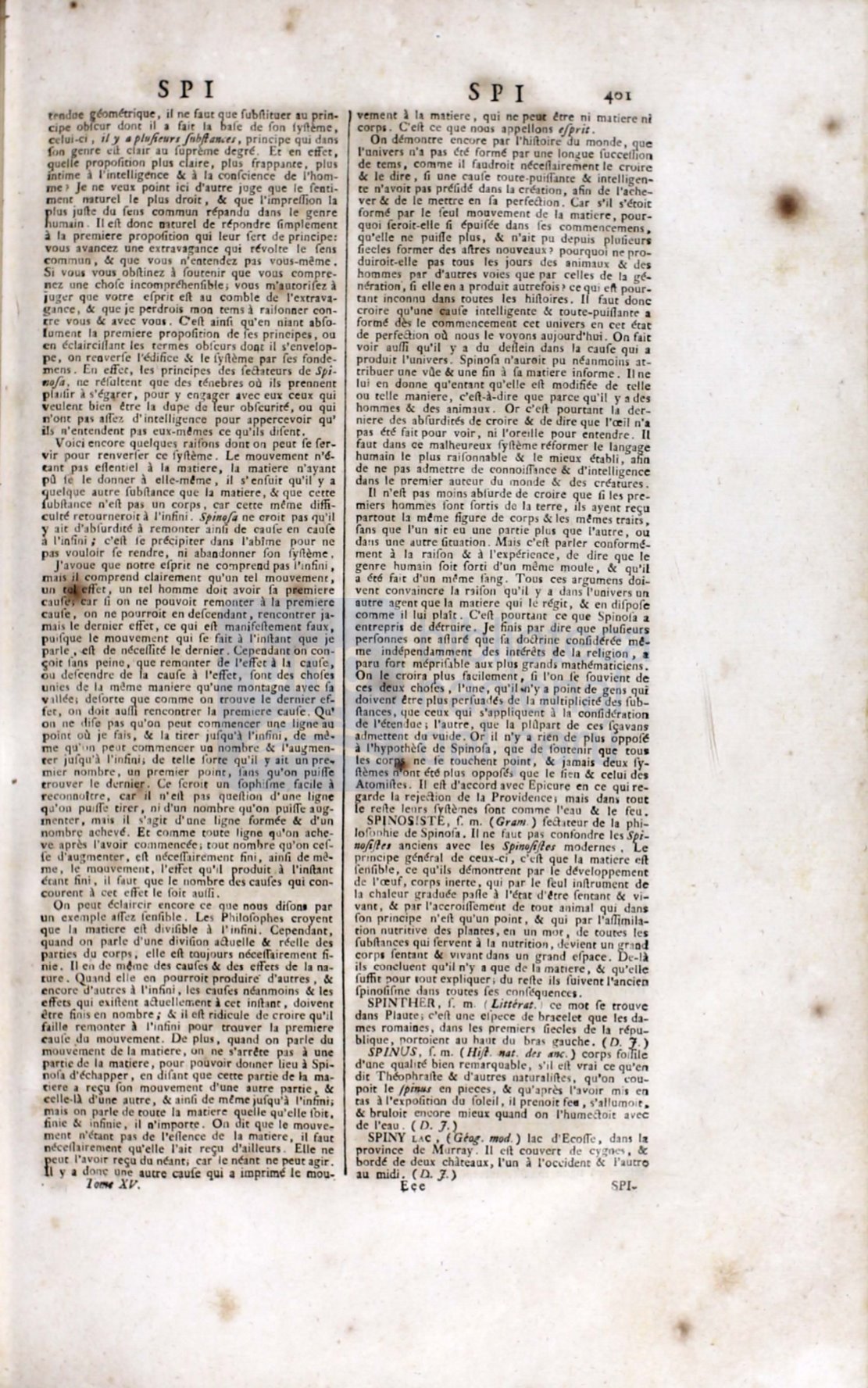
S PI
t
ndue
e~mt!triqoe'
il
nc
r~ot
que fubfiiroet
au
prin–
crp.e obfcur done il
a
faic
1
In
fe
de ron ly
~e '
cdur.cr,
ti y
• r.lvfi~urr
fob/1rtlf•U
,.
prinC'ipc qui dan
fon genre
cll
e
atr
ao
fupr~me
dcgré.
· t en eifec ,
9uelfc propofitron plus clatre, plus
fr3ppJnte, plus
mtime
l'intelligenc:e
&
a
la confcience de l'hom–
me
1
Je
nc veu1 point ici d'aurrc joge 9ue le feoti–
mcnr mrurel le plus droic,
&
que l'rmpreffion la
p lu, june do
r~
..,
c:ommun rq,ando dans le gcnre
hu
on
11
en done D1tUrcl de r!p ndre fimplcment
a
1~
premiere propoficion qui ltur
fert
de prtncipe:
vous vanea une exrrava¡;:_ncc qui révolre le feos
commun ,
&
que vous
n
cncenda p3s vouo-meme .
r
vouJ
vous obllíncz
!
foucenir que
vous
compre–
na
une chofe inc:ompri!henfible ; vous
m'1ocorife~
a
j ugcr que vorre cfpric en au comble de l'cxtr1va–
~pnce
1
&
que
jc
p.erdroir mon cems
:1
railonner con–
ere vous
&
avec VOUI .
Cen
ainli qu'en niant abfo.
l umenc lu premien: propolicion de res prinoipes. ou
en
~ctaircii!Jnt
les rc:rmes obrcurs doqc il s 1envelop–
pe, on rr overfe l'édilicc
&
le
f>·n~mc
par fes fonde–
m
no .
· u elfcc, l.,s príncipes
des
ftélateurs de
Spi–
mfo ,
ne n!fulccnc que deJ rénebres oll ils prtnnent
pl~•fir
'é •arcr, pour y
c:n~>agcr
avec:
eu~
ceux qui
\leulenc bien tere
1
.Jupc
Jo
leur obfcurit!, ou qui
11
1
011[
p '
arr,oz. d' incelligcnce pour 3flpcrcevoir qu'
ib
A'enrcndenr
pus
cu•-m~mes
ce qu'lls <hícnr.
Voici encare quclquc
rJilons donr on pcoc íe fer–
" ir pour renveríer ce
fyn~me.
Le mouvemenr
n'6-
vnt p> erlenuel
a
la maricre,
Id
maticre n'ayant
pO
f
le donner
a
cllc-mtme, il s' enfuir qu'il
y
a
q ul•lq\)c aurre fubnance que
1~
mariere ,
&
que ceICe
{ublbncc n'erl
pas
un corp , eur cecee mtme diffi–
culr~
rerourneroir
~
l'inñni .
Spinq[t,
nc aro1e pas qu'il
y
31t d'Jbl'urrl•cd :\ remonrer
amti
de oauí" en cauCe
a
l'rnlini ; c'e!l le pr!cipicer dans l'ablme pou r
nc
pus vnulolr fe rcndre. ni abaodonncr
(on
(1
neme '
j'nvoue que oorrc efpric ne compreod pas l'mrini,
mall
íl comprcnd clairemenc qu'un cel mouvemcnr,
un
tf'tc,
un rel homme doic avoir fa
p~~emiere
cau
ar li on ne pouvoic remoncer :\ la premiere
cau!'e, on no pourroir en defaendanr, renconrrcr ja–
ma•
le dcrni<:r crfce, ce qui efl manifcnemenc faux,
pu1fque le mouvemene qui fe faie
~
l'inlhne que je
parle , .en rle néceffieé le dernier , Cependanc on con–
c_;nir fans peino, que remonrer
é).,
l'erfee
~
l! caufe,
ou
deícendr~
de
la
caufe
~
l'crfct, fonc des chofes
uníc5
d~
IJ
m~me
maniere qu'une monrugne avec fa
v
¡llée; deforce guc commc on croove le dernier
ef–
f~r
1 011 ll ir aum rcnconcrer
la
prcm•ere caufe ' Qu•
on nc
dif~
pas. qu'on
pc~c
C? mmence: un.e ligue au
point o\1
JC
ra1s ,
&
la orer ¡ufqu'!\ l'mlinr, de
m~me qu'•trl peur
e
rnmcnc~r
uo nombre
&
l'augmen–
rer jufqu'!\ l' mfini ¡ de telle lime qu'il
y
ait un pre.
mu:r
nombre, un prcmier poinc, li111s gu'on puirfe
rrouver le
d~rnier .
Cf.'
fcro•t un fophifme
facile
a
r econnolcre, car il n' etl pa
quenion d' une ligne
q u'on pu1rfc rircr, ni d'un nomhrc t¡u'on puirfe oug–
rnenecr,
m~ is
íl
<'agie d' one ligne
form~e
&
d'un
nombre aClhevé. Er enmme rouce ligne qú'on ache–
ve npr
l'avoir commencéc; eour nomi>re qu'on ccf–
fc
d'au menrer, en
nt!cerfaircm~ne
ñni, ainfi de
m~·
me,
k
mouvemenr, l'erfee qu'1l produir
il
l'inlbnc
cune
ñni, il
f~ur
que le nombre des caufcs qoi con–
c:ourcne
a
ec
crfer le foie aufli'
O n
pouc
éclaircir encore ce que nous difooa par
un
e
emplc arfcn fcnlihle. Les Philofophes croyent
q oe 1
tnJCÍerc c!l dn•i!ible
a
1' infini. Cependanr,
qu nd on parle d' une divifion
a
uclle
&
réelle des
parrie du corps, elle el\ coujouu néc:erfaircmcne fi–
nie.
11
en
d~
m6me
des ca
ufes
&
des erfers de la n3-
rure.
Qu~nd
elle! en pourroit produire· d'aurres ,
&
encore
il'
Jnere
l
l'infini , les
ca
ufes nt!anmoins
&
les
erfctl qui
e~ificnc
a
uell~ment
i
cct inflaoc, doivenc
.!ere
6n.s
en nombre;
&:
il ofl ridicule
de
crorrc qu'tl
ÑHI
remonter
l
l'•nfini pour rrouver la prem1ere
nule du mouvemenr.
De
plo , qumnd on parle du
m
uvémenc de la
marier~ ,
on ne
s'arr~ee
pgs
~
une
p rtie
dé 1
matiere, pour pouvoir llonner líeu
1
pi–
n fia
d'échapper, en difanc que
cerce
partie de la mm–
riere •
rcc_¡u fon mouvemenr d'uoe aurre partie,
&
celle·ll d'une 111tre,
&
ainfi de
m~me jufqu·~
l'infini;
mmis on parle ele rouee la matierc quelle qo'cllc lbit,
finíe
&
•nfinic, il n'imporre . O n dir que le
mouve~
mene n'<'rant pas de l'erlence de
lm matiere ,
il
faur
nécei!J~temem
qu'elle l'aic rec_¡o d'ailleurs . Elle ne
peuc l'B\fOir rec_¡u do n6ne; cu le n6nt ne peue agir .
11
,
a 1 nc une autte au(e
qui
a imprimé le mou-.
•
1orM XP.
S P I
~01
nment l 1
m
'ere, qui ne peiK
~rre
ni mHiere ni
corps . Cefl ce que noo
ppellons
'fprir.
On Mmornre encore plr l'hinoire ilu monde, gue
l'onivers
o'1
pas écé form! pu une lon,¿oe fuc."cell1o
de tems, comrne il faudroic n4!ce11Jiremenc le crutre
&
le dire,
!i
une C3o(e couee.put!l':anre
&
ineelligen·
re n'avoir pu
prefid~
daos la crl!atron , afin de l'ache–
ver
&
de le merrre en
f:
perfeelion . Car s'rl s'étoit
form~
par le íeul mouvcmenc de la muiere, pour–
quoi feroit-elle
li
!puifée daos fes commencemens .
qu'elle ne puillc plus,
&
n'ait pu dcpuis phuieurc
!ice!es former des ar\rcs nouvcaur
1
pourquor ne pro–
duiroic-elle pas rous
le
jours des animaux
dC!'s
hommes par d'aurres voic.s que par celles de
13
gt'–
n~rarion',
fi elle en
a
produic aurrcfois
l <:c
qut eft pour–
t:lnr rnconnu dans rout., les hifioires.
11
f1ur done
croire qu•une caufe incelhgenre
&
eoure-puilllnce a
form~ ~
le commcncemene cce univers en <:ce
~mt
de perfe
on oa nous le
voyons
aujourd'hui . On fait
VOir auffi qu'il )' a du defie10 dan>
la C3Ufe qui
a
produtt l'univers .
pinof.1 n'auroir pu néanmoin
ae–
rribuer une vQe
&
une 6n
a
fa maciere informe.
11
ne
luí
en
donne qu'cnranr qu'elle en
modiñ~e
de eelle
ou rcllc maniere, c'efl-a-dire que paree qu'il )' a des
homme•
&
dC's animaux, O r e'en pourranr
1~
der–
nierc
des
nbfurdirés de croire
&
de Jire que l'a:il n'a
pas !cé fa ir pour voir, ni l'ore•lle pour encendre .
11
faur dans ce malheureu.:r fyneme rc!formcr le langage
humain le plus ra ifonnable
&
le mieux érubli ,
a
fin
de ne pas a.Jmeme de t'Onnolrfancc
&
d'inrelligence
daos le premier aueeur du monde
&
des créarures.
ll
n•en pas moios ahfurde de croire 9ue
(i
le~
pre–
miers hommcs lene fortÍS do la
terre, lis
3)•ent re!jU
parrout la m!me figure de corp
&
les
m~mes
crairs ,
fans que !'un
a
ir eu une partíe pluc que l'aorre, ou
dans une aurre Gcuarion . Mais
e'
el\ parler conformé–
mene
2
la rn ifon
&
~
l'expérience, de dlre que le
genre humain fo it forci d'on
m~
me moulc,
&
qu'il
a
éc6 fa•e d'un
m~me
1ang . Tous ces argumcns doi–
vcne convaincre la r1iíon qu'il y a .Jans l'uoivers
un
aurre agenr que la maciere qui le régie ,
&
en rlifpofe
oomme il lui pllie . C'el\ pourunr ce que
' pinofa
a
enrrcpris de dérruire.
Je
finis par dire que
plufi~urs
perfonnes ont arluré que fa doélrine confiMréc
m~me
indépendamment des
imér~rs
de
la religion,
a
paru
fon
méprifJble aux plus
gr:~nds
marhémariciens.
On le croira plus fauilomen r,
li
l'on re fouvicnr de
ces deuJI chafes , l'une, qu'il -o'y a poinr de gens qui
doivenr
t erc
plus pcrluaMs de
13
muleiplicír~
dc!S
fub–
flances, lJUe ceux qui s'appliquenc
a
la oon!ldération
de l'éccnJoe; l'aucre, qul: 13 piOparr de ces fc_¡avans
admcrrenc du vulde. Or
il
n'y
a
ríen de plus
oppof~
a
l'hypothCfc
de
pinofa, que de foutemr que tOUI
les oor
ne 1e couchenr poine,
&
jamais deull
f'y–
nemes n
nr éré
plus oppoíll; que le lien
&
celui des
Atornille . ll efl d'accord avoc Epicure en ce qui re–
garrle la rejeflion de la Providence
¡
mais dan. rout
le relle lenr
fynernes fonr comrnc l'cau
&
te fe u.
SP!NOS f TE , í. m.
(Gr11m. )
fetbrcur de la phi–
lofrwhie de Spinafa. ll ne fauc pas c:onfondrc les
Spi–
nof'.ftn
anoiens
avec
les
Spinojijlu
moderne
. Le
pn ncipe général de ceux-ci,
c·~n
que la maricre
P.!l
ren!ible, ce qu'ils démonrrenc par le déveiQppement
de l'a:uf, corps inerte, qui par 1<' tl!ul innrument de
la chaleur
¡;!radu~e
parle
a
l'éror d'lere fenranc
&
vi–
van!,
&
p r l'accroirfemem de tour animal qui d1ns
fon príncipe n'ell qu'un poinr ,
&
qui
P"
l'allirnila–
rion nueritivcl des pl3ores, en un mor, de cour<'S les
fubflance~
qui fervenr
a
la nurririon, .Jevienr un O'raod
corp1 fen12uc
&
vrvanr dans un grand efpace .
De-l~
ils concluenr qu'il n'y
a
que rlt> la mar.ere,
&
qu'elle
íuffie :>our mur expliquer ; du re!le
Hs
fuivenr l'ancieo
fpino!if10e dans rouees fes cnnft'quences.
Pf THER , C
m.
(
Litth•t.
1
ce
mor fe rrouve
daos Ptauee; c-•en une et'pece de br:1eelet que les da–
mes romaiocs, dans les premicr
tiecles de la répu–
blique, orroienc
a
u haur du
bra~
g"1uche. (
D.
J .)
SP.!NUS ,
f. m.
(
flijl..
tfllt.
du
11ñc. )
corps foililc
d'une quahc:é bien rcmarquablc, >'•1 cll vrai ce qu'en
die Théophntlle
&
d'aurres narurahfle , qu'on cou–
poit le
¡pituu
en jlleces,
&
qu'a rl!t ['3 v01r mis en
ras
~
l'expofinon du foleil , il prenoic fee, s'allumo•r.
&
bruloir encare mieux quand on l'humetloir
avec
de
l'~u .
(D.
] .
)
SPI:i'l
u e ,
(l]r~.
mod. )
lac d' Ecorrc , dans la
province de Murrny . 11 en couverc de
cy~n<
,
&:
bord~
de deux chheaw:, l'un
a
l'ocddent
&
1' uc:ro
1U
midi . (
D.
J.)
~~e
P~
















