
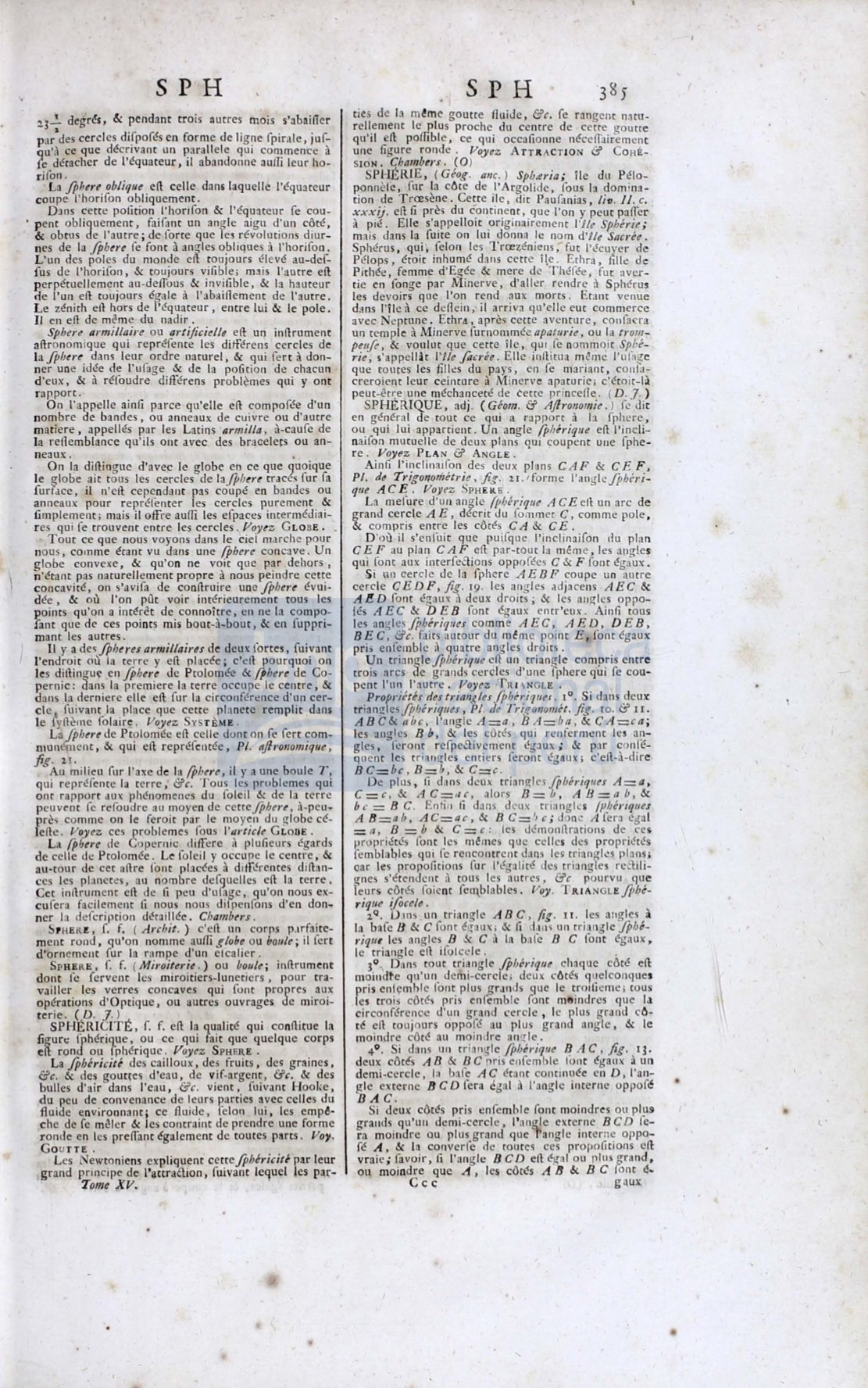
S
P H
~
3
~
degrés,
&
pendant trois nutres mois s'nbailler
p ar des cercl es diípoíés en forme de ligne rpirale , jur–
qu':\ ce que décrivant un parallele qui commente a
re décacher de l'équaceur' il abandonne aum leur ho–
riron .
La
JPhtre oblir¡ue
en celle dans laquelle l'équsceur
coupe l'horiron obliquemem .
D ans cen e poficion l'honron
&
l'équaceur fe cou-
• p ene obliquemem , fa iíant un ang le aign d'un cllcé ,
&
obcus de l'aucre ; de fo rce que les révolucions diur–
nes de la
JPhtrt
re fonc a
an~les
obliques
i\
l'horiíoo.
L'un des pote du monde elt coujours élevá au-def–
fus de l'horiíon ,
&
coujours vifible;
m~is
l'aucre en
p erpécuellemcnc au-de!lous
&
invifible,
&
b
ha meur
o
e l'un en coujours éga le
¡\
l'abaiflemcnt de l'aucre .
Le zénich en hors de f>équaceur , entre tui
&
le pote.
JI
en efl de mi'me du nadir .
Spbeu ttrmillaire
ou
artijicidle
en
Ul)
innrument
af!ronomique qui repréíence les dilférens cercles de
la
JPbn·e
daos leur ordre nacurel,
&
qui íerc
i\
don–
ner une illée ele l' ufag e
&
de la pofi cion de ohacun
d'eux,
&
i\
ré(oudre dille rens
probl~mes
qui y onc
r apporc.
On l'appelle ainfi paree qu'elle en compoíée d'un
nombre de bancles, ou anneaux de cuivre ou d'aucre
matiere, appellés par les Lacios
armilla,
a-cauíe de
la reflemblance qu'ils om avec des braaelers ou an-
neaux .
.
On la dining ue d'avec le globe en ce que quoique
le globe air cous les cercles de
lafPbere
cracés íur fa
furface , il n'ell cepeodanr pas coupé en bandes ou
anneaux pour reprélenter les cercles p urement
&
fimplemem ; mais
il
olfre aum les eípaces incermédiai–
r es qui fe crouvenc encre les eercles ..
f/oyt z
G LOSE .
•
Tour ce que nous voyons dans le ciei marche pour
nous , comme éranc vu dans une
fPI>erc
concave . Un
globe convexe ,
&
qu'on ne voic que par dehors
1
n 'étant pas narurellement pro pre
a
nous peindre cen e
concaviré , on s'aviía de coanruire une
Ji>lure
évui–
dée ,
&
ou
l'on pOr voir inrérieurement cous les
poinrs qu'on a incéret de connoicre, en ne
1:1
compo–
fant que de ces points mis bout-a-bouc
1
&
en [uppri–
mam les aueres .
ll
y a des
JPiures armillairu
de deux forres, [uivant
l'endroit ou la terre y en placée ; c'efl pourquoi on
les diflin "'Uf en
.fphtre
de Pcolomée
&
J;here
de Co–
p ernic : dans la premiere la cerre occupe le centre,
&
dans Ja elerniere elle en Íur la circonférence d'Ufl cer–
cJc
~
ruivam la place que cecee planece remplit dans
le !yfleme Colaire .
Voyez
Sv TEMI! .
L afPbereele
P colomée encelle donr on fe íerc com–
munt~nem,
&
qui en repréíenrée ,
PI.
fljh•onomir¡ue,
fig.
2.1.
Au mi lieu íur l'axe de la
fPhere,
il
y
a une boule
T ,
q ui repréíente la terre ,
&c.
Tous les problemes qui
o nr rapport aux phénomenes du fo leil
&
de la terre
peuveot re reroudre au moyen de
cecreJPbere,
a-peu.
pres comme on le feroic par le moyen du globe cé–
lefle.
Voyez
ces problemes rous
l'article
GLonE .
La
(phere
ele Copernic dilfere
il
plulieurs égards
de celle di! Ptolomée. Le folei l y occu pe le centre ,
&
au-cour de cer aflre fonc placées
a
ditférences dillan–
ces les planetes, au nombre de íquelles en la cerre.
Cee inllrumenc en de fi peu d'uíage , c¡u'on nous ex–
cuíera facilement fi nous nous diípeníons d'en don–
ner la deícripcion démillée .
Cbambers .
SPHERI! ,
[.
f.
(
Arcbit.
)
c'etl un corps p.¡rfaite–
ment rond' qu'on nomme aum
g lobe
ou
baule;
il
[en
d'ornement fur la rampe d'un efcalier .
SPHERE, (
f.
(
M iroiterie . )
ou
bou/e;
inflrument
done le
fervent les miroitiers-luneriers, pour cra–
vailler
les verres concaves qui íom propres aux
opéracions d'Optique , ou aueres ouvrages de miroi–
terie .
(D. ] .
)
SPHERICITÉ , f.
f.
en la qualicé qui connicue la
fig ure fphérique , ou ce qui fait que quelque corps
en rond ou (phérique.
f/oy ez
SPHERE .
La
JPbéricité
des cailloux , des fruics , des graines,
&c.
&
des gouc¡es d'eau, de vif-argem ,
&c.
&
des
bulles d'air daos l'eau,
&c.
viene, íuivanc 1-Iooke,
du peu de convenance de leurs parcies
avec
celles du
fluide
~nviroonanr¡
ce fl uide , felon tui, les emp6-
che de fe
m~ler
&
les ooncraint de prendre une forme
r onde en les preffanc également de couces pares .
Vo'jo.
Gourn:.
Les
ewtoniens expliquenc cecee
JPbéricité
par leur
grand prínci pe de l'accraélion, fuivant
le~uel
les paf–
Tome XV.
----
S
P H
des de In
m~mc
goutce fluide,
&c.
fe rangenc nam–
rellement le plus proche du centre de cecre gou tte
qu'il en pollible , ce qui occafionne nécelfaire ment
une figure ronde .
Voyez
ATTRACTION
&
Co HÉ–
SION.
CIJambers .
(
0 )
PI-IÉRlE ,
(
Géog. anc. ) Spld!ria ;
fle du Pélo–
po nnele, íur la cOce de l'Argolide, fous
b
dom in•–
tion de Trcesene.
Ce~re
ile , cfic Pauranias ,
tio. 11. c.
x xxij.
efl fi
pre~
du concinenc, que l'on y peuc paffer
il
p1t!. Elle s'appelloit originairemenc
l'i/e Sf_bérie;
mais dans la fui te on lui donna le nom
d'tle
'Sncrée.
Sphérus, qui
1
íelon les T rcezéniens; fue l'écuyer de
Pélops, étoit inhumé dans ceere
i[c.
Erhra, ltlle
de
Pithée, femme d'
Eg~e
&
mere
d~
Théíée, fu e avcr–
tie en fongc par M inerve , d'aller rendre
a
Sphérus
les devoifS que l'on rend aux mores . Eranc venuc
dans I'IJe
a
CC
dcfl ein , il arriva qu'clJc CUt commerce
avec Neprune . Echr4 , aprGs cecee aventure , confa ra
u n temple
a
M lnerve íurnommée
npnturie'
ou la
f i'Ol/1-
peuj~ ,
&
vouluc que cecea !le , qu• fe nommoic
Spbí:–
rie,
s'appellic
1'1/e .facrée .
Elle inflitua meme
l'ul~>!c
que ro
u
res les filies du pays ' en re mariant' coni:l–
creroient leur ceincu re
a
J\II inerve apacurie;
c'étoic-l~
peuc-erre une méahanceté
de
t etce pr incelfe.
( D .
.J. )
PHÉRIQUE , adj . (
Géom.
&
Ajlronomic .)
fe die
en généra l de couc ce qui
a
rapporc
:l
la
íphcre ,
ou q ui tui apparcienc. Un angle
(i;Mrir¡ue
efll 'incli–
natfon muruelle de deux plans qui coupenc uue fphe–
re.
VoyBZ
PLAN
&
ANG LE .
Ainfi
l' i~clinali:On .
des deux plans
C A
F
&
e
E F,
PI. de
Tngo>101fletne ,
fi....
l.I. 'form e
l'a nglc.fPhí:ri–
r¡ue
A
e
E .
V~yez SP!iE~ 6.
La meJ'ure d'1111ang le
(fJhérir¡ue A CE
elt un are de
g rand cercle
A E ,
décn r du íommer
C ,
comme pote ,
&
comp ris entre les cllct<s
CA
&
CE .
D'ou
il
s'e nl'ui c que pu (íque f'incl inaiíon du pl:1 n
C E F
au plan
CA F
en par-rouc la mt!me , les a¡wles
qui ronc aux interf'eélions oppof'ée
e
&
F
(out
égt~X .
Si un cercle de la íphcre
.A
E 8 F
coupe u
o
autre
cercle
OE DF, fig.
19. les ang le
adjacens
AEC
&
A
1!.
D
fonc égaux
il
deux droirs;
&
les
au~les
oppo–
lés
A EC
&
"D EB
íont égaux entr'eux. Ai nfi cous
les angles
JPbfrir¡ues
comme
A E C, A E D, D E
B ,
8 E C,
&c.
faics aucour du
m~me
poi
m
E
,lonc égaux
pri
enfemble
a
quaere ang les droics .
Un
crianglefPbérir¡ue
efl un triang le compris entre
trois ares a e g rands cerotes d'une rphore qui re cou–
pent l'nn l'aucre .
Voyrz
.Yn"NGlE .
Propriétés
des
trian¡,/
es
./Phhir¡uCJ.
1°.
Si dans deux:
trianv;lesfi>bérir¡ues ,
PI. de
Trigonomh. fig.
¡o.
&
1
I.
A 8 C&
ab e ,
l'anglc
A
=a ,
B
A = btl ,
&
C
4=cn ;
les anglcs
B b,
&
les cOrés qui renferment les an–
gles ,
le ronr
reípeélivemenr égaux ;
&
par conle–
quem les criangles enciers íeronc égau.x; c'etl-a-dire
B C= bc , B= f,,
&
C= c.
De plus
1
ft
da ns deux
rrian~l es
JP úérir¡rtes A = a ,
C = c,
&
A C = •IC,
alors
B= b ,
AB = nb,&
b e = B
C.
Entin li dans deux
tria nglcs
fpbériques
A
B=nb, A C= ac ,
&
B
C= ''
e ;
done
A
fera
égal
=
n,
B
=
b
&
C
=e :
les démonf!racions de ces
propri¿tés fo nt les ml!mes que celles des propriécés
[emblal¡les qni fe rencontrenc dans les trian{l'l.!s plaos;
oar le
propoft cions íur l'égalité des criang le5 rcéHli–
g nes s'étendenc
ii
rous les aucres ,
&e
pourvn que
teurs cOtés fo ienc íe01,blables.
Voy .
T ntANGlE
JPbé–
rique ifoccle .
2Q.
O ms _un triang le
A8
e ,
fig .
1 1.
les augles
a
la bafe
B
&
e
íonr égaux ;
&
fi ddn ' un criang le
-.JPbé–
riqu'
les angles.
.
B
&.
C
i\
la bafe
8
e
Iom égaux ,
le criang le efl do!ce le .
.
3°.,
Dans tour criang le
./i>bérique
chaque cllté ell:
moiud~e
qu'u n demi-cercle; deux cOtés quelconques
pris enlcmhle lont plus g rands que le crnifieme ; cous
les trois dltés pris enfemble íonr m11indres que la
circonfércnoe d' un grand L"ercle , le plus grand cO–
té efl coujours oppof.! au pl us grand angle ,
&
le
moindre cllcé au moindre anv; Je .
4°.
Si dans un rria ngle
JPbérir¡ue
8 A
C , fig .
13·
deux cllcés
A 8
&
8 C
r>ris eníemble tone éga ux
a
un
demi-cercl e , la ba(e
A
e
étant continuée en
D,
l'an–
g le ex terne
BCD
!'era éga l
a
l'angl ~
interne oppoíé
BAC .
i deux clltés pris enremhle ron e moindres on plug
g rauds qu'uu demi-cercle , l'angle exrerne
B e D
re–
ra moindre
a
u plus g rand que ·r•ang le imer:1e a ppo–
fé
A,
&
la converle ele couces ces propoli cions ell:
vraie; la voir, fi l'ang le
8 CD
en égal ou plus g rand ,
ou moindre q11e
A,
les cllcés
A 'h
&
B C
fonc
é-
C
e e
g ~ux.
.,
















