
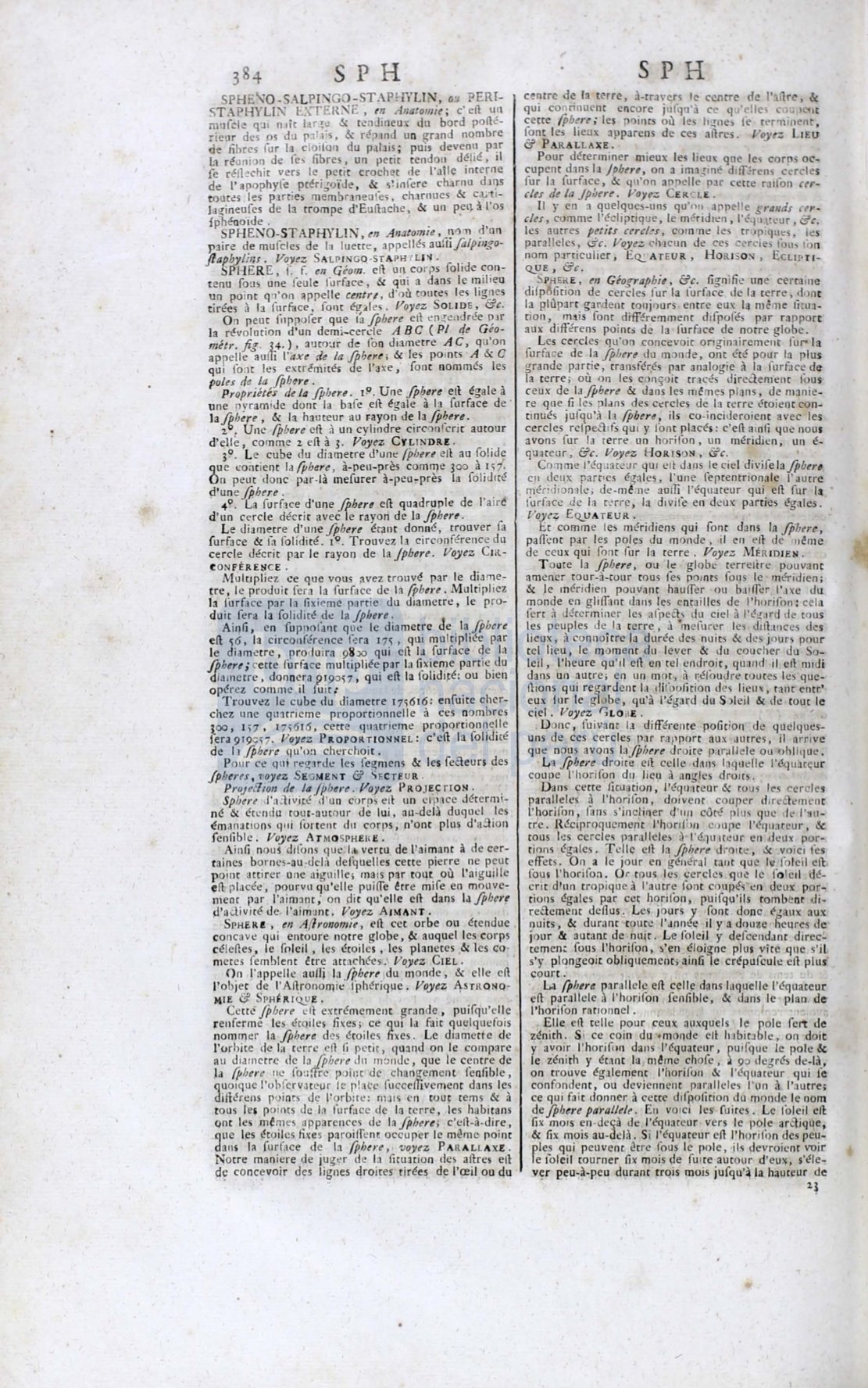
S
P
H
SPH~
'0-SALP[.
G
-
TAP
l'LIN,
o!<
PERf–
STAPHYLI,
1
I:.XTER, E ,
tn
Anatomir;
e'
ell un
mufcle
q~•
n 1it laPa
&
tendineu.· du bord pollé–
rieur des
OS
du p1la's,
&
ré;Hnd
UD
srand nombre
de
libres fu r la cloilon du palais; pUis
deven~ p~r
L1
réunion de fe, libres, un pecit cendou
d~hé,
,¡
fe réfl eehit
vers
le petic
croch~t
de l'alle mcerne
de
1'
apophyte ptéri,¡o'ide,
&
s!infere cbarnu da':'s
wutes
les
parcies mem raneu(e>, charnues
&
c.t. •–
Jagineufes de la trompe d'Eullache,
&
un
pe•~
3
l'os
í pbéao'ide .
PHE1 0-STAPHYLI
,
en A>1atomie ,
~to
t
~'un
J>aire de mu fclcs de la luen e , appellés
aufi¡.fa/pmgo-
jlapbyli>u.
V~JI•Z SA ~P r
GO·STAPH'ILI>I.
.
SPHERE ,
f.
f.
en Géom.
ell
Ull
COI'í)S fohde c<;lll–
t enu fom une fcul e furfaee,
&
qui a daos le
·~rheu
un point q••'on
~ppclle
cmtr1,
d'oi'.t come< le< hgnes
tirées
a
ll furface, font é¡r1le .
f/Qyez
O~I DE,
&c.
On peut fnppufer que
iá
.fplure
et\
~n.¡endr~e ~Jr
la révolution d'un demi-cerde
A 8
e
(PI
4•
Geo–
métr.
fig .
3_4.),
auro"r de fo n diametre
A
e,
qu'on
appelle auffi
l'axe de la
fPh•~•;
&
les po•m
A
&
O
qu i fonr les cxrr.!'miré• de l'axe, fom nommés
les
potes
t/e la JPhert
.
Propriéth
dr la
JPh•~•.
¡!',
Une
,fph_ere
el\ égale a
une pyramiJc dont la bafc ell
(,a
le a la furface de
lafglure,
&
la haureur au r.ayon de
la.fph_rre .
2.
1
Une
fPbere
cll :\ un cylindre circonfcrit autour
d'elle, comme
2
ella
¡.
f/oyez
CYLINDRt: .
¡
0 .
Le cube du diametre
d>un~
(pbere
ell au folide
qu e
~ontie~t
Id
{phere ,
a-peu-pres cOmll)e
JOO
a r ~f.O n peuc done pdr·la mefurer
a-peu~pres
la
folic.lm~p'une
fi¡bere
.
,.~.
La furface d'u ne
.fpher6
ell q uadruple
de
!'aire
d'un cercle décrit avec le rayen de la
JPhere .
Le úiametre d'une
Jkbue
étant donné, trouver fa
fu rface
&
1:1 folidi té .
t
0 .
Trouvez la circonférence du
eercle décrit par le rayon de la
jphere.
f/oyez
Cnt–
CONFÉRE tiCE .
Mulupliez ce que vous
~vez
trouvé par le
di.af!!e–
tre, le proúuit fera la furface de la
{pb6re.
Mult•phcz
la rurface par la fixi eme partie du diamerre' le pro–
duit fera la folidité de la
jphere.
Aio¡li, en fupoo rant
q ~e
le
diamet~e
Je .
la.JPhere
ell
s6,
la circonf.!rence lera
1 7~
,
qut
mult1ph~e
par
le diametre, produ ira
98JO
qui cll la furface <le
la
.fphere ;
cecee furface multipliée.par la
!ixi~me
parue .du
diame¡re, donnera
919017,
qm ellla fohdtté< ou bJeiJ
opérez comme
il
fu it ;
.
Trouvez le cube du úiametre
17~616:
enfutre cher–
chez une qua tricme proporciannelle
a
ces nombres
¡oc,
1
;7 ,
17;616,
cect
quatrieme proponion nelle
(era
919c~7·
Voyez
PlloPOilTIONNEL: c'ell la folídité
pe
lt.fpber~
qu'o:J cherchoi t.
Pour ce qui
•·e~ard"
les fegmens
&
les feéleurs des
jpheres ,
'110)/CZ
EGIIIENT
&
5E~TEU R .
Pro¡e.'lión de La
Jpbere .
Poyez
PROJF;C n oN.
.
Sphere
,!'a.'livicé d' un corps eil un et ace déterml–
ne
&
étendp tou t-aucour de lui' ap-dela duque!
les
émanH•ons q11i íortent du corps, n'onc plus d'a.:lion
fenfible.
f/oyrz
ATMQSPHI!R I!.
Ain!i nous dofuns que!la. ver
tu
de Paimant
a
de cer–
t ai nes bornes-au -delil derquelles cen e pierre ne peut
_ p oint attir
er une uiguille; ma1s par tour
01)
l'aiguille
e
fu
placée ,
pour.vuqu'elle puiífe érre mife en mouve–
meot par l'ainunc; o n di e qu'elle ell dans la
.fpbcrr
J,l'adivité de. l'aimunt.
f/oyez
AJM<\NT.
SrHEilL ,
en
A[lronon¡ie,
t>fl cet orbe ou étendue
concav~
qui enroure nQtre glo]>e,
{>¡;
auquel les eorps
célefies , le fc¡leil , les étoiles , les planeces
.&
les co·
meres femb1ent étre artachées.
Vo,yez
C1EL .
On l'appelle auflj la
JPhcr~
du monde,
&
elle ell
l'objer de
1'
Allronoo1i~
i'phérique .
f/py~z; ~STR ON Q·
¡,¡¡E
&
SrHhiQ,YI!.
Cecee
JPbere
d i extrémemem grande, puifqu'ell e
renferme les écqiles fixes;• ce qui la f'ait quelquefois
nom ll)er la
j'
p,ber~des éroiles fixes . Le diamecre de
l'orbite de la
ter.reetl
fJ
petit, q ualjd on le compare
au diametr<: de 13
.fpbe~·e
du monde, que le centre de
)a
(fher e
ne
fo~ff're
poinc de changement fen!ibl e,
qu01que l'ohfcrV3tCW Je p!ate f'ucceffivement dans les
diftérens p ints
d~
f!orbite: n1:1is en
toU~
te:ns
&
a
rous lef points de
la
i'urface de la rerre,
les
habi tans
Qnt les mfmes ap parences de la
JPber~;
c'elr-a-dire,
que les écoi!cs lixes paroilfem occuper le meme roint
dans
la fur fa ce de
b
(phrre ,
'V~yez
P ARALLAXl: .
N ocre maniere de
jug~r
de la !icuacion des allres ell
p~
concevoir des lignes (jroires
tin~es d~
l'ceil ou <lu
S
P H
centre de la terre, :\-tr
~''«:rs
le centre de l'11lr
,
&
qui
conrinu~nt
encore juiqu'3 ce q u'elle'
e u
•e<Jt
cene
/Pbere ;
les P'>im:s ou le
h•Tnes te
r~r'Tlinen
fon
t lesJieux
apparens de ces
aii:res.
l'oyr-
LrE~
&
PA.Ro\LLAXE.
Pour déterminer mieux
1~ lieu~
qoe le< corp oc–
cupent daos
la
/Pbtre,
on a Jma <mé
d•ff~ren
cercles
fur la furface,
&
qn'nn ap el le· par cette ra.C'on
cer–
des
t/e
la Jpbert.
1/oyr::.
EKr lE .
11
y
en a quelques-uns qu'nu a¡>¡>ellc
g>'llllds
ro·–
cles,
comme
l'~cliptique ,
le mérid1cn ,
l'é~ · qt<'Uf,
&c.
les aurres
p;rus
erre/
s,
aomm<! les
tr..>pi<Ju::
,
k s
paralleles,
etc. 1/qyt::.
ch1cun de
ces
c~rcle;
ton, ton
nom parciculier, EQ.:ATEUR, HoRr o . ,
~c~tP TI
Q.YE,&c.
SPHER E, "'
Géo"rapbi6, &c.
fig nifie une cermme
diíp~tirion
de cercle fur la furf.H·e de la rerre, dont
13
plilpart
aa~
em conjo ur
entre
eu~
l4 •u me titua–
tion,
m~i
fonr difrtremmenr d•fpofé
par rapport
aux diflerens poinr; de la furface de norre globe.
Les cercles qu'on concevoit onginaircmenr fu ,.. la
furfacc de la
J
Pher6 du monde, om été pour la plus
g rande parcie'
transfér.és par analogie
a
la furface d<t
la terre; oi'.t o n les con<,¡nit tr1cés dircélemenr tous
ceux de la
JPhtre
&
úaos les 111fmes plans, de manie–
re que
fi
le>
lans des cercle$ de la cerre .!toienr con–
tmués jufqu'a la
(phen,
ils co-i nci.Jeroiem avec les
eercles relpeél1fs qu• y lont placé• : c'ell a1nti que nous
avons fur la rerre un hori{on, un méridicn, un
é–
quatelt r ,
&c.
V~yez
HoR tSON,
&c.
Cnm n1e
l'éq<~areur
quo
~•1
Jans le del
divifela.fpbtr~
en deux pawes éga les, t·une feprentrionale
1'
auere
mér:dwn·Jic,
de-m~:ne
aofli
l'équareur qui ell fu r la
furface de la
c~rre ,
la d1vile en deux parcies
~gales .
f/oycz
EQ...UATEU R.
Ec comme le> méricliens qui font darJS
la
fPherc,
palfcm par les poles du monde , il en ell
de uc!me
de ceux qui fnoc fur la terre .
Voytz
MéRIDJEN.
T o ute la
JPhere,
o u le globe terretrre pou vant
amener tour-a-cour rous fes pomrs fou
le méridien;
&
le méridien pouvap t haulfar ou ba•lfcr
I'He
du
monde en gliífanr dans les cnrai lles de l'horifoo ; cela
fcrr
a
d~rcrmiuer
tes ai'peéls
d"
ciel
ii
l'é'{ard
de
tnus
les peuples de la
~erre'
a
'mefurcr les Jllhnces
d~s
lieux,
~
connoitre )a durée des nuirs
&
de
jo urs pour
tcl
lieu, le m ment du lever
&
du coucher du So–
lcil, l'heure qu' ol ell en tel cndroi t , quand
JI
ell nndi
dans un autre; en un mo r,
i\
r,éloudre roures
l ~s
que–
fho ns q ui regardem la
di(
oficioo de< lietn, tant entr'
eux tur le gl obe , qu'a l'égard du SJ!ei l
&
de tour te
ciel .
Voyez
G LO BE .
'
D
nc, fuiva ot la différence
politio~
de
quelqu~s
uns de ces cercles par rappnrt au.< JUtres, il arnve
qu<' nous avons la
.[piure
droite par:Jil ete o u ohllt¡oe.
~a
JPbere
droite etl cell e dans
l~quelle l'équ~r~ur
coupe l' horifon du Jieu
a
anglcs droots.
D ans cecee licuation, l'équareur
&
¡ous
l~s
cercles
paralleles
~
l'hori(on, doivenr co uper
dore emene
l' porifon, lans s'inelir¡er <f llfl célté plus que
de
l'au–
cre . Réciprnqucmept
l'l]orolim cn upe l'équaceur,
&
tOUS ks cercles par<(liele;
a
l'équ~te ur
en deux por–
tions égales. T el le ell la
.fp/Jtre
d ro1ce ,
&
voico fes
effets . On a led·our en général qut que
111
f
leil
en:
fous l' horifon.
r
rpus les cercles que le fo letl dé–
cric diun tropique
a
l'aucre font
coup~ ~11
deux por–
tions égales par cet horifon, puifqu'ils tombeoc di–
reélemenc
deflus~
Les
jours y
font done t'3aJJX aux
nuits,
&
dura
m
-rourc
1'
Jpnée il y a dnuze
hcur~s
de·
jour
&
autant de nuit. Le foleil y defcendam
direc~
remen• fous l'horifon,
~·!!n
éloigne plus vire .que s'il
s'y plo ngeoi[ obliquemenc; ainli le crépufculc ell plus
courr.
•
La
(piure
parallele ell celte daos luquelle l'équateur
ell parallele a l' horifon fenfible'
&
dans le plao de
l'horifon rationnel.
•
Elle e(] relle pour ceux auxquels
le
pole fert de
zénith . Si ce coin du •moQde ell habitable , on doit
y
avoir l' horifi>n dans l'équateur, puifque le pote
&
te zénith y étant la
m~me
chofe ,
~
90
degrés de-la,
on rrouve également
l'horifon
&
l'équareur qui te
confo ndenr, ou devienoent paralleles l' un
a
l'autre;
ce
qui fa it dnnner a cecee d•Í¡¡otirion du monde le nom
de
JPbere para/Je/p.
En vo1ci les fu ices . Le t'oleil e/1:
lix moos en-desa úe l'équareur vers le pole aréliqqe,
&
lix mois au-del
a.
Si l'équaceur elll'tJOnfon des peu–
ples qui peuvent erre fous le poie' ils devroient voir
le foleil rourner !ix mois de fu rte aurour d'eux, s'éle–
Y~r
Eeu-a-peu
dt~ranc
trqis muis
jufqu'~
la haureur de
2~
















