
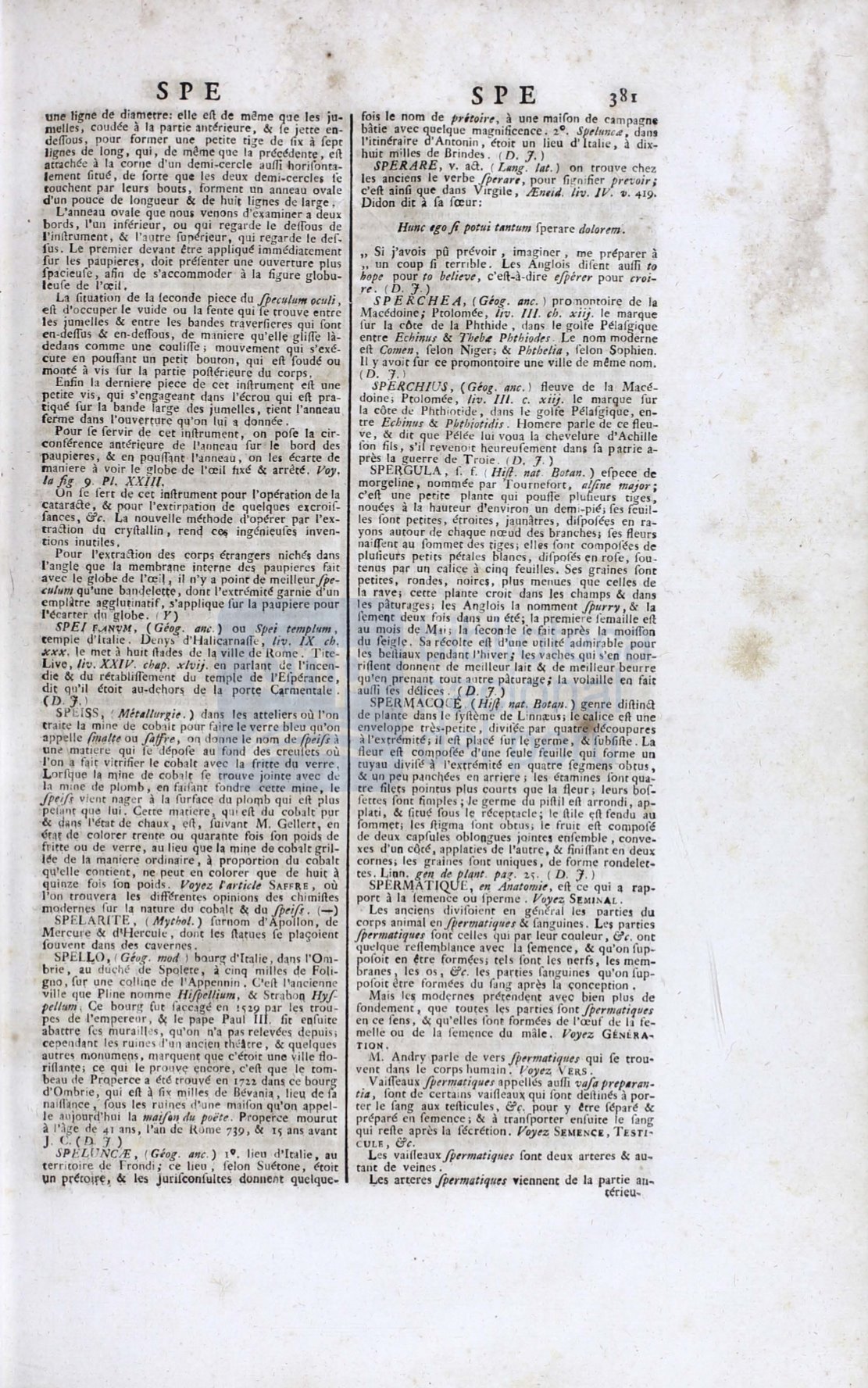
S PE
une
ligne de diamerre: elle efl de
m~me
que les ju–
melles, coudée
a
la parrie antérieure,
&
fe jetre en–
detrous' pour former une perite cige de !ix
a
fe pe
llgnes de long' qui' de
me
me que la précédence' efl
acrachée
a
la come d'un demi.cercle auffi ilorifonta–
lement !itué, de forre qut les deux demi-cercles te
touchent par leurs bouts, formenc un anneau ovale
d'un pouce de longueur
&
de hui1 lignes de targe ,
L'anneau ovale que nous V<!IJOns
d'e~aminer
a deux
bords, l'un inférieur, ou qui regarde le deífous de
l'inflrument,
&
l'aucre fupérieur, qui regarde le def–
fus. Le premier devane erre appliqué in¡médiatement
fur les
paupiere~,
eloit préfencer une ouvercure plus
fpacieufe,
a
fin de s'accommoder
ii
la figure globu–
leufe de l'o:it,
La
!ituation de la {econde piece elu
./Perqf¡¡m
Qm/i ,
efl d'occuper le vuide ou la fente qui
íe
crouve entre
les J·umelles
&
entre les bandes cqverfieres qui Cone
en-
e(fus
&
en-de!fous, de
ma ni~re
qu'elle g lif[e la–
dedans comme une couliffe ;
mouv~ment
qui s'exé–
cuce en poutrant un
peci~
bouron, qui efl: fo\!dé ou
monté
ii
vis fur la parrit;
polléri~ure
du corps ,
Eniin la derniere piece <!e cec
inftrurnen~
efl une
pe
tite
vis, qui
s'e¡¡gage~n~
<lans
l'écrou qui elj pra–
tiqué fur la bande large eles jurr¡elles, tiene )'anneau,
fetme daos
l'ouvert\lr~
qq'o11 lqi
~
qonnée,
Pour fe fervir
d~
tet inflrument, on pofe la cir–
conférence
ancéti~ur~
de
l'~nneau
fur le bord des
·paupiercs,
&
er¡
pouff~r¡t
l'anneau, on les écarte de
m aniere
a
voir le g lobe de l'reil hxé
6í
arreté'
lloy ,
la
fig .
9· PI,
XX!!/,
On fe ferr
d~
ce
e
inflrument pour l'opération de la
cataraae,
&
pgut' l'exrirpation de quelqucs excroif–
fances,
&&.
La nouvelle mérhode d'o;>érer
p~r
l'ex–
trafiion du cryflallin,
ren~
ce¡¡
ingéni~qfe~
inven–
tions inutiles,
Pour
l'cxcra~ion de~ corp~
étrangers niché! dans
l'angle que la membqne
jnt~rpe de~
paupieres fair
avec le globe de
l'~il
t
il u'y
a
poinr de meilleur
fPe–
CIIIt/111
qu'une
b~qcf~lett~,
done l'extrémicé garnie
a'
un
emplQtre
agglu~inarif,
5'applique fur la
p~upiere
pour
l'écarcer <l\1 ·globe.
r
Y)
·
SPE~ fl~riv~,
(
Géo!{,
1111c. )
ou
Spei
tempt11m ,
•temple <,l'lralie. D enyo d'Hali<;arnatre,
liv, IX
&IJ,
Jex~.
le mee
a
hnit flades de la ville de.Rome. T ite–
Live,
(iv. XXIII.
chsp. xlvij,
en parlallc ele !'incen–
die
&
du
r~cablilrement
du ren1ple de l'Efpérance,
dit qu'il
éroi~ ~4-d~!¡or~ d~ ~~
porc!;
<;:~rment~le
.
(D . '} ,
l
SPEISS
1
~
Mh•llurgie.)
dans
le~
atteliers oii l'on
traitl! la
mtne
d~
cobale poor faire le verre bleu qu'on
appelle
(i¡1ª(u
o
u
fotfi:e ,
Olj
donne le nom de
!feifi
a
un~ maci~re
qui fe"·dépofe au fond des creu1ers ou
·l'on a
f~i¡
vicrifier le cobalt avec la fdne du verre
1
L orf\jull
1~
rr¡ine ele cobql¡ fl; crouve joinre aveo de
b
mine de plomb,
.en
faifa11t fondre cectt> rr¡ine, le
fp~ifi
vien t nager
a
la furfaCtl du plor¡¡b qui efl ¡>lus
pefa'1r que luí, <;erre rr¡aciere,
~ut
efl dll cobale pur
·&
g;¡r¡~
l'état
d~
chaux,
el\ ,
fut vant
M.
Gellerr, en
~¡qf d~
colorer trente ou
quar~pte
Ibis fon
110id~
de
frit~e
01,1 dt;
verr~,
a
u lieu que
1~
111i11e de cobale gril-
1~~
de
1~ m.anier~
ordin:rire,
~
proporrion du cobalt
qu'elle contiene, ne peut en colorer que de ht,ut
~
qui!lze fois fon poids.
Voyez
f11rtic/~
SAFFI\E, ou
l'on
~rol\vera
les
dilférem~s opinion~
des chimiíles
m odernl!s íur
1~
narure du
cob~lt ~
du
fpeifi.
(-)
SPELA,RITE,
( Mythol. )
furuom d' Apollon, de
Merc;ur~ ~
diHercule , done lt;s
fl:a_~ue~
fe plasoient
fouv.ent dans des cave rnes.
S~EL-1.0,
(
G~ug.
mod
J
baurg; d'Icalie,
d~ns
I'Om–
brie,
w
dú<;hé
de Spqlere,
~
cinq
'mill~s
ele Foti–
gno, fur 1,1ne cqlliqe de l'Ap.pennin. C'cfl lla.ncienne
vil le que P li ne nomme
Hijpellium,
&
Scr~bo11
Hyf–
pelltJm.·,
Ce bourg fue íacqgé en
!>29
flr
~~~
trou–
pes de l'empereor,
~
le pape Paul
lf .
lit
eqíuice
abarcre fes. (11Ura illes, qu'on n'a pas
releyée~
depuis;
cepen<lanr les ruines d'un ancien.
ché~cre,
&:
quelques
aurre~ monum~(lS, n1arquen~
que c'étoit une yille tlo–
ri{l3n¡e;
~~
qui le prouytl
~11co.re,
c'efl que
1
1~
tom–
beau de Properce a été trou
vé en1722.
dan~
ce bourg
d'Ombrie, qui
el!~ fi~
m)lles. de Bévan.i'\, lieu de fa
na1ílqn.ce\. fo,us les r uines d'·une maifon ql\'On a,ppel–
le ~u¡ouíi\'·hui
la
~n'!ifo'~
rj11. poete.
P.ropei'.:e m.o.urut
a
l'age de
~l
ans, l'an de
Ro
me
739,
&
1~
ans avant
J. C. (D. J )
.
SPEf,UN.C'IE,
(
c ;og.
anc. )
l o,
lieu d'Icalie, au
terricoire de Frondi; ce lteu , felon Suécone, étoit
\In
píétQlf~~ ~
les
Jurifcenfulte~
donuent q.uelque.
S PE
fois
le
nom de
pritoire,
a
une maiíon de campaune
b~tie
avec quelque mal!:nificence.
2°.
Speltmc,e ,
;fans
l'itinéra ire d'Anronin, -étoit un lieu d' Jralt e,
a
dix–
huit m"lles de Brindes.
( D.
J.
)
SPERARE,
v. aél:,
(
Lllii!J.
/at. )
on trouve chez
les anciens le verbe
./Perart,
pour
íi~n ilier
prevoir;
c'efl ainíi que daos Virgile,
.IEtltitl.
l iv.
J
11.
v.
419.
Didon dit
;l.
fa
fo:ur:
Jfllnf
tgo
ji
potui
t11ntttm
[perare
dolorem·,
, Si ¡•avois pfi prévoir , imaginer , me préparer
a
, un coup
(j
ternble . Les Anglois difenc auíli
to
hope
pour
ro
be/Í(1,1(,
c'etl-a-elire
ejpérer
pour
croi–
re
. ( D. J . ) SPER.CH/J.A,(Géog.
¡me. )
promontoire de la
J
Vlacédoine¡ l'rolomée ,
liv. 111. &h. xiij.
le marque
fur la cóce ele la Phchide , daos le golfe Pélafgique
~nere
Echillllf
&
''l'heb.e
Phthiodu .
Le nom moderne
ell Comen,
felon Niger;
&
Phtbelia
,
lelon Sophien.
ll
y
pvoi t fur ce prqmontoire une ville de meme nom .
( D . }.
l
SP/ii(,CHIUS,
(
G¿og. anc.
J
fleuve de
la Macé–
doine; P¡olomée,
{iv.
111.
c. xiiJ..
le marque fur
la
cote
de
Phch intide , dans
1.:
golfe Pélafgi que, en–
ere
Ecbimu
&
Pbthiori4h.
Homere parle de ce fleu–
ve,
&
die que l>él ée luí voua la chevelure d'Achille
Ion lils, fi( revenoit heureu(ement
dan~
fa patrie a–
pres la guerre de T ruie.
( D.
J .
)
SPERGULA ,
(.
f.
(
fii/l -
nat. JJotan.
)
efpece de
morgcl ine,
nom111~e
par fourneforr,
nl/ine
major;
c'efl une perire plante qui pou(fe plu/íeurs ciges,
nouée~
a
la hauceur d'environ un dem i-pit'; fes feuil–
les font pe(ites, é¡roices,
jaqn~tres ,
difpofées en ra–
yons autour
d~,:
chaque nreud des
bra nche~¡
fes fl eurs
naiffenc
a4
fommer des ciges¡ elles [on r
compo(~es
de
plulieuts pe¡i¡s
pérale~
blancs, difpofés
~n
rofe, fou–
cenus pqr
1111
calic~
a
ciqq feuilles, Ses g raines font
petices, rondes,
noire~,
plus menues qt¡e celles de
la rave¡ cerce planee croit dans les champs
&
dans
1
es
p~t4r~ges; le~
Anglois la nommenr
JPurry
1
&
la
r~ment
<leux fois dans un éré; la prer¡¡iere femaille efl:
au mois
d~
J\I¡J i; la feconde le fait apres la muiífon
du feig le. Sa récolre e!l tl'une utilité admirable pour
les belliaux peoJant l'hiver; les
va
ches qui s'en nour–
riOent
donn~nc
ele meilleur la ic
6(
de meilleur beurre
qu•er¡ preqan¡. cour
a
uere parorage
¡
la volaille en fait
auiTi fes délices .
((J.
J . )
SPER t'v¡ACQ CE , (
Hift. n{lt. Bota11.)
genre dillinfi
de plante daos le
fyll~me
de
Linn;t:u~;
le calice eft une
enveloppe cres-pente' divili'e par quaere découpures
a
l'exrrémi¡é;
i1
el! placé fur
1~¡:
germe,
&
(ub{ifl:e. La
fleur efl corr¡po[ée d'une feule feuille qui forme uo
cuyau divifé
~ l'e~trémité
en quaere fegmens -ob¡us,
&
40 pe4
p~ncl1ées
en arriQre; les écamines li>nt qua–
ere lilees
poin~us
plus courts que la fleur ¡ leurs bof–
fette~
fonc limpies; Je germe du pillil efl arrondi, ap–
placi,
&
{¡rué fous le
réc~pcacle;
le !lile
~íl
fendu au
(omrr¡~t;
les 1\igm.a font obcus; le fruic efl: compofé
de deux capfules oblongues jointe$ enfemble, conve–
xes
d'un c(\cé, applaties de l'aurre,
&
linilrant en deux
cornes; les graines íonc uniques, 'de forme rondelet–
tes . l..,ipn.
gel{ de
p/a_nt. pag.
2> ·
( D.
J. )
SPJORMATIQUE,
t'l
Anatomie,
efl ce qui
~
rap–
porc
a
la {emence o u fperme .
1/oyn;
St;M!N.A,L.
, Les af1CÍCf1S divifoienc
engén~ral
les
parcie! du
corps animal
enff.umatir
¡r.es&
fanguines.
Le¡
parcies
JPermatir¡Jm': (ont
celles
l¡ui par- leur cQuleur,
&c.
ont
qudqoe
re1Ten1bl~nce
avec
la (eQ1ence,
&
qu'on fup–
poíoi~
en
~ere form~es;
tel
s font les nerfs, les mem–
branes, les os,
&c.
~~~
panies fanguines qu'on [up–
pofoit
~rre
formées du fang
apr~s
la
~once¡uion
.
Mais
le~ mod~rnes pré,end~t1t av~o
bit>n plus de
fondemenc, que
~ou~es l~s p~rtie~
font
fperm(Jtir¡ues
en ce fens,
.S¡
qu'elles fonE formées de l'reuf
d~
la
fe–
melle ou de la lemence <;!u male ,
lloyn
qÉNfR<\,
TION,
· M:
A,nelry parle de vers
jfermatiqtltJ'
qui fe trou–
vent dans le corps huma in'.·
Poye:z;
i;R.S .
Va
i{\eaux
Jiurt!llltiquu
appellés
auffivif!
PreP•rafl–
tia'
ro.ncde cerrains vaiíleaul( qu_i
fQ.ntdel1inés ¡¡ por–
ter l
e fang aux teflicules,,
&~,
po
\]r y~ere
[éparé
&
préparé
en
femence;
&
a craníporcer enfuice le íang
qui reíle apres la fécrécion,
f/oyez.
Sp!ENCE, TEsn–
CULf.,
&c.
L es
vaiíleauxJPermati_ques
font deux arceres
&
au~
tant de veines , ·
J,.es
art_eres
JPem¡atiquu
Yiennent de la part!e
a
u~
(éneu.
/
















