
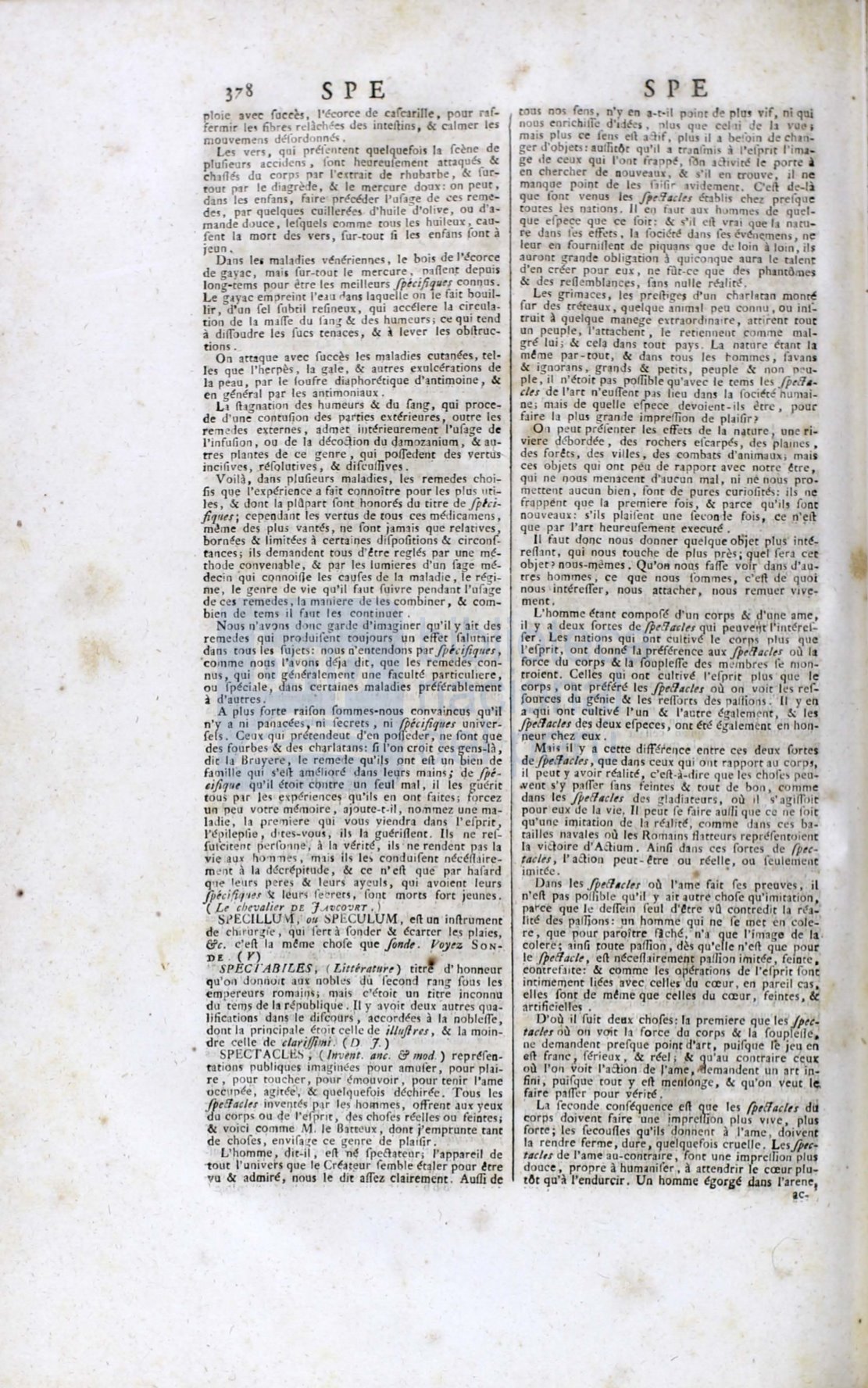
3 8
S PE
loie ave
focces, l'écorce de cafCJrine , pour rlf–
fermir le• libre
rdlch~
des imeflins ,
&
olmer les
moovemens
d.!(ordonn~.
Les vers, qui
prél~n
ent qoelquefois la
fc~ne
de
plufieors accidens ,
lont heoreufement :1mqoés
&
ch
1
1lés do corps ¡llr
l'e~
rait de r hobarbe,
&
fur–
tout p1r le diagrede ,
&
le mercare donx: on peut,
dans les enfans , f1ire préreder l'ufage de
.:es
reme–
des, par quelques cuillerées d'huile
ii'oli~e,
o
a
d'a–
mande d uce , lefqoels comme taus les h01lemr,
e~
u:
fen t la mort des
ven,
fur-rou t
fi
les enfans (ont
a
jeun.
.
,
D ans
leo
mala ies
v~nériennes,
le bors de
1
.!corc_e
de gaya
e,
m1ís fur-tou t le merco
re:
.nallen.r depms
Jong-tems pour erre les meilleurs
.fpecifiquN
c onoo.s.
Le
gaya
e
em reí
m
l'ea
tlaos laquelle on le fa1 t .boull–
lir , d' un fel fub til re.fineux, qui accélere la
Cl~cula.
tion de la mJrfe du lan"
&
des humeur ;
Ct!
q01 tend
a
dirfoudre les fucs tenaces
1
&
A
lever les obllruc–
tions.
O n artaqtte avec focces les maladies curonées, tel·
les que
l'herp~s,
la
~ale,
&
autres exolcérations de
la peau , par le loufre .
diap~orétique d'~nrimoine
1
&
en génér1l par les annmomaux.
L
1
lla"nanon des humeurs
&
du fang, qui proce–
de d'un.;' contu!ion des
p~r'ti~s
extérieures, outre les
rem edes externes, admet intérieurement l'ufage de
l'infu lion, ou de la décoqion du clam zanium ,
&
au–
rres plantes de ce genre
1
qui polfedent des vertth-–
incilivcs, réfolutives ,
&
difc:uffives.
Voila , dans plu!ieurs maladies, les remedes choi–
fis ql!e l'expérieoce
a
fait connoirre pour les plus llti–
les,
&
dont la pHipart font honorés du titre de
.fplci–
fiqflu;
cepend~nt
les verrus de tnus
ces
médi camens ,
m€!me des plus vantés, ne foo t jamais que relarives,
bornées
&
limitées
a
certair¡es difpofitions
&
circonf–
tances; ils demandent tous d'J!tre reglés par une mé–
thode conven3ble,
&
p~r
les lamieres d'un fage mé–
decin qui cQnnoiOe les ca11fes de
b
maladie, fe
r~i
me , le genre de vie qu'íl f:1ut fuivre pendant l' ufage
de ces remedes, la maniere de les combiner
1
&
cam–
bien de tems il flut les conr inuer .
N ous
n'av~ns
d nc gardc d' imaginer qu'il y ait des
remedes qui pro:.luifem roujours t¡n effet falut:tire
dans rous les fuj ets: nous n'entendons
parfP; ,;ijiqflu,
'comme nous l'a vom déja dit, que les remedes con–
nos
1
qui ont g énéralement une f.1culté parriculiere,
ou fpéciale
1
~ans
certaines maladies préférablement
a
d'autres.
'
A
plvs forre raifon fommes·nous convaincus qu'il
n'y a ni panacées
1
ni fecrets
1
ni
/Ncijiq11u
univer–
fel s . Ceux <¡Ui pretendeut cj'cn po!feder
1
ne font que
des fq urbes
&
des charlatans: fi. l'on croit ces g:ns-lii
1
dit la 13ruyere, le remede qu'1)s p nt efl ljn b1en de
fa
mille qui s'ell amél ioré dans let¡rs mains;
<)e
.fp;–
eifiqtlt
qu' il étoit c(¡mre un feul mal , il
les guérit
tou p1r )es expériences qu'ils en ont faites ; forcez
un peu votre mémoire, ' ajoute-t-il, nommez une ma–
ladie, la premiere qui vous viendra daos
1'
efpri t ,
l' .!pílepfie
1
d•tes-volis, ih la guérillent . lis ne ref–
futcitent perfi:>tne:
a
.la ,vérité' ils .
n~
rendeot pa.s la
vie
aUJ<
ho 'T!Ties , ma1s 1ls le> cond01fent
nécéfla~re
ment
~
la décrépirude,
&
ce n' ell que par hafard
q'le leurs p res
&
leurs ayeuls , qui avoient leurs
jp;cifiq·•e.r
~
leurs fec rets, font morts .fort jeunes .
(Le c!Jevalter
pe ] .Av CO"JRT
••)
·
St'ECILLU
1;
ou
'P ECULUM, ell un inflrument
de ch•rilrgle ' qui fert
a
fqnder
&
écarrer le.s plaies,
&c.
c'ell la
m~me
chofe que
.fonde . foyez
SoN–
DE .
(Y)
'
SPECTABILES,
(
Littératun)
titr
d'honneur
qu'on donnolt aox nobles qu ' fecond rang fous les
empereurs romaj1¡s; mais c'étoit un titre jnconnu
d u
ten¡~
de la
r~public:¡ue.
Il
y
~voic
deux 'aurres qua–
lificatioos dans le ljifc;qurs' , accordées
a
la noblelfe,
dont la
pri~cipale.
étoi.t celle de
illujlru,
&
la moin-
~re
cel le
ele
clatiffi!nt .
(O
J. )
·
SPECTACL!l.S, (
lnvent.
aru.
&
mod. )
repréfen–
tations p
ubliques imag inées pour amufer, pour piai–
r e , pOL¡r
touch.er, pour émou voir , pour tenir l'ame
occ\lpée ,
agirée',&
quelquefois déchirée. Tous les
JPellaclu
invel]tés p.1r les ho Rtmes, offrent aux yeux
du corps ou qe l'eíprit , ljes chofes
réelle~ou
feintes;
&
voici comme
M.
(e Barteux , dont j'emprunte tant
de chofes ; envifage ce
ge~re
de' pla1Gr .
L'homme, clit-il, ell
llé
fpeél:areur i l'appareil de
-tout l•univers que le Crlfa¡_eur femble
ét~ler
pour
~tre
y
u
&
admiré ,
~ous
le dit alfez clairement . Auffi
d~
SPE
m nos . fens, n'y en a-r-íl p int
e
la
\'Íf,
ni qll.i
nous ennch1lfc_ d'd
,
'>lo< que celti
d
h
\'Ut'
¡
rnJI
plus ce
len
el\
tf, plu
,¡
l
be•om de
eh
a
.
ger d'obje
: autlitót qu'1l
l nlim
3 l'eirm l'imJ–
ge •le ceux qui
1'
nt
t~ ~.
1
n
l
1viré
1
pone
~
en
cherche~
de nouve1ux,
&
'1l en
tTOU\'t' ,
11
ne
manque p mt de les f1ilir J\'i ement C'efl d('-12
que lont venus
les
¡;~
'ladn
~bht ~hez
prelque
routes les nat1ons.
11
en
iaur
au'
hum~te
de quel–
que efpece que ce foi t :
&
•l
en
v~1
que 1.1
nuu–
re dan
l".!s eff.:t •
la
r
ciére dJn
fe événe.men
1
ne
leur en fourn11lent de p1quan que de loin
Iom, lis
aoronr
~nde
oblig:nion
~
<JUÍc nque aura le ulen
d'en creer pour eu:r, ne filt-ce que de
phant6 e
&
des rell mbiJnces, fans nulle r<"Jliré .
Le~
grimaces, les prefl•g
d'un charlaron monté
fur. des tréceaux, q uelque an1mal peu connu, ou inl:.
tnm
~
quelque manege euraordmatre ,
an~rent
touc
un peuple, l'att:tchent
1
le ret1cnnenr e mme mal–
gré luí;
&
cel3 dans tour pays.
La
nantre
~tanr
l:a
m~me
par - tout ,
&
dan
tous le
J-ommc ,
f:~,•ans
&
ignorJ ns, g rands
&
petlf>
peuple
&
non fi'U–
ple, il n'étoit pas po(JibJe
qu'a~ec
le tems le
fP•,7•–
des
de l'art n'eulfenr pas heu daos la foc1été numai–
ne; nuis de quelle efpece dcvoicnt- lls
trc, p ur
faire la plw g ran e impre(Jion de plai!ir
¡
O n peut préfenter le effers de la
n~turc
1
une ri–
viere débordée , des rochers elearpés , de
pla111es ,
des
for~r
, des villes, des combn d'animou-.. , mais
ces objet
qui ont peu de rJpporr avec notrc
~tre,
qui ne noos men9cent
cl'~ ucun
mal, ni né
nou~
pro–
mettent aucun bien, font de purcs curiofir6. : ils ne
frappl!nc que la premiere fois ,
&
paree qu'1ls font
nouveau.: s'ils plai!'enc une fec n•le fois , ce n'efl
que pl r l'art heureufemenr executé .
•
11
faut
do~
e:
nous donner qnelque olijet plus inté–
reflant, qui nous rouche de plu
pres ; quel fera cet
objet
1
oous-n¡emes. Qu'oH nons farfe vOLr dan
d'~u
cres
homme~,
ce que nous
to mmes
1
c'etl de quoi
nous intérelfer, nous atracher
1
nous remoer VIVe–
mene.
L'homme étanc compofé d'un corps
&
d'ure ame,
il y a deux forres de
fP•,7trrlu
qui peuve1 t'l'imércl:.
fer . Les nations qui onr cultive! le cor¡n plus que
l' efprit , ont donné la
pr~férence
aux
.fpe'llaclet oi\
ht
force du corps
&
la fouplelfe des
m ~mbres
le mon–
troienr. Cellcs qui ooc culrivé l'efprit plus que le
corps , ont préféré les
JPeE!,tcltt oi\
on voit les ref–
fou rces du génie
&
les relforrs des
aflions .
11
y en
.a
qui ont cultivé l'un
&
l'at:tre
égalem ~nt ,
&
les
.fpdlacles
qes deux
e(
peces, ont été égalemcot en hon–
peur <:hez eux .
· M1i• íl
y
a
cette diff.!rence entre ces deux fortes
de.fPdfa(/es,
que dans ceux qui ont rapporr au cor s,
il peut
y
avoir
réalit~,
c'ell·ii-clire que les chofe> peu–
.vent
s'y
parfer fans feintcs
&
rout de bon, comme
dans les
JP•Eladu
des gladiateurs , ou 1t
' agl ffnit
pour eux de IJ vie,
11
peut fe f.1ire auf!i que co ne toit
qu'une ill)itation de la n'al ité, comme dans ces ba–
taillcs navales ou les Romams fhtteurs repréfenroicnt
la viétoire d' Aél:ium . Ainfi dans ces forres de
(pu–
tadu'
1'
aélioo peur -
~tre
ou réelle, ou reulement
imitée .
•
Oans les
jjuE!adu
oil l'ame fa it fes prcuves, il
n' ell pas poflible qu'il y air au tre chofe qu'imltation,
paree que lt! derfein feu l
d'~tre
vQ conrred•r la
r~a
Jiré des patTions: un homme qui ne fe mee en cole–
re, que pnur pai'Í¡irre fiché, n'a que l'image de Ja .
col
ere~
ainli toute pa(Jio'n ,'des qu'elle n'efl que pour
)e
.fPeE!acl•
1
ell nécellairemel)t paffion imitée, femtc,
coorrefme:
&
comme les opérations de l'efprit font
intimement liées avec,
cell~•
du cceur, en pareil cas ,
elles fqnt de
m~tne
que celles du cceur, feintes
1
&
artiñcielles .
D 'ou il 'fuit
de~Jr
chofes: la premierc que les
fltt–
tader
tiu on
vait
la fo rce 'du corps
&
la fouplefle ,
ne demanqent prefque point Cl'art, puifqne le jcu en
etl
franc
1
férieox,
&
réel
¡
~
qu'au contraire ceuiC
ou l'on voic l'aélion de l'ame,
~emandent
un art in–
fini , puifque 'tout y ell menfonge
1
&
qu'on yeut ll;.
faire parfcr pour vérire.
· La fecunde conféquence
etl
que les
{ptE!a&lu
diJ
corps doivem faíre ·une impreffion plus v1 ve, plus
forte; les fecoulles qu'ils qonnenr
a
l'ame ' doivent
la rendre ferme
1
dure
1
<¡uelquefois cruelle. Lesfpu–
tadtt
de l'a me ao-contra1re, font une imprelfion plus
douce' propre
a
humanifer'
~
atteodrir le cceur plu–
~Ot
qu':\ l'endurcir .
Un
homme égorgé
ilans
!'arene,
•
ac.
















