
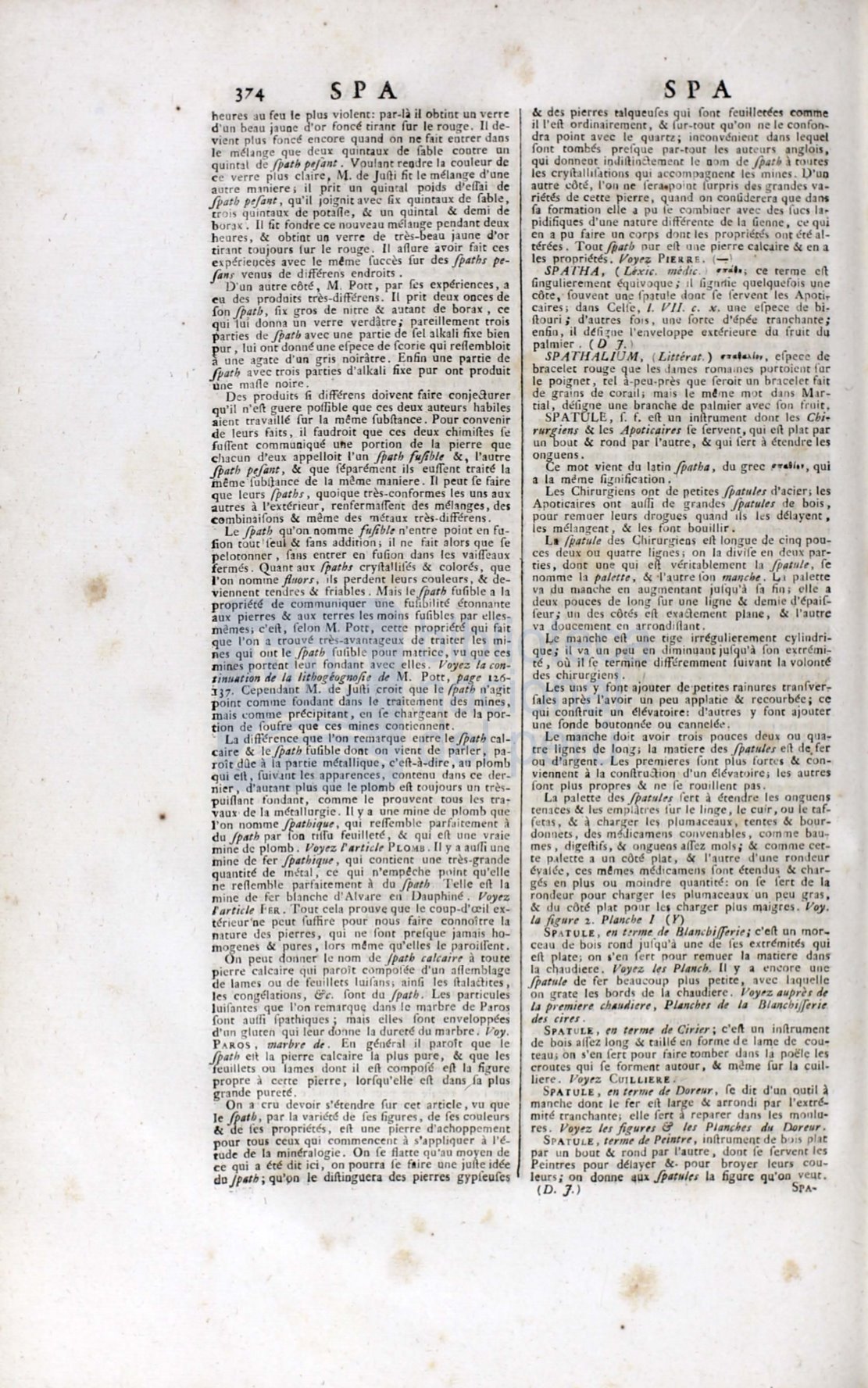
S P A
heures
~u
feu le plus violenr: par-la il ob tinr uo verre
d 'un benu jauoc d'or foncé rirnm fur le rou,.e .
11
de–
viene plus foncé encare quand on ne fftit correr daos
le
mél~nge
qut deu"'
qumr~ux
de fable coorre on
qumul de
Ji111tb
ptjimt.
Vpulanr reodre la couleur de
c e
ver
re plus claire
1
M.
de J ufli lir le mélange d'une
a urre m1nicre; il prir un quiural poids d•elfai de
.fPoth pifant,
qu'il joignit avec
lix
quinrnux de fab le,
rro" quinraux de poraiiP., & un quintal & demi de
b orJX .
11
fir fondre ce nouveau mélange pcndant deux
h eures,
&
obriot uq verre de
rr~-beau
jaune d'or
t irant t ujours tur le rougc .
11
allure avoir fair ces
e•périel)ces avec le mt me
fucc~
fu r des
fpathr pe–
fons
venus de d1/férem cndroirs ,
O 'un aurre c6ré ,
M.
Porr, par fes expériences ,
a
e u des produirs rres-dilférens .
[1
prit deux ooces de
fon
./Pfth,
fix gros de nirre
&
aurnnr
~e
borax , c_e
q ui IUI donna un verre verdarre ; parell lement rro1s
p arries de
JPatb
avec une parrie de fel alkali lixe bien
p ur, lui onr donné une efpece de [corie qui rellembloit
a
une agarc d' un gris noirarre. Enfin une panie de
fpotk
avec
rr~is
parries d'alkali fixe p ur ont produit
une malle no1re.
D es produirs
íi
différens doivent faire conjeaurer
qu'il n'en guere poffible que ces deux aureurs habites
a ienr rravaillé fur la meme fubnance. Pour convenir
d e leurs fai ts'
il
fa udroit que ces deux chimines
f~
fulfenr communiqué ulle porrion de
la pierre que
c hacun d'eux appelloit l'un
./PI!t!J
fojiblt
& ,
l'aurre
fpatb plja11t,
&
que féparémenr ils eulfenc traité la
in
eme fubf}ance
de
la
m~me
maniere . Il peut fe faire
q ue leurs
(paths,
quoique tres-conformes les uns aux
a
utres
a
l'exrérieur. renfermalfent des mélsnges ' dei
combinaifons
&
m~me
des
'llétaux rres-différens .
Le
JPoth
qu'on nomme
(t!fibl~
n'enrre point en fu–
fion rour 11eul
&
fans addinon; il ne fait alors que fe
p eloronner , fa11s enrrer en fufion dans les vai(feaux
fermés . Q uam aut
fPaths
crynalliles
&
color~s,
que
l'on nomme
fluors,
lis perdent leurs couleurs,
&
de–
v iennenr renilres
&
friables. M ais
le.fParh
fulible a
b
p ropriéré de communiquer une
fu fibi liré éronnanre
aux pierres
&
_aux terres les moins fufibles
p~ r
dles–
inemes; c'eft, leIon
M.
Pote, cettc propriété qui fai t
q ue l'on a rrouvé rr s-avanragcux de rraicer les mi–
n es qui om le
jpotb
fu lible pour marrice,
\'U
que ces
m ines portear leur fondanr avec elles.
f/oy~z
la con–
t inu•tion de la litbogéog11ojie
d~
M.
Pott,
pog~
126-
:t
37·
Cependant
M.
de J ulli ,croir que le
(patb
n'agit
p oim comme fo ndant dans le rraitemenr des mines,
m ais comme précipirant , en fe chargeant de la por–
t ian
de foufre que ces mines conriennent .
·. La difleren ce que l'on remarque entre le
JPath
cal–
c aire
&
le./Path
fufible donr on vienr de parler , pa–
r oit .f!Oe
a
la parcie mérallique, c•en-a-dire, a
u
plomb
q ui ell , fuiv'Jnt les apparences, conrenu dans ce de,·–
n ier , d'aucant plus que le plomb en roujours un rres–
p uillanr tondant , comme le prouvenr rous les rra–
vaux· de la mérallurgie .
11
y
a une mine de plomb que
l'on nomme
.fpatbique ,
qui relfemblc parfairemenr
ii
d u
j plfth
par fo n n!ru feuilleré,
&
qu1 ell une vraie
m ine de plomb .
f/oyez
f•rticl~
PLOMa .
[1
y a auffi une
m ine de fer
JPatllique ,
qui contient une tres-grande
q uanriré de méral, ce qui n'empeche p<>lnt qu'elle
ne reOcmlile parfairement
A
du
JPatb
Telle en la
m ine de fer blanchc d' Alv•re en Oauphiné.
f/oyez
f ¡¡rticle
f•sa .
Touc cela prouve que le coup-d'ccil ex–
térleur'ne peor fuffire pour nous fairc connoirrc la
narure des pierres, qui ne fonr prefque jamais ho–
mogeoes
&
pures , lors
m~me
qu'ellcs le paroilfenr.
On peur donner le nom de
Jpoeb ca/caire
a
roure
pierr~
calcaire qui paroir C<lmpofée d'un allemblage
<le lame ou de feuillers luífans; ainfi
les nab lllres,
les congélarions,
&c.
fonr du
fpath.
Les particules
l uif.1nres que l'on remarque dans le marbre de Paros
fonr auffi fparhiques ; mais elles
fonr enveloppéeS
d'un gluten qui leur dllnne la dureré du marbre.
Voy.
P AROS ,
mm·bn d• .
En
général il paroir que
le
Jjoth
Cit
la picrre calcai(e la plus pure,
&
que les
{euillets ou lames donr
il
en compofé en la fi ure
propre
a
cerre pierre' lorfqu'elle en dans)a plos
g rande pureré.
· On a cru devoir s'étendre fur cer arricle, vu
qu~
le
fp•tb,
par la variécé de fes figures, de fes couleurs
&
de fes propriétés, ell une pierre d'achoppemenc
p our rom ccux qui commencent
a
s'appliquer
a
l'é–
rude de la minéralogie. On fe fiarte qu'au moyen de
ce qui a éré die id, on poorra fe faire une june idée
du
jp•tb;
qu'pn le diftioguera des pierres gypfeufes
S P A
&
des pierr
talqueufe qui font
~ uill~es
comme
il l'en
~rdinairemenr,
&
fur-rouc qu'on ne le confon–
dra pomr avec
le quarn ; inconvélllenr dJns lequel
font rombés prefque par-r ur le
aur,·urs an lois
qui donneor io<lillinc emenr le O'lm de
fp rJ.
~
tollte;
les crylblhldtions qu1 accom
a~oenc
les mme .
I)'UQ
aurre <:t}ré, l'on ue ferJop •or lurpns d
grande va–
r iétés de cerre p1crre, q_uJnd on conlidcrera que da
M
fa formarían elle
J
pu
k
combmer avec
Je
fucs la.
pidifiques d' une narure d11férenre de la licnne ,
e~
qui
en a pu fa1re un corps donr les
proprié~,
out
éu!
al–
térées .
TourJPatb
pu r en une pierre cale.aire
&
en
a
les
propriét~s.
Voy"¡.
P1u
R6 .
1-
'
SPATHA, ( Lixic. mMtc.
..-&1• ;
ce
rerme cft
fingulierem~nr
équiv que;
11
fi~nrtie
qoelqudo1 une
c6re , fouvenr une f
a
rule done fe (ervent le
poti.
caires ; dans Cellc, /.
f/
JI.
c. x.
une efpecc de bi.
flouri ; d'aurres fo1s, un<: forre
d'áp~e
rranchJnte ;
enfin,
il
déli ;ne l'enveloppe cxcérieure du fru1r du
palmier . (
D
J .
l
SPATH Al.IUM,
f
Littérae. )
,..,.,¡,,,
efpece de
bracelet rouge
qu~
le
d JOlCS
rOOIIIIIJC purtoient (ur
le poi¡¡:net, tel 3-peu.pres que feroir un bracclcr fa ir
de grams de corall; mais le m! me mor dJns
1
lr–
rial, Mfigne une branche de palmicr avec fon frnlr,
P
ATULR, f.
f.
en un innrumenr donr les
Chi·
rt1rgims
&
les
Apoticairu
fe fervcnr , qu1 en plnr par
un bour & rond par l'aurre' & qui fer t
a
ércndre les
oncruens,
E:e mot vienr du latin
.(Patbo,
du gree '""" " , qui
a la
m~me
fignification ,
Les Chirurgiens
01'[
de nerires
JPatiiiU
cl'acier; les
Aporicaires ont auffi
ele
gra ndes
JPoru/u
de
bois ,
pour rcmuer leurs drogues quand lis
l<s dél:l)·em ,
les mélangenr,
&
les font bouilli r.
la
/Patule
des Chirur.r1en$ etllo11gue r:le cinq pou–
ces cleux ou quarre ligMs; on la divife en
den~
par–
ríes , done une quj
e~
vérirablemcnr In
fpptule,
fe
nommc
1:1
paletee,
&
·l'aurr~
Ion
ma11clu .
L
1
pJierre
va ¡ju manche en augmenranr julqu':l
f.1
fin ;
lle a
deux pouces de long fur une hgnc
&
dem1e d'épaif–
feur; un des c6cés en
cxa
ement plane,
&
l'aucre
va doucemem en arrond•Oanr .
Le manche en une ti"C irrégu lieremenr cylindri–
que;
il
va un peu
en
dFminuant jufqu':\ fon
c~rr<!mi
té, ou
il
fe termine différemmenr
(uiv~nt
la volonré
des chirurgiens .
Les uns y fol]t ajourer de·perites rninures crnnfver–
fa les apres l'avoir un peu applatie
&
recourbée ;
ce
qui conn ruit un éléva roire : d'aurres y fonr ajourer
une fonde bouronnée ou cannelé.- .
Le manche doir avoir rrois pnuces deux ou qua–
rre lignes de Ion" ; la mariere des
fpatulu
en de. fe r
Ql!
d'argenr . Les premieres fonr plus
forr~s
&
con–
viennent
a
la connru.:tion d'un élévawire ; les nutres
(onr plus propres
&
ne
f~
rou illenr pas .
l a
palerr~
des
/Potulu
rert
a
érendrc les ongucns
renaces
&
h:s
empUrre (ur le hngc, le
e
uir, ou fe raf–
fcras,
&
~
ch2rger le$
plumdceau~,
rentes
&
bour–
donners, des méllicamens convenables, comme bao–
me , digefiifs,
&
onguens alfez
mol~ ;
&
comme cer–
re p.tlene a un c6ré piar,
&
l'aurre d'une ron eur
évaléc, ces mtme méd1camens (onr érendus
&
chJr–
gés en plus ou moi ndre quanricé : on fe
f"er r de la
rol]deur pour charger les plumacea ux un peu gros ,
&
du c6ré plar pour les charger plus 111aigrc .
·Voy.
la .figure
2 .
P/aiJCbe
1
(Y)
S PATULE ,
tn
t!r~ne..de
8/oncbiffirie;
c'en u_n mor–
cedu de bo1s rond JU fqu':l une de fes e1rrém1rés qui
en piare; on s'en
(ert
pour remuer la mariere dnns
la
c~audiece.
f/oytz
!u
Planch.
11
y
a
~n.:orc
une
jpotule
de fer beaucoup plus perire , avcc hqucllc
on grare les bords de Id chaudiere .
f/oyn. auprer de
liJ
pr~miere
ch• utliere, Pl•nchu
d~
la
8/ancbijftri~
du
ciru .
SPATULE,
en terme de
Ciri~r;
c'eli un inllrumcnc
de bois a
fre-z
long
&
raillé en fOfii"\Cde lame de cou–
teau; on s'en ferr pour fai re romber dans la poele les
croures qtli fe formenr aurour ,
&
mt!me fur la cuil–
liere.
f/oyn.
CUJ LLJER E .
PATULE,
tn
term~ d~
Doreur ,
fe dir d'un outil
~
manche donr le fer ell lar¡e
&
arrondi par l'exrré–
miré rranchanre; elle ferr
rep~rer
daos les monlu–
res.
f/oyn
/u
figures
&
/u
Planchu
áu
DIJreur .
SPATULE,
1tr111~
de Peintu,
innrumcnr de b•m phr
par un boor
&
rond par l'aurre, donr fe fervenr les
P einrres pour délayer
& .
pour
broyer leurs cou–
leurs; on donne
~ux
fpamlu
la figure qu'on veur.
(D.
J.)
rA•
















