
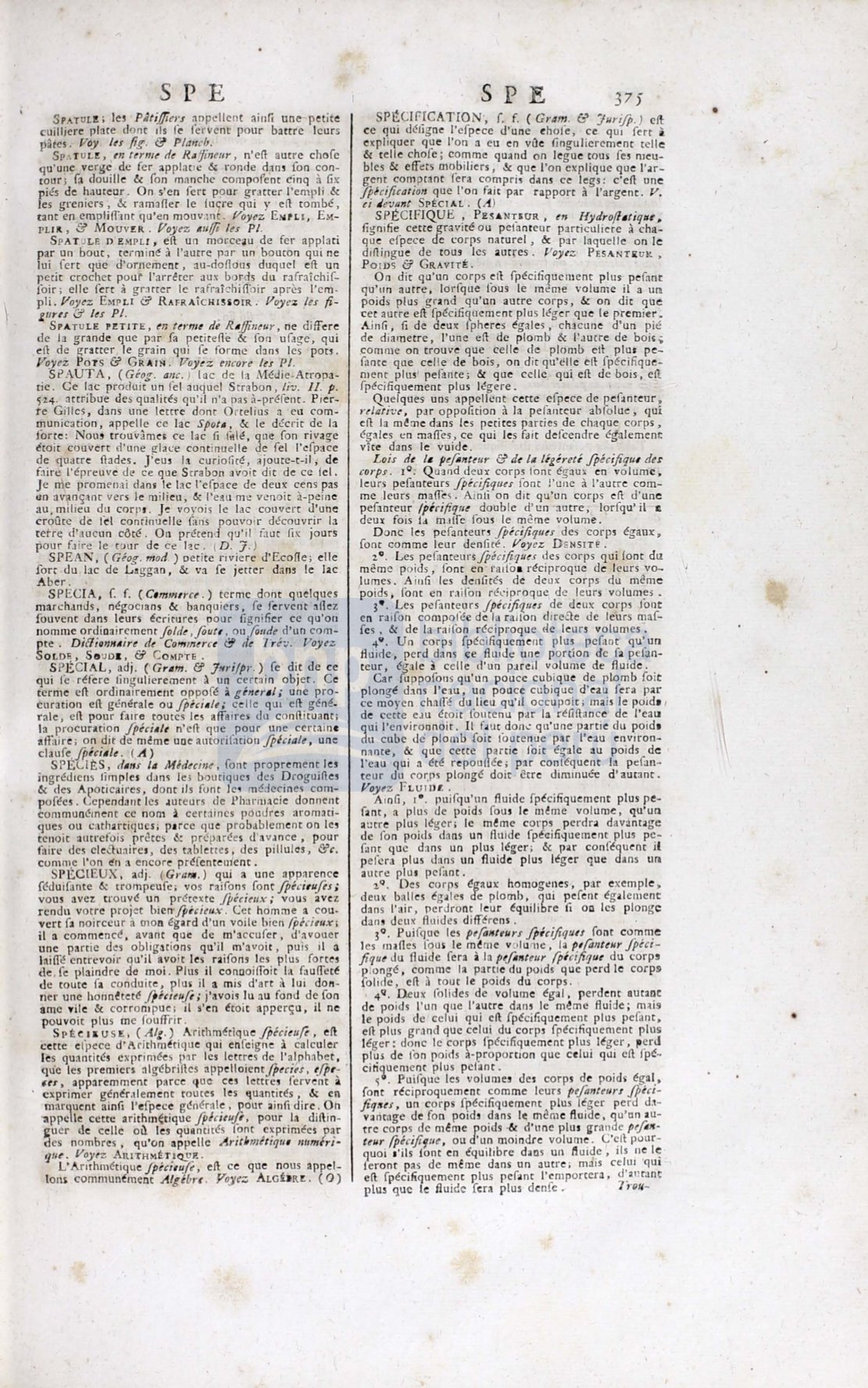
SPE
SPATUL! ; le5
Pitiffie>:f
~~pcllcnt
ainli une petite
cuilljere place done lis {e {ervcnt pour battre lcurs
palés .
Vdy
fu flg.
&
Plancb.
Sv.,
r uu: ,
m tenue de
Ralfineur ,
n'en autre chofe
qu' une verge de fer applane
&
ronde dan5 fo n con–
rour ; fa douille
&
íon manche compofent éinq
3
!ix
piés de haurecr . On s'en (ere pour grarcer l'empli
&
les greniers ,
&
ramafler le fue;re quí y ell combé,
t ant en empl ift1nt qu'en mouv;¡nf.
f/oyez
EJHLJ,
EM–
PLJK ,
&
Mo uv!R .
Voyez
llti!]i
les
·PI.
SPAT ULF.
P EMPLI,
ell un morccau de fer applari
par un bouc, termi né
ii
!'auere: par un boucon qui ne
luí fert que d'omemcnc , au-rloflous duque! ell un
pccit crochet pour
l'arr~ccr
aux bords du rafraichif–
íoir ; elle
(ere
a
grorcer le rafraldii floir aprcs !'cm.
plí.
Voy•z
EMP LI
&
RAFRAiciHHOIR.
f?oye:r;
les
fi–
z ttru
"&
lu
PI.
SPATU LE P!TlTE,
en terme de
R.t~Jfimur,
ne differe
de la grande que
p~r
fa petitefle
&
Con
ufaue, quí
en de g rHter le grain qui
l<!
forme dao5
l e~ pot~ .
Y~yez
Po? S
&
GR A!l<.
Voyez mcore
lu
PI.
S PAVTA ,
(G;og .
onc. )
lac de la Médie-Atropa–
cic . Ce lac produit un fe ! auqucl Strabon ,
liv.
Jl.
p.
514-
attribue des qualités qu'll n'a pas a-préfeor . Prer–
t e
Gillcs , dans une leerre done Ortelius a
ell
com–
'!luoication,
~ppelle
ce lae
Spot11 ,
&
le
décri t de la
Jorre : Nou! trouvamc•
ce
lac fi
litlé , que
Con
rivao-e
éroic couverc d' une ¡rla<:e contínuelle de
(el
l'efpa~e
de quaere fiades . J'eus
la
curiouré, ajoure-r-i l, de
faire l'épreuve de ce que Strabon avoir di t de ce Jel.
] e n\e
prom~nai
daos le lac t"efpace de deux cens pas
un av
n<;~nt
vers le milieu'
&
l'eau me
v~noic
a-peine
au. mll1eu d.u corp1.
J~
voyois le lac couvert J'une
croutc
de
!el cooriouellc C.tns ¡ouvoir découvrir la
teh~
ci'aucun cócé . On précen
qu'il
r~tut
lix jours
pour fJ ire le wur de ce
l~c .
1
D. '].)
SPEAN, (
G;og. mod. )
oetite n vierc d' Ecof!e; elle
forr du be de Laggao,
&
va fe jerrcr dans le lac
Aber.
S PECI A, ( f. (
Ctrnmtrce. )
ter
me
done quelques
marchands' négocraos
&
banquiers' re fcrvcot ,{jez
fouvent dans leurs écritures pour figoi fier ce qu'on
nomme
'?r~ioai r~menc
folde ,foutt
'·
ou }ot~de,d'u n
com–
pre .
Ds{ftoiiHIIIre d
e Commera
C!
rl•
Trev.
Voyez
SoLDE, S&uDJ ,
&
Co.tP'rE .
~ ~ÉCIAL ,
adj .
(' Gr11m.
&
] Hr!fpr . )
fe di.t de ce
qur fe réfere Jingulierement
a
un cercain ob¡et . Ce
terme en ordinairement oppo fé
a
génerlll;
une pro–
turation en géoérale ou
.fp¡állle;
ce!le qut ell géné–
rale, ell pour faire toutes
les
affaire• du conllicuant;
la procuracion
.fphi11lt
n'en que pour une certainc
affaire; o n dit de
m~me
une aucoriliuion
.fplciale,
une
claufe
JPíci11le .
(.A)
SPÉU
ES,
d11ns
14
Médecin~,
fonr proprement le•
lngrédrcns limpies dJns le; boutique• des D roguílle•
&
des Apocicaires, dont ils font le• médecines com–
pofées . Cependant les
~uteurs
de Pharmacie donnent
communément ce nom
a
certaincs póudres aromari–
ques ou catharriques; paree que probablement on le•
tenoit aurrefois preces
6:
préparées d'avance , pour
faire des eleauaire• , des cablettes, des pillule• ,
&c.
comm.e l'on t!n
a
encore pré[entenlent.
SPE.ClEUX, adj.
( Gran~.)
qui a une apparence
féd uifante
6.:
rrompeu(e;
vos
raifons font
.fpé,·i,ufls ;
VOU5 avez n·ouvé un précexce
JPí:cieux;
vous avez
rcndu votre projec bierr
JPhiet=.
Cet homme
a
cou.
verc
(3
noirceur
a
mon égard d'un voile bien
fi>hitux¡
il
a
commencc! , avant que de m'accufer , d'avouer
une parcie des
oblig~rions
qu'il m'avoit , pu is
il
a
laíffé entrevoir qu'í l avoit les raifons les plus for te5
<le, fe plaíndre de
m
oí. Plus il conooiffoit la
fa uffet~
de couce fa co ndu ite, plus il
a
mis d'art
a
lu í do"–
ner une
honn~teté
Jiituufl;
j'avois lu
au
fond de fo n
ame Yile
&
corrompue; il s' en écoir appen¡u,
i1
ne
pouvoit plus me fouffrir .
S PÉCI II: USE,
(Al,:. )
A:rithmétlque.fpéciel!fo, en
c.:ette el.pece d•l'.richmétique qui enfeigne
:l.
calculer
les quantit6 exprimées P-ar les !emes ele l'alphabet,
qu'e les premiers algébrilles
appelloient.fpeci~s ,
tjpt-
·
~tr.
apparemment paree que ce• lercre• fervenr
a
exprimer généralement rouces les ljUantités,
&
en
marquenc ain!i l'efpeee
général~,
pour ainfi dire . Oh
11ppc!le cette
arithm~tique
.fohuuft,
pour la dillio–
¡¡;uer de celle oil les quaotirés font cxprimées oar
d es nombres, qu'cm appelle
.Aritln¡¡/tiqtt•
twrnfri·
que.
Voyn
ARITHMÉTIQ.YI!.
L'Amhmécique
.fpicitu.-r;,
en ce que nous appel–
lon~
communémenc
Algébr~ .
Yoye;:;
ALGbR! .
( O )
S
P E
375
PÉCIHCATIO
·, f. f. (
Gwn.
&
Jso·
i.fp.J
cll:
ce '!oí Mligoe l'efpece d'one
~hofe,
ce qut
(ere
¡¡_
exp!Jquer que
l'on a eu en víle lingul iercment celle
&
celle chofe ¡
com.mequand on leg ue
cou.
fe, meu–
bles
&
effers mo.brilers ,
&
que l'on explique que l'ar–
genr compraoc Jera compri• d•ns ce legs: e'en une
JP.hijicotion
que l'on fait par rapport
1i
l'argent .
V.
ez
tlevrmt
S PÉCIAL .
(A)
SPÉCIFIQUE
?
PEu N~•UR,
en
Hydrofl•tiqsll'
•
figmfie. cene gravité ou petanteur particuliere
a
cha–
que e{ pece de corps naturel ,
&
p1r laquelle on le
difiingue de tou!
les aucres.
Voyt::;
PESANTilUR ,
Poms
&
GRAv!Tt .
On dit qu' un corps
~ll fpécifi~ucment
pl us pef.1nt
qo' uo autre, ldrfque !oug le meme volume
il
a ur1
poids plus grand qu'un auere corps,
&
on dit que
cet autre en (pécifiquement plus léger que le premier .
Ain fi, fi de deux Jpheres
~gale
, ch1cunc d'on pié
de clia•netre, l'une en de plomb
&
l'ducre de
boi• ~
.commc on trouve que celle de plomb
en
plur pe–
fitnte que cell!! de bois ' on die qu'elle en fpécifiqu e–
ment pi u•' pelance;
&
que cellc qui en de bois, cil
fpéciliqu ement plus légere.
Quelques uns appellcnt cette elpece de peflnteur ,
t·e/ariv~,
par o ppofition
a
la pe fanteU·r abfo loe,
<JUi
en
la
m~me
daos fes perites patries de chaque corps'
<5gales en :na!fes, ce qoi les fait defcendre <5¡!alemenr.
vice dans le vuide .
'
Lois de
/11
pefl¡nte11r
&
dt
/4
légéreti
.fphijiqut
du
corps.
1°.
Q uand deux corps fonr
égam
en volumc,
leu rs pefaateurs
.fphijiqtus
font !'une
a
l'aucre com–
mc leurs lr!a,fle<. Atnli oo die qu'un corps ell d' une
pefanceur
/ptNfi'!lle
doublc d' un ·ao tre ,
lorfqu' il
11
deux fois
t~
m.ltre rou5 le
m
eme volume.
Done les pefanteurs
.fpécifiques
des corp• égaux •
fonc comme leur denfité.
f/~ycz DE NSTT~.
2°.
Les pel;t ntenrs.fpéci/iquu des corps qui {ont d\Z
meme poids' loot en· ralloa réciproq ne de leurs vo–
lumes.
A
infi
les denfités de deux corps du meme
poids , íonc en r,1ilon réc·iproque de leurs volumes _
¡•. .Les pefantt:urs
jpécijiq_11er
de cleux corps tont
en rarfon compol ée de la rarlon drreél:e de leurs mar–
fe s ,
&
de la raifon réciproque de leurs volumes.
4"·
Un corps fpéciliquement plus pefaot qu' un
fl uicie , perd dans ee fluid
e:
une por(íon de fa pefan–
teur, t<gale
3
celle cl'un pa reil volume de fluide .
Car fltppofons qu' un pouce cubique de plomb foit
plongé
d~ns
l'eau, un pouce cubique d'eau fera par–
ce moyen chnfle du lieu qu'il occupoir ; mai! le poidt
1
de cctte eJ u éroit touteou par la réfinanco de l'eall
quí l'eovironnoit .
Il
faut don..: qu'uoe parcie du poidt
du cube de plomb foi t toutenue par l' eau enviran–
nance,
&
que cecte parcie Joic égalc au poids de
l'ea\l qui
a
été
r~poufl ée ;
p1r
conlt~q uent
la pefan–
ceur du corps plongé doir erre dimmuée d' autanc .
f/oyez
FLUÚJL .
A in!i ,
1".
puifqu'un fluide (p(cifiquemenr plus pe–
Cane, a plus de poids fou• le
m~me
vol
ume , qu'un
a::cre plus léger ; le
m~me
corps percira davanrage
de ron poids daos un flu íde fpéa iliquement plus pc–
f:tnt que daos un plus léger;
&
par co nféqu enc íl
pefcra plus dans un fiuide plus léger que dans un
auere plu1 pcf.1nt.
2Q.
Des corps égaux homogc:nes, par exemple ,
deux bailes (gales de plomb, qui pefent également
daos l'air , perdront leur équil ibre
li
oa les plongc
daos deux flo ides différens .
3Q·
Puí fqae les
pe{alfteurr .fpícifiquu
font comme
les nnfles lou• le
m~me
v" fume, la
pt{allteur fpfci–
fique
Ju tl uide Cera
a
la
pefinteur
(pícijiqu~
du corp'
plo ngé , comme la partie du poids que perd le corpll
folide '
en
a
tour le poids du corps .
4<1.
D eux
(o
lides de volume éga l, perdenr- autant
de poids !' un que l'aurre dan• le
m~
me fluide ¡
m~is
le poids de celui qui efl: fpécíliqu ement plus pefanc,
efl: plus grand que celui du corps (pécifiquement plus
léger
~done
le corps fpéciñquement plus léger , perd
plus de Ion poicis a-proportion que ctluí qui en Jpé–
ciriquement plus pefan t _
, ~.
Puifquc les vol ume! des corps de poids égal ,
font réciproquement comme leurs
pifanteun JP fci–
fiq"u,
un corps fpéciliquement plus léger perd
d~va órage de fo n poid• daos
1~
mecue tloide, q u'tto au–
tre corps de
m~me¡.oids
·&
d'une plu1
~rande
pefi¡lf–
teur fPüifi'!ue,
ou
'un moindre volume. C'eft pour–
quoi s'ils lont en équilibre daas un l!ui9.e
~
ils ." e
1<:
feront pas de méme daos un aucre ; mars celm ·qu1
efl
fpéciliquemeoc plus pefaoc l'cmporrera , d'aucant
piU! que
le
lluide [era plus denfe .
Tru11-
















