
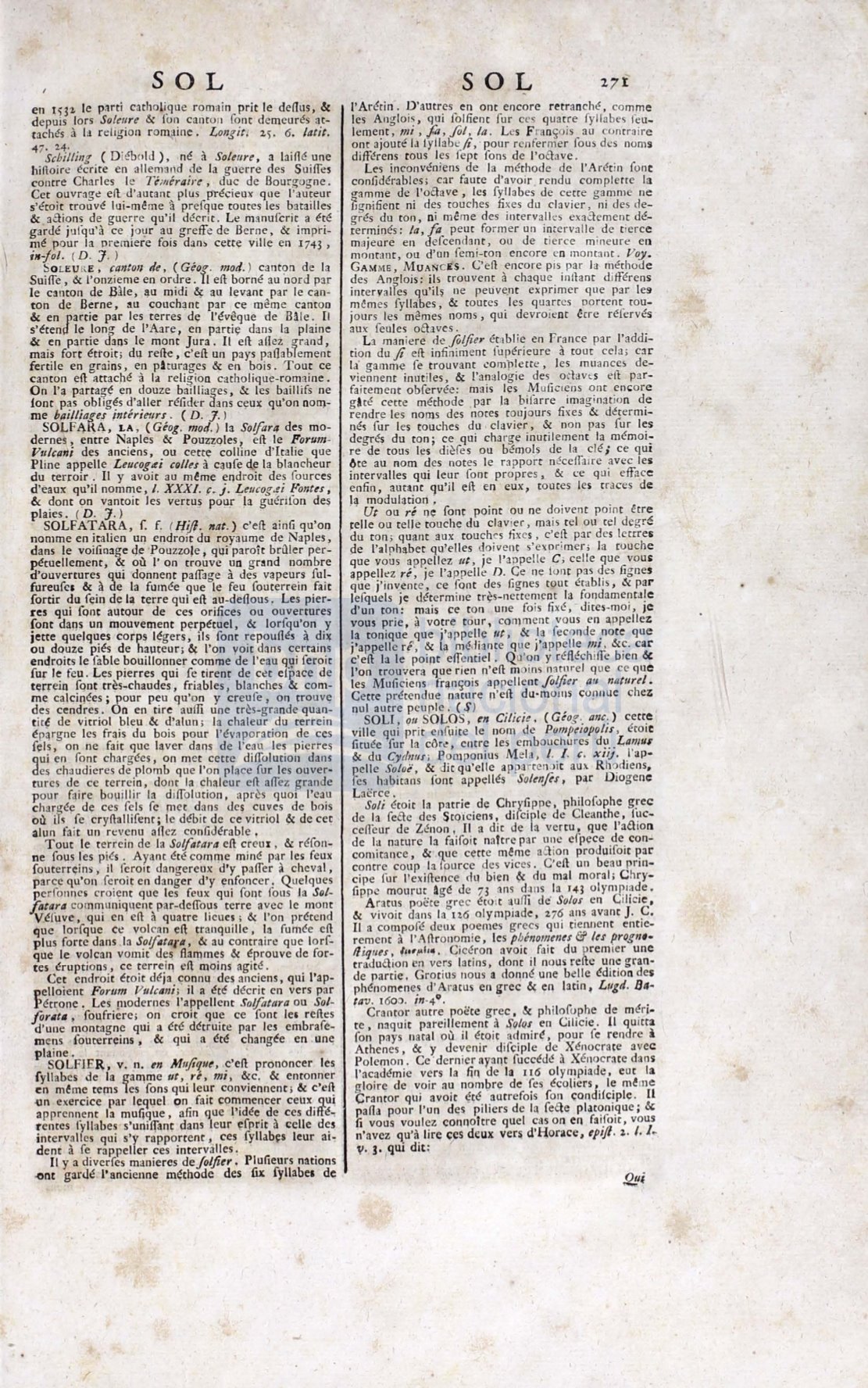
SOL
en
H3'!.
le
p~rti
catholique romain prit le defTus,
&
depUis lors
Sofe11re
& Ion cantou Cont demeurés at–
tachés
a
la rel1gion rolll{l,ine.
Longit¡
2í.
6. latit.
47 .
24:· .
(
D'éb
Id
'
Scbiffmg
1 o
)
, né a
Sofe11re,
a laillé une
hifloire <'crite en allemand de la guerre des Suilfes
contré Charles
le
1~;~,éraire
,
duc de Bour.,.ogne.
Cet ouvrag<! ell d'aurant plus pré¡:ieux que l¡>aureur
s'étoit trouvé lui-méme ·a prelque roures les batailles
&
aélions de guerre qu'il décrit. Le manulcrit a été
gardé julqu'a ce jo\'r au grelfe de Berne,
&
impri–
J}lé pour la nremiere fois dan> cette villc;: en
1743
,
r11-jol. ( D .
J ,
)
~OLEU!\E,
canto11 t/e,
(
Géou.
mod. )
canton de la
Suilfe,
&
l'onzieme en ordre.
ft
efl: borné au 'nord par
le canton de J3!lle,
ljU
midi
~
au levant par le can–
ton de Berne, ;\U couchant par ce meme canton
&
en partie par les terres de 1'\!'veque de Bale.
[l
s'~tend
le
Ion~
de
1'
Aare, en
partí~
dans la plaine
&
en parrie
aans
le mont Jura.
Il
en aUez grand
mai~ for~ étt~it;
dll rene, e•en un pays pa{jablemen't
fernle en groms, en plrurages
&
en bois . Tour ce
canron efl attac)lé
-3
la religion carholique-romaine.
On
1'~ parta~~
en douze ballliages,
&
les baillifs ne
iont pas obllgés d'aller rélider aans ceux qu'on no
m–
me
b(li/fíage¡
intérii!IJrs .
(D.
J.)
· ·
SOLFA~~.
LA , (
Géog. mot{.)
la
Solfora
des mo–
derne~ !
entre
N~
pies & PouzzQies, en le
Forum–
Vt~l&a¡l¡
des anc1ens, ou cette colline d'Italie que
Pline appelle
Leucog,ú cofles
a
c~ufe
de la blancheur
du rerroir .
Il
y avoit au
m~me
e11droit des fou rces
d 'eaux qu'il
nom~e,
/. XXXI. .
&- }.
~eucog.ú
lj'ontu,
&
~ont
on vantolt les
vercu~
po!l.r Ja guéri!on
de~
pla1es.
( D .
J.)
SOLFA'~A~A,
f.
f.
( ffifi. 11at.)
c'en ainli qu'on
nomme en 1tahen ur¡ er¡droir du royaume de Naples,
dans le voilinage <)¡e )'ouzwJe
1
qlli paroit brOier per–
p<'cuellement,
~
ou
1'
on trouve un g rsnd nombre
d'ouvertures qui donneiJt palfage a Jes vapeurs l'ul–
fure.ufcs &
.~
de la fumée que le feu [outerrein fait
forttr du fem de
1~
terre qul efl: au-deílous . Les pier–
res qui fonr autour de ces orífices ou ouvertures
font
d~!!S
UIJ
rr¡ouve~¡~ent p~rP.étllel,
&
lorfqu'on y
Jette
guelq~es
corps légers, 1ls fonr repoullés
~
dilf
o
u douze p1és de haureur; & l'on yoit dans cerrains
en~rqits
le fable bouillonner comme de l'eau qui ferpit
fur
l~
feu . Les pierres qui fe
tiren~
de cct e[pace de
t~rrem
fqnt tres-chaudes, friables, blanches & com–
me calc;ir¡ées; -pour peu qu'on y creufe
1
on rrouve
d.escend~es
.. On en tire auffi une tres-g rande quan:
tlt~
de Vltnol bleu
&
d'alun ; la chaleur du cerrein
ép~rgne
les frais du bois pour
l'év~poration
de ces
f~ls,
on ne fa ir que laver dans de l'eau
les
pi
erre~
qui en font chargées , on mee cecee dilfolution dans
d es cl¡audieres de plomb que l'on place fur les ouver–
tures
d~
ce terrein, done la
c~aleur
efl: a!fez grande
pour fa1re bo11llhr la d11foluuon, apres quoi !'eau
ch~rgé~
de ces fels fe ¡net dans
de~
cuves de br>is
ou
ils fe crynallifenr; le débit de ce vitrio! & de cet
alun fait un revenu allez con!idérable,
·
Tour le terrein de la
So!{ata1·a
efl: creux , & réfon–
ne fm.¡s les pi<'s . Ayanr écé cqrr¡rne miné
p~r
les feux
fouterr~ins,
il
feroit dangereux d'y palfer
a
cheval,
paree qu'on feroit en danger d'y
~nfoncer.
Que!ques
perfonnes croienr que les feux qui font fous la
Sol–
fatara
co111muniqqenr
p~r-<leO'ous
rerre 'avec le mont
Véluve, qui en .en
a
quatre licues; & l'on prérend
que lor[que
Ce
volean elt tranquille, la fumée en
plus force dans .la
So!fata¡il,
& au concr:¡ire que lorf–
que le vol,an vomit des lla1]1mes
~
éprouve ele for–
tes éruptioqs, ce terreilJ en moins agité.
Cet endroit
~toir
déja
~onm¡
des anciens, qui l'ap–
pelloienr
Forum
Vulcani;
il
a été décrit en vers par
Pétron~
, Les [nodernes l'appellenr
Solfat11ra
ou
So/–
forlltll ,
foufriere; on croir que ce font le1 refles
d'une montagne qui
a
été Mtruite par
les
embrafe–
mens
foucerr~ins
,
&
qui a été
chang~e
en .une
plaine.
·
'
·
SOLFlER, v. n.
m Mt!fique ,
c'efl: prononcer les
fyllabes
de
la ga111me
ut,
rf,
mi,
&c. & enronner
en m!me te{IIs les
[ons
qui leur conviennent ;
&
e'en
t~n
exercice par
le~uel
on fait commencer cel!x gui
apprennent la muljqÜe, afin que !'idée de ces
diHe~
temes fyllabes s'unilfanc dans leur ¡;fprit
a
celle
des
intervalles qui s'y rapporcent,
ce~ fyllab~s
leur ai,
dene a fe rappeller ces intervalles '
.
ll y a diverfes manieres
defolfitr.
Plu!ieurs nations
~nt
gar<lé 1'ancienne
m~thode
des
fix
fyllabea de
SOL
l'Arérin. D'autres en onr encore retranché comme
les
Angloi~ ,
qui follienr fur
ces
quaere
fyll~bes
feu–
lement ,
tm
,
fo,
fil,
la .
Les
Fran~ois
au
onrraire
om ajouté fa fyflab e
/i,
·
pour rcnfermer fous des noms
dilférens tous les fept fons de l'oélave .
Les
inconvéniens de la méchode de
1'
Arétin font
cr>nlidérables; car faure d'avoir . rendu complerre la
gam.mede .l'oélave , les fyllabes de cecee ga mme ne
ligmlienr
n1
eles rouches fixes du clavier
ni de de–
grés du ton, ni meme des inrervalks exatlement dé–
rerminés:
la, fa
peut former un interva lle de rierce
majeure en defcendant, ou J e cierce mineure ert
monrant
, ou d'on femi-ron encore en montant.
Voy.
GAMME,
MuANC.iS. C'etl encore pis par la mérhode
des
An~lois:
ilstro
uvenr a chaque inllant ditférens
intervalles qu'il$ ne peuve.nr exprimer que par le9
m~mes
fyllabes, & toures
lesquarrcs norrcnt rou–
jours les memes noms, qui devroienr érre ré[ervés
aux [eules oélaves.
La maniere
<le
filfier
établie en France par l'addi–
tion du
ji
en infiniment Cupérieure
a
roue cela; car
la· gamme le trouvanr
~omplette ,
les muances de–
viennenr inutiles,
6>
l'an~logie
des ot1avts en par–
faitement obfervée: mais
les Muficrens ont encore
glté cecee mérhode par la bifarre
imaginarían de
rendre les noms des notes roujours fixes & dérermi–
nés [ur les rouches du . clavier,
&
non pas (ur les
degrés du ton; ce qui cha rge inutilemem la mémoi–
re <!e tous
l~s
diefes ou bénwls de la cié; ce qui
óre au nom d es notes le rapporr nécelfarre avec les
imervalles qui leur font propres , & ce qui elface
en/in, aucanr qu'il
~lt
en eux, coutes )es traces de
J~
modulation ,
Ut
ou
r;
r)~ Ion~
point ou ne doivent point étre
~elle
o u telle rouche du clav1er, rnais rel ou rel
degn~
du ton; quant aux touchcs lixcs , c'elt par des lerrre5
de l'a lphaber ql!'elles doiven¡ s'expr; mer; la rouche
que vous appcllez
at,
je
l'appclle
C;
celle que vou'
app~!l~z
rf,
je
1'~
pell e
n.
Ce ne Iom pas
~es
lignes
que ¡'invente, ce font des lignes tour écablrs,
&
par–
Jefquels je
M~ermine tr~s-nerre~1eot 1~
for)damenta!e
d'un ton: ma1s ce ton une fo1s ljxé, - Jites-mor,
¡e
vous prie,
~
votre tour , con¡ment vous en :¡,ppellez;
la tOIJique que
j'~ppelle
ttt,
& la fecr>11de 110te que
j'appelle
rt,
&
la
médian~e
que j'appelle
mi ,
&c. car
c•en la le poinr elfenciel. Q u'on y réf!échtlfe bien
&
l'on rrouvera que ríen n'efl: m ins narnrel q ue ce que
les Muliciens
fr~n'iois
appellent
.folficr.
{ltl
nnturel.
Cerce prétendue natur<;: p'elt du·tllOIIIS
~OflllUe
chez;
nul auere peuple . (
.SJ
SOLI ,
or1
SOLOS,
tn
Ciliáe,
(
G;ou.
an&. )
cetre
vil!e qui prit enf11ite le non1 de
P~mpeiopolis ,
éroie
!ituée fur la c3re, entre les embouchures du
L!1111U~
!5r
du
Cydmm
P omponius Niela ,
l.
/ .
c. xiij.
l'ap–
pelle
Soloii,
& diequ'elle apparrenJit aux R h cliens,
res habitans
Con~
app<;llés
Solenft<,
p~r
Diogene
Laerce.
·
Soli
étoit la patrie
d~
Chrylippe, philof<>phe g!ec
de la
[eéle
des Sto'iciem, difciple de Cleanthe, Juc–
celfeur de
Z~non
,
Il
a
die de la vertu, que l'aélion
de la
na
ture la faifoit naftre par une efpece de con–
comirance,
&
que cecte mc!me
a
ion produi[oit par
contre conp la fpurce des vices. C'ell un beau prín–
cipe lur l'exi¡lence dq bien
!5r
du mal moral; Chry–
!ippe mourur 1gé de
73
ans dans la
143
olyml'ia~e.
Aratus poece grec éro•t auffi dé
Solos
en Crlic1e •
& vivoit dans la.
n6
olympiade,
276
ans a
van~
J.
C.
Il
a compofé deux poemes grecs qui tiennent entie–
rement
a
1' A
flronom ie, les
pbénomenes
&
lu
prQglll•
!liques,
fwpl•~.
Cicéron avoit fa ir du prem ier une
rraduélion en vers latins, done il nous rene une gran–
de par'cie, Grotius nous a donné une belle édition des
phénomenes d' Ararus en grec & en latín.
L¡1gd. Btf-
(av.
I 60:J.
in·4".
·
.
Crantor autre poete grec,
&
philofo phe de mérj,.
te, naquit pareillement
a
.Solqs
en Cilicie .
ll
quirta
fon pays nacal ou il .Stqir admiré, P.our fe rendre
a
Athenes,
&
y deve11ir <lifciple de
Xénoc;ra~e
avec
Polemon . Ce ·dernier aya11t [uccédé
a
Xénocrace dans
l'académie vers la
li11 de la 116 olympiade, eot la
g loire de voir
a
u nomgre de fes écoliers , le
me!
¡e
Cranror qui avoit
~té
aurrefois fon
~011dilciple .
Il
palla pour !'un
de~
piliers de la feéte
pl~tonique;
&
fi
vou~
voulez c011110lrre que! cas on en faifoic, vous
ñ'avez q_u'a.lire
~s
deux
ver~
d'florace,
epijl.
~. 1.1~
V· 3.
1
qu1 d1t:
011i
-
















