
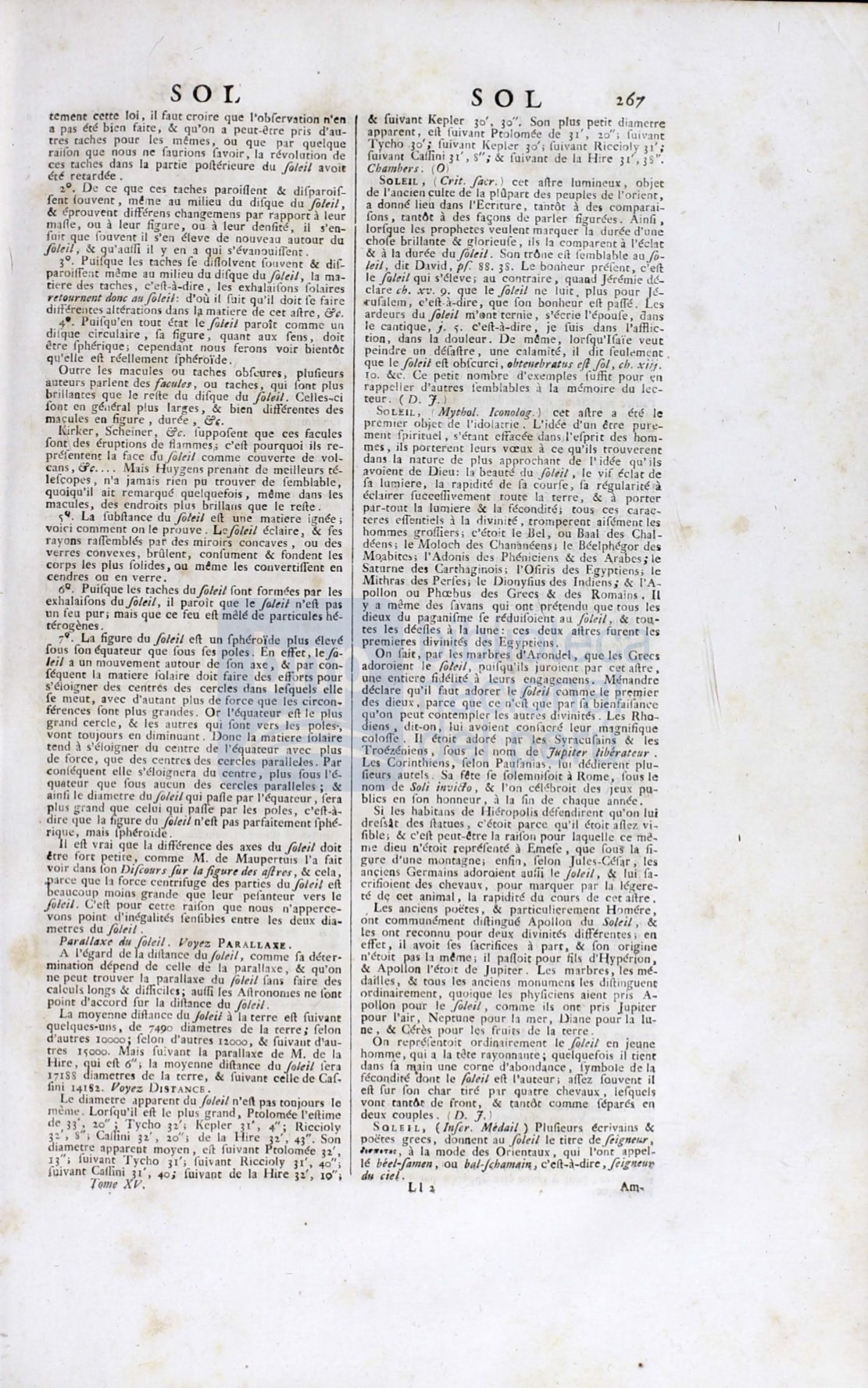
sor;
tement cctte !ol, il faut croire que
l'obíerv~rion
n'en
a pas été bien faite, & qu'on a peur-erre pris d'au–
rres raches pour les
m~mes,
ou que par quelque
raiíon que nous ne íaunons íavoir, la révolocion de
ces tJches dans la partie potlérieure du
foltil
avoir
éré rerardée .
:~.
0
•
De ce que ces taches paroil!ent & diíparoií–
fenc louvent,
m~me
au milieu du difque el u
.fol•il,
&
~prouvent
différens changemens par rapporr
i\
leur
marTe,
OU
a
leur figure,
OU
ii leur denfité,
iJ
s'en–
fuit que fouvenr il s'en éleve de nouveau aurour du
foltil,
&
gu'aufli il y en a qui s'évanouifrenr.
3°.
Puifque le
taches fe dirTo!venc fouvenc & dif–
paroifrent
m~me
au milieu du diíque du
fl!til,
la ma–
ciere des taches, c'efl-ii-clire, les exhalai[ons Colaires
ntormunt tÚmc aufoleiJ :
d'ou il (\lit qu'il doi t re fairc
ditfi!renres altérations dans
1~
mariere de cet aflrc,
&c.
.
:~•.
Pu.ifqu'en tour érat le
fo!til
paro!e commc un
ddquc c¡rcula1re , fa figure, quant aux íens, doir
erre fphérique; cependant nous ferons voir bienr6t
q u'elle en
r~ell ement
fphéroYde.
Ourre les macules ou taches
obí~-..1re5,
plufieurs
aureurs parlem des
[acule~,
ou raches, qui font plus
brillantes que le rene du difque du
foleil .
Celles-ci
fo nt en général p!us
lar~es '
& bien uifférentes des
ma~ules
en figure , durée ,
&,.
1
·rker, Sclieiner,
&c.
luppofent que ces facQles
font ,des éruprions de flammes,; c'en pourquoi ils re–
préfenrenr la face
áufolú/
camme couverre de vol–
caos,
&c....
Mais Huygens pren.tnt de meilleurs ré–
!efcopes, n'a jamais rien po trouver de femblab le,
quoiqu'il ait
remarqu~
quelquefois , meme daos les
macules, des endroits plus brillaus que le rene .
s'l. La fubnance du
fole-il
etl une mariere ignée;
voici comment on le prouve.
L efoleil
éclaire ,
&
fes
rayons ralfemblés par des miroirs concave
, ou des
verres convexes , brulent , confument
&
fondenc les
corps les plus íolides , au meme les couverriífem en
cendres ou en verre .
6° .
Puiíque les raches du
fo!eit
íont formées par les
exhalaifons du
foleil,
il paro'lt que le
joJeil
n'eft pas
un feu pur; mais c¡ue ce feu etl melé de particules hé–
térogenes .
7~.
La figure du
foltil
en un fphéro'(de plus élevé
fo us fon équareur que fous fes poles . En effet, le
jo–
¡,¡¡
a un mouvemenc aurour de íon axe, & par con–
féqu ent
la
matiere íalaire doit faire ues efforrs pour
s'éloigner des centros des cercles daos !eíquels elle
fe meur, avec d'autant plus de force que les circon–
férences íont plus grandes .
O r
l'équateur en le plus
grJnd
ce~clc,
&
les aurres qui íont vers les poies·,
vonr rou¡ours en uiminuanr. Done la matiere Colaire
tend
~
s'éloigner du centre
de
l'équareur avec plus
de force, que des centres des ccrcles paralleJes. Par
conféquenr elle s'éloignera du centre, plus fous l'é–
quareur que fous aucun des cercles paralleles ;
&
ainfi le diametre
dufoleil
qui palie par l'équareur , fera
p lus grand que celui qui pafre par les poles, e'en-a–
dire que la
fi~ure
du
foleil
o'efi pas parfaitement fphé–
rique, mais {phéro·ide .
JI
en vrai que la différence des axes du
fole-il
doit
l rr-e fort perite, comme M . de Mauperruis l'a fait
voir daos lo o
Difcoursfor lajigr;uder ajfres,
& cela,
.paree que l:t force cenrrifuge des parties
dufo!eit
en
bc:mcoup moins grande que leur pe(1nteur vers le
folerl.
C•en pour cette raiíon que nous n'apperce–
vans point d'inégalir-és fenlib!es enere les deux dia–
rn etres du
fo!til.
Para/laxe titl /Oieil. Voyn
PARALLAU.
A l'égard de fa dinance du
joltil,
comme ía dérer–
rninacion dépend de celle de la para!laxe, & qu'on
ne peut crou"er la para!laxe du
{oleil
fans
faire des
calcu ls longs
&
difficilcs; auffi les Anronomes ne font
poinr d'accord fur la dinance du
foleil.
La moyenne dinance du
joleil
a
la terre en fuivant
quelques-uns, de
7490
diametres de la rerre ; íelon
d'aurres
Ioooo ;
felon d'aurres
11.000,
&
fuivaur d'au–
tres
I
sooo. Mais ru:vam la parallaxe de M. de la
Hire, qui en
6";
la moyenne dinance du
joleil
(era
17188
diametres de la terre,
&
íuivan~
celle de Caf–
fini
141S2.
floyez
DJST
A CE.
Le diametre dpparent du
joleil
n'el\ pas ronjours le
rnem~.
Loríqu'il en le plus grand, Prolornée l'etlimc
de 33',
1.0"
;
Tycho
p';
({cpler
¡t',
4";
Riccioly
p',
S"; Catlini
p ',
20";
de la 1-lire
p',
43". Son
diametrc apparent moycn, en fuivanr
Prolom~e
32',
IJ";
fuivonr Tycho
p ';
íui ant Riecioly
¡I',
4o";
fuivant Catlini 31', -.o; fuivapt de la Hire 31.', ro";
Tqu~e
XV.
SOL
& fuivant Kep!er
30', 3o".
on plus petit diamerre
apparent ' en íuivanr Ptolomée de
¡t''
to"; ÍUt\'anr
Tycho
30';
íuiv:tnr Kepl<!r ¡o'; íuivanr Hiccioly 31' ;
futvam Ca(Jini
¡r',
S";
&
[uivant de la H ire
31' ,
¡ S''.
Cbambtrs .
¡0 )
So LEIL , (
C.•it. focr.)
cet anre lumineux , objet
de l'ancien culee de la piQpart des peuples de l'orienr,
a donné lieu daos I'Ecrirure, ra·nrilr a de¡ t·omparai–
fons, ranr6t
i\
des
fa~ons
di! parler figurc.'cs. Ain li ,
lorfque les prophetcs veu lent marquer la durée d'une
chofe brillante
&
glorieuíe, tls
la
comparenr
it
l'éclat
&
i\
la durée
dufoleil.
Son rr6 ne en ícmblal>le aufi–
leil,
dir D.tvid,
p(
88. 3S.
Le bonheur préíenr, c'etl
le
fo!eil
qui s'éleve; au conrraire, quand Jérémie
M–
elare
ch.
xv.
9·
que le
foltil
ne luir. plus pour
¿é–
•·uíalem' (''en.a-dire, que fon bonheur en paífé .
es
ardeurs du
foleil
m'ttnr rernic, s'écrie l'époufe, dans
le cantique,
j.
\'.
c•en-ii-dire, je íuis dans
l'affiic–
tion , dans la douleur . De mOme,
lorfqu'l[u'ie veut
peindre un défanre, une calamité, il dit feu(.,ment .
qne le
folúl
en ohfcurci,
obterubratru efl.fo.t, cb.
xi~¡.
to. &c. Ce petiQ nombre d'ex.:mples fuffic pour
~n
rappcller d'aurres lemblable5
a
la mémoire du lcc–
reur . (
D.
J.)
SoLt: IL,
r
Mytbo/. Ico11olog.)
Cl!t atlre a éré le
prcmtcr objer de l'idolarrie. L'idée d'un erre purc–
menr fpirituel, s'éranr cftaeée d<tns l'eíprit des hom–
mes , ils porrerent leurs vceux ii ce qu'ils rrouverent
dans la nature de plus
a¡~>rochant
de 1'
id~e
qu' ils
avoient de D ieu: la
beaur~
du
foltil,
le vif éclat de
fa lumiere '
la rapidiré de fa couríe' la ré!{ulariré
a
écl:tirer fueceflivemen t roure la' rerre,
&
a porter
par-tour la lumiere
&
la fo!condiro!;
rous ces carac–
teres efremiels
:l
la cliviniré, rromperem aiíémcnr les
hommes grofliers; c'éroic le .llel , ou fiaal des Chal–
déens; le Nroloch des Cilanúnéeos¡ le fiéel phégor des
MQabitC>;
1'
Adonis des Phéniciens
&
des l\rabcs ; le
Samrne des Carrh1ginois; I' Ofiris des Egypriens; le
Mirhras des
P~rfes;
lt! Dionylius des Indiens ;
&
l'A–
pollon ou Phcebus des Grecs
&
des Romains .
Il
y
a meme des favans qui
Ont 1
prétendu que toUS les
dieux du paganiíme fe rc!duifoie'hr
a
u
foleil,
&
tou,–
tes les déerTes ii la !une: ces deux al\res furent les
premieres divinirés des Egypriens.
On fait, par les marbres d'Arondel, que les Grecs
adoroienr le
/O!eil ,
puifqu'ils juroicnc par cet anrc,
une cmiere fidél ité
a
leurs cngagcmens. Ménandre
déclare qu'i l f:tut adorer le
folei{
camme le
pr~mier
des dieux, paree que ce n'ct1 que par fa bienfaifim,·e
qu'on pcut contempler les aurres divinités. Les Rha–
diens , dir-on, lui avoient conlacré leur magnifique
colofre .
Il
étoic adoré par les Syracuíains
&
les
Troézéniens, íous
le nom de
]Hp.ittr libératttJr
.
Les Corinthiens, felon Paufimias, lut dédierem pi
u~
lieurs autels . Sa
f~te
fe fo lemnifoit
a
Rome, íons le
nom de
Soli itJviflo,
& l'on célébroir des
jeux pu–
b
líes en Ion honneu r,
il
la fin de rhaquc année.
Si les habitan
de 1-Iiéropolis défeodiren t qu'on lui
drcfdt des narues, c'étoir paree qu'il éroir aflez vi–
fible; & e'en
pem-~tre
la raiíon pour !aquelle ce me–
me dieu n'éroit re¡.¡réfenré
a
Emefe , que fou
la fi–
gQre u'une monragne; enfin, felon
Jules-Céí~r ,
les
ancicns Germains adoroienc aufii le
joleil,
& lui fa–
crifioient J es
chevau~ ,
pour marquer par
1:1
légere–
té
d~
cet animal, la rapidi té du cnurs de cer anre.
Les anciens puetes, & partieulieremenr Homére,
Ónt
communément diningué Apo llon du
Sot.il,
&,
les ont reconnu pour deux divinirés difFé
rences; en
effet' il
~voit
fes
íacrifices
a
pare'
&
íon ori¡:ine
n'étoit pas la
m~me;
il pafioir pour fils d'flypér¡on,
& Apollon l'étoit de J upiter . Les marbres, les mé–
dailles,
&
rous les anciens monumcm les dininguenc
ordinairement, quoique les phyficiens aient pris
-
pollon pour le
fite-il,
comme ils onr pris J upiter
pour l'air,
eprune pour la mer, Uiane pour 13 lu–
oe, & Céres ¡>our l<ls frnits de la rerre.
O n
r~préfentoit
ordinaircment le
fi!til
en jeune
hornme, qui a la
t~te
rayonnante ; quclquefois
il
ticnt
daos ía main une eoroe
d'abond~nee,
íymbole de
1~
féCO tldiré i:font le
(oJeit
en l'auteur; a{fez fauvent
i!
en íur íon char tiré p1r quarre chevaux ' leíquels
vont tanróc de front,
&
(anrc3r comme féparés. en
deux couples .
1
D. ] ,
)
S o LE 1L, (
lnfor . M,Mail
)
Pl ufieurs écrivains
&
poete grecs, donnent au
foleil
le tirre de
j8r'~ntu.r,
'"'"", a
la mode des
Orienraux, qui
l'ont
~ppel!é
bétl-fomm,,
o u
bt~lj&
.ba.ml!ifl,
c'en-a.-dire
,fil.fiJttll}c
J¡¡
citl .
Ll
~
f>II1,
















