
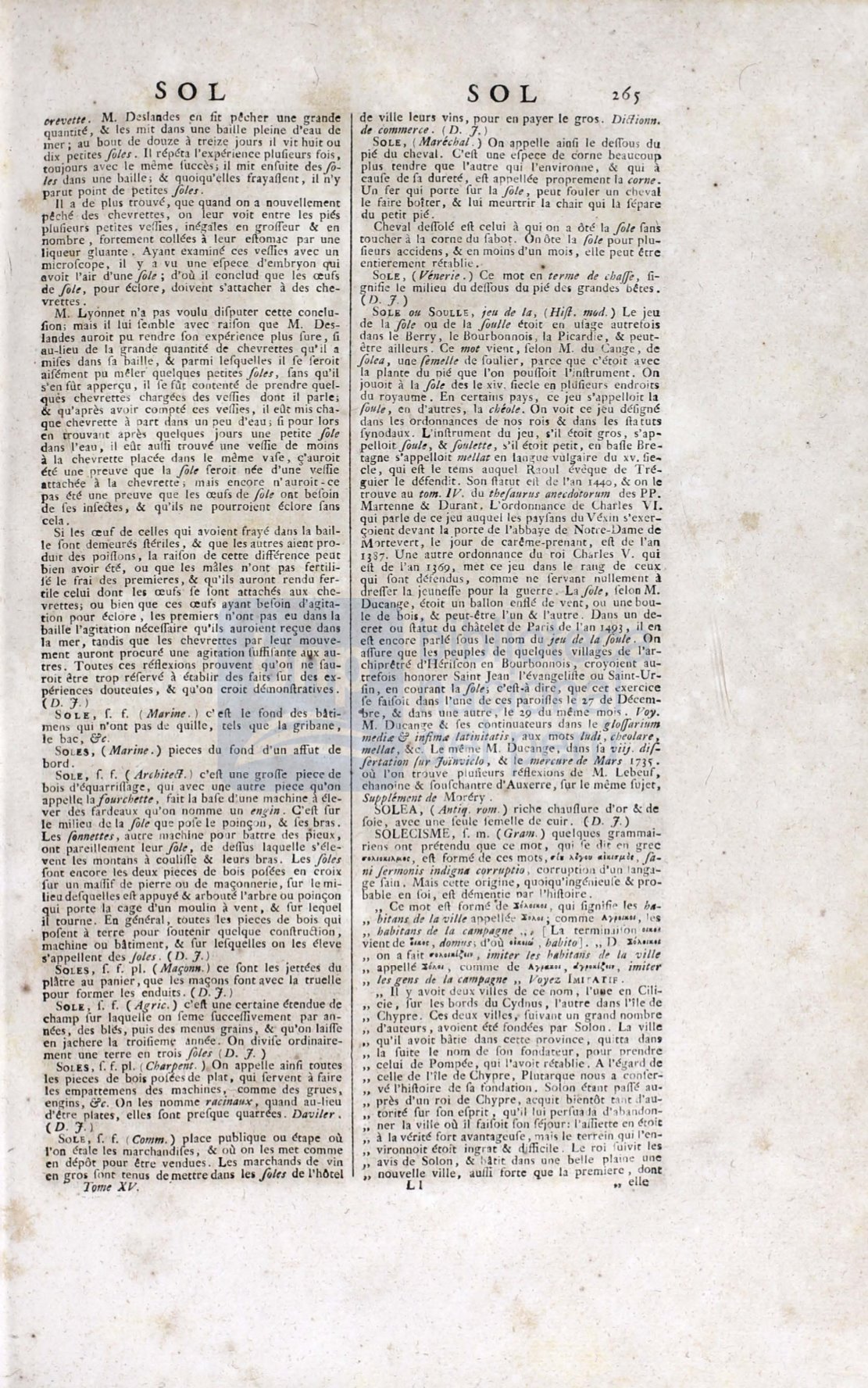
SOL
onwttt.
M.
Dcs~andes
!!rt
fit
.r~cher .
une grande
quanrité ,
&
les m1t daos une ba!lle pleme d'eau de
mer · au bout de douze
a
treize jours il vit huir ou
dix petites
folu.
11 répét.a l'exp¿rience pluúeu
rs fois ,coojours avec le meme (ucces ; il mir enCuite des.fo–
/u
dans une baille ;
&
quoiqu'elles frayaf!ent, il n'y
paruc point de petires
fo!u .
11
a
de plus rrouvé , que quand on a nouvellemenr
p~ché
des chevrerres , o n
leur voit entre les piés
plutieurs perites veffies , inégáles en groffeur
&
en
nombre , forrement collées
a
leur enomac par une
tiqueur gluante. Ayant examiné ces vef!ics avec un
microfcope ,
il y
a
vu une efpece d'embryon qui
a voir l'air d'unefo/e ; d"ou
il
conclud que les ceu fs
de
foü '
pour éclore' doivent s'arracher
a
des che–
vretres.
M . Lyonnet n'a pas voulu difputer cette conclu–
tion ; mais il lui f'emble avec raifon que M . Des–
landes auroit pu rendre
Con
ex périence plus fure,
G
au-lieu de
13
grande quanrité de chevrenes qu' il
a
. mifes dans fa n aille'
&
parmi lefq uel les il fe feroit
aifémenr pu méter' quelques perites
fi /u ,
fans qu'il
s'en fílc apper<,¡u , il fe
fU¡
contenté de prendre quel–
ques chevrerres chargécs des veffies done
il parle;
&
qu'apres avoir comp ré ces venies , il
eOt
mis cha–
qoe chevrerre
a
part <fans un peu d'ea u ; ti pour lors
en rrouvant aprb
quelques
¡ours une perite
file
daos l'eau, il e(lr aufTi
crou v~
nne veffie de moins
a
la chevrette placée dans
le meme V.tfe, <,¡'auroit
écé une ,preuve que la
file
feroit
n~e
d'une " eme
acrachée
a
la
chevrect~ ;
mais encqre n' auroir-ce
pas été une preuve que les oeufs de
file
onc be(oin
de (es infeéles,
&
qu'ils ne pourroicij t éclore fans
cela.
Si les ceuf de celles qui avoient rrayé daos la bail–
le foot dem·eurés llériles ,
&
que les autres aienc pro–
dUJt des poillons , la rai[oo de cette dilférence pcur
bien avoir été , ou que
les
m31es
n'on~
pas fertili–
Jt!
le frai des premieres,
&
qu'ils auront rendu fer–
tile celui dont le' oeufs fe lont acrachés aux che–
vrettes; ou bien que ces ceufs ayant befoio d'agita–
tion pour éclore , les premiers n'onr pas eu daos la
bailfe l'agitation néceffaire qu'ils auroient re<,¡ue dans
la mer, tandis que les chevrertes par leur mouve–
ment auront procuré une agiration ('uffi f'a nre a11x au–
tres . Touces
ces
réflexions prouvenr qu'on ne fau–
roir erre tra p réfervé
a
écablir des fairs fur des ex–
périences doureu(es ,
&
qu'on croit démonnrarives .
(D .
J. )
S o L
1! •
r.
f.
(
MarÍIJe .
)
e'
en le food des bhi–
mens qui n'ont pas
d~
quille, tels 4ue
la gribane,
le bac,
&c.
So LU, (
Mari11e. )
pieces du fond d' un alfut de
b ord .
SoLE, f. f. (
Arcbitefl.)
e•
en une gro (fe piece de
b ois d'<!quarriflage , q ui avec une aurre piece qu'on
appelle, lafoul·clutte .
fa it la bafe d' une machine
a
éle–
ver des fardeaux q u'on nomme un
eng ín .
e·
en fur
te mi lieu de la
file
qu e pofe le poin<;on,
&
fes bras.
Les
(onnettu,
aurre ma chlne pour barrre des picux,
ont pareillement leur
file,
de deflus laquelle s'éle–
vent les montans
a
coulille
&
leurs bras. Les
files
fonr encare les deux pieces de bois pofées en croix
fur un maffif de pierre ou de ma<,¡o nnerie , fur le mi–
lieudefquelles en appuyé
&
arbomé l'arbre ou poin<;on
qui porte la cage d'un moulin
ii
vent,
&
fur lequel
il
rourne . En général, toutes le• pieces de bois qui
pofent
a
tcrre pour foutenir quelque coníl.ruélion'
mat:hine ou biltiment ,
&
fue lefquelles on les éleve
s'appellent des
j o/es .
(D.
J.)
SoLES,
r.
f.
pi. (
Mayon11. )
ce font les jecrées du
pl~tre
au panier, que les ma<,¡ons font :¡vec la rruelle
pour forrner les enduics .
(D.
J.)
So
u: ,
f. f.
(Ag ríe. )
c'e~
une certaine écendue de
champ fur laquelfe on feme fucceffi vement par an–
nées, des blés, puis des menus grains,
&
qu'on lai(fe
en jachere la
troifiem\'
~ nnée .
On divife ordinaire–
rnent une terre en erais
files
( D.
J.
)
SoLES. f. f. pi. (
Cbarperzt. )
On appelle ainti toutes
les pieces de bois pofées de piar. qui rervent
a
faire
les empattemens des
machines~
comme des grues,
engins ,
&c.
On les nomme
ractnat<x
1
quand au-lieu
d'~cre
piares, elles font prefque quarrées.
Davíler .
(D .
J. )
So LE,
r.
f. (
Comm. )
place publique ou étape ou
l'on érale les marchandifes,
&
ou on les mee comme
en dépot pour
~ere
vendues. Les marchands de vio
en gros
lime
tenus de mettre dam; les
fote.r
de !'hOtel
Tome X V.
·
SOL
de ville leurs vins, pour en payer le g ros .
Dítlionn.
tlr c'ommerce . ( D. J .
)
SoLE, (
Marhbal . )
On appelle ainti le detrous du
pié du cheval . C'eíl. une efpece de éorne beaucoup
plus cendre que l'autre qui l'environne.
&
qui
a
caufe de fa dureté, ell appellée propremenr la
cornr .
Un fer qu i porte fur la
file ,
peur fo ul er un cheval
le faire boirer,
&
luí meurrrir la
e
hair qui la fépare
rlu petit pié.
.
Cheval deffolé en celui
a
qui on a oré la
file
fank
toucher
a
la
corne du f:tbot .
On
ilre !2
(ole
pour pl u–
tieu rs accidens,
&
en moins d' un mois,
d ie
peut érre
encieremcnr récabl ie .
•
SoL!! , (
Vé11eríe .)
Ce mot en
teYJne de <baffi,
ti–
g nifie le milieu du dellous du pié de' grandes béces.
(D.
J . )
So,L¡¡
ote
SouLL E,
im
de la, ( Híft . m&d.)
Le jeu
de la
file
ou de la
jiJII/Ie
éroit en
ufa~e
aucrefo is
dans le Berry, le Bourbon noi' , la Pica raie ,
&
peor–
erre ailleurs . Ce
111ot
viene, felon M . du Ca nge , de
fitea,
uoe
{eme/le
ele fou lier, p:trce que c'étoi r avec
!a planee du pié que l'on pouffoit
l'ínflrumenc. On
JOUOit
a
la
file
des le xiv. tiecle en pl lltieurs endroirs
du royaume. En cerrains pays , ce jeu s'dppel loir la
{o111e ,
en d'autres , la
cbfole.
On voít ce jéu défi gné
daos les ordonnances de nos roi•
&
dans les lla ruts
fynodau x. L'innrumenc du jeu, s'il étoit gros , s'ap•
pelloitfollle, &_{o11lette,
s' il éroit perir, en ba íle Bre–
tagne s'appelloir
mellat
en
lan~uu
vu l¡;airc du xv. {ie.
ele, qui en le cems auquel R1ou l evcque de T ré–
guier le défenrlit . Son ílarur ell ele l'an
1440 ,
&
on le
rrouvc au
tom. IV .
du
tbifnurus rmudotortmJ
des PP.
M arrenne
&
D uran
e.
L' ordonnancc de Charles
V l.
qui parle de ce jcu auq uel les p3yf.1 ns du Vé.xin s'excr–
<,¡oient devane la porte de l'abbaye de Notre-Dame de
M 'lrtevert, le
jour de ca réme-prenant, eíl. de l'an
13 S7. Une aurre ordonnan ce du roi ChH ies V. qui
ell de l'an 1369 , mee
ce
jeu dans le rang de ceul(
qui
foat défe ndus , comme nc fervanr nullemem
i
dreffer la_ jeuncffe pour la gu erre. La
file,
!eIon
M.
Ducange, éroit un ballon enfl é de venr, ou une bou–
le de boí',
&
peur-c!tre l' un
&
l'a ucre . D ans un de–
cree ou narur du chatelet de Pa ris de l'an 1493, il e11.
en encore parlé (ous le nom du
j e11 de la jOule .
On
affure que le• peuples de quelques villages de l'ar–
chi pr~cré
d'Héri lcop en Bourbonnois, croyoient au–
trefois honorer Sai ne J ean
l'évangelille ou Sai nr-Ur–
tin , en courant la
file;
e'
ell-a díre , que cer
~xercice
('e faifoit dans !'une de ces paroiOes le
2.¡
de Décem–
'bre,
&
dans une aurre, le
29
du méme mois.
Voy.
M.
Ducan;re
&
fes continuateurs daos le
g lo(foríum
nu tlí.e
&
injim.r latínítntís ,
aux mots
ludí , cbeolon,
mellat , &c.
Le mé111e
M.
Ducange , da ns
fa
viij. dif–
flrtatíon (ur J ui'woiclo,
&
le
merc11re de Mars
1 73 ~.
ou l'on crouve plut1eurs réflexions de M. Lebeu f,
<'hano;ne
&:
fonfc hancre d'Auxerre , fur le
m~rne
fujet,
Supplfmcnt de
Moréry .
SOLEA, (
A>~tíq.
ro!ll· )
riche cltlll flure d'or
&
rle
foie, avec une fe nle lemelle de cuir .
(-D.
J .)
SOLECISM E, f. m. (
Gra111. )
qnel ques gra mmai–
rienl onr prétendu que ce mor, qui fe tl;r en gree
r•xu~~.o.p.•r ,
eft formé de ces mots,
r l•
~o.l)'cu
.cix'""fl tt ,
.fa–
llÍ
J~rmonis
indig>lll cormptío ,
corruptiou d'un langa–
ge fa in. Mais cerre origine , quoiqu'íngénieu(e
&
pro–
bable en foi , e
O.
démem ie oar l'hi íl.oire.
, Ce mor e
O.
formé 'de
:¡ó,.,•., ,
qui tignifie les
IJII–
,
bitmu de la v ilü
a )ilellét<
%•"'' ;
comme
A"J'f•"'.,, les
,
IJabitaus de la
campag11e
.,
,
[
La
termiruilOn
u u '
vient de :,.,r ,
domu.r;
d'oU
•iauú ,
habito] .
,
D
~ÓA""''
,
On a
fe1
it
ro>.o1al~m
,
Í111Íter ÜS hAbÍtllll'.r tfe /1
VÍ/1~
appellé
~GA.u ,
commt: de
A)'fU" ,
.t,.,.d~m ,
imite,.
les gms
de
la
cttmfJ/Z,f lle
,.
Voyez
h u ·
A T rF •
,. ll y avoic deux vi ll es de ce nom , l'uue en Cili–
cie , fur les bords du Cydnus , l'a urre da ns l'ile de
Chypre. Ces deux villcs, fu ivant un grand nombre
d'aureurs , avoienr été fondées par SoIon . La ville
,. qu'il avoit barie dans cen e pro vi nce , quitra dant
la
fui te
1 ~
nom de fon fomlar •ur, pour prendre
celui de Pompée, qui l'avoír rétahl ie. A
l'~gao·d
de
celle de l'ile de Chypre, Pl urarque nous a con!'cr–
vé l'hiíl.oire de fa fonda cion. SoIon écant paffé au–
pres d' un roi de Chypre , acquit bíentor tanr .!'au–
toriré fur fon efprit , qu'i l lui perfua Ja
d'~bandon
ner la ville ou
il
faifoir fon féjour : l'affierre en écoit
a
la vérité fo rt avamageufe. mais le terrein qui l'en–
víronnoit éroft ing rat
&
djffi cile . Le roi fuivit les
1 ,
avis de SoIon ,
&
hl tit daos une be! le
t;>b!lle done
" nouvelle ville , aum force que la premtere .
ont
L 1
., elle
1
















