
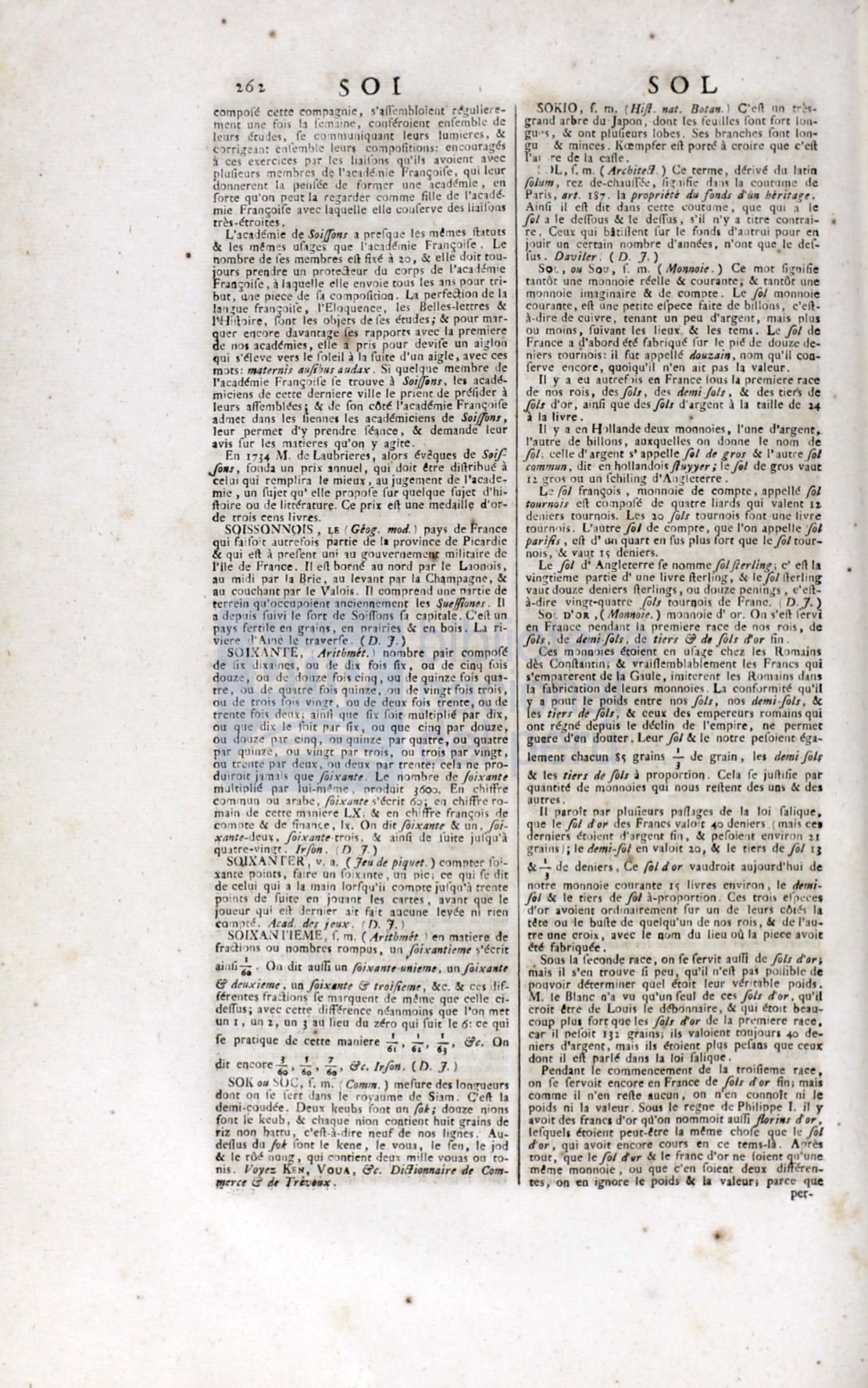
t 6 t
S O 1
compofé ccttc compa nie ,
s'all~mbloient
r
~uliere
menc une fo1s
b
fé:m.une ,
e
nfl!roienc enfembl.: de
leurs écudcs,
fe e mmuuiqua nt leurs
lum•cres , &
<:">rri
r~Jnt
cnlé:mbl
leurs com oficious: encouragés
:1
ces" e<erc•ces pJ r les hai t" ns qu'ils av01enc
3\'CC
plu!ieurs mcmbres de l'1c1M nie
Fran~
iCe, qui lcur
ilonnercnt la peufée de former une 1cadémie ,
en
force qu'on peut la re; arder comme fi lie de
l'?~,_dé.
rnie
Fran~oi fe
avec laquelle ello
~:ouferve
des IIJII<Jns
trb-l!troices ,
L'académie de
Soi.ffonr
a
prefqu.: les
m~mes
flJtuts
& les
•n~mes
uCtgc que l'académie Fr
Jn~
ife . Le
nombre de (es mcmbres efl R<é
a
20 ,
& elle doic tou–
jours prendre un pr ce8:eur du e rps de
l 'acaMm•~
Fraasnife,
~
laquelle elle cnvoie tous les an pour
m·
bue, une
I>ICCC
de fd compnfirion . La perfeéHon de la
lan rue fr.lnct
iCe ,
I' Eloquence ,
les Belles-leccres &
1'1-lnltJire, f"unc les ol>jecs de fes écudes; & pour mlr–
qucr encare davanta" e fes rapport• avec la pre•!tiere
de nos acadl!mies, elÍe a pris pour devi(e un a•glon
qui s'él eve vers le
r,
leil
~
la fu 1te d'u
n aigle, avec ces
m:m :
m¡¡ttrnir
11r'.fi~ur
audax .
i que!'
l.uemembre de
l'académie FrJ ns nife fe trouve
a
Soi¡¡IIU,
les acadd–
miciens de cecee derniere vil le le pnenc de ¡mHider
a
Jeurs arremblées
¡
6¡
J e fon cOté l'académie FrJn<;nife
admet daos les !iennes les académioiens de
SoiJ!ónl,
Jeur permec d'y prendre
Cé~ncc,
&
demande leur
avis fu r les maticres qu'on y agite .
En
173-4
M.
de Laubrieres
1
alors évequcs de
s,;¡:
.fo•r.
fo nda un prix
~nnuel,
qut doit
~ere
diflrihué
a
cel u1qui rcmplira le mieul, au jugcmenc
de
l'acade–
mie , un fu jet qu' elle pr pofe fur quelquc fu/·ec d'hi–
ft
ire ou de lictérature. Ce prir efl une
med~i
IQ
d'or--
d e erais eens livus.
'
SO l · 'ONNOIS ,
u
(
Gtog.
moti.)
pays de Prance
qui (aifoit dutrefois parrie de la province de Picardie
&
qui
~fl
;\ prerem uni
1u
gouvernemc~
milicaire de
l'lle de Pranoe .
11
en borné au nord par le l..1onuis ,
3U midi par la Brie , au leV3nt par la
Ch~mpagne,
&
a
u courhanr par le Valoi¡ .
11
oomprend une oarrie de
terrein qu'occu poienr nnoiennemcnc leJ
~uelflonu .
11
n
dcp is fuivi le fort de
oi(l"ons fa ca pirale . C'cfl un
pays ferrile en
grai~s .
en orairies
&
en boiJ. LJ ri–
viere •l'
"'•~e
le traverfe .
(D. ] .
)
SO L ANT E ,
1
Arithmh. l
nombre pair compofé
de
li <
J~>a• nes,
ou
e dix fois ílx , ou de cinq fuis
douu , ou de
ouze foi<cinq, uu tle quinze fois qua–
ere,
•JU
d:
q_u•Hre fois qninze , nu de ving t fois rrois ,
ou de u·o•s In•
v¡n<rt , ou de deux fois trente, ou de
trence foi< den Y; ainll que fix foi t multipl it! par dix,
ou que di < 1
fb it pa r fi x , ou que cinq pnr douze,
ou d uz
par c•nq , ou quinze par quatre
1
ou quatre
par qumzc , o u vi1J"t par trois, ou trois par vingt,
ou cr nce par deux,
u deux par rrente: cela ne pro–
dlllroic ja
Jis que
flixante.
Le nombre de
joix11nte
m lriolié par
lui-m ,e, nroduit
JOOo.
En chiff're
commun ou arabe ,
(oixantt
;'écrit
6o ;
en chiff're ro–
main de cecee m1niere LX;
&
en
chi ffr~ fr:~n<;nis
efe
com te
&
de finan'e, lx. On
dicflixttnt~
& un ,
.foi–
-rnnte-deu~, .foixont~·croi• .
&
ainíi de fu ice jufqu'a
quJCrc-vin!!t.
!rfon . (
D
.'l)
QIX~ ,
r ER .
V.
a.
(]tu
de piqutf. )
e mpc.:r lo:.
:xance pomts , fa1rc un fo1x1nte , un oic ; ce qui fe die
~e
celui qui
~
la
•na~n
lorfqu' i1 compre jufqu•a rrcnce
pomts de fUJre en ¡ouant
les carees , avant que le
JOUCUr ljUi el} J ernier
~;C
fa;C
~UCone
leyée
01
rren
co
e¿.
Ac11d. drr jmx .
r
D.
'].)
OIXA
I'I EME,
C.
m. (
Aritbmh
l en matiere de
fra ir>ns ou nombres rompus, un
foi xttntiemt
s'écrit
ain(i
..¡.
.
O n die aum un
{oÍ>ellnlt·Unieme .
un
foixttllf~
&
deuxitme ,
un
.
fo.ix•nte
&
troi(iemt ,
&c.
&
ces rlif–
férente$ frJdions fe _marquenc de
m ~me qu~
celle ci–
delTus; avec
cert~
drlférence néanmoins que l'oq mee
un
I ,
un
2 ,
un 1 au
h~u
do
z~ro
qui fuie le
6:
ce qui
fe pracique de c;rre ma niere
...!..
...!..
~
&G
On
61
' ,, '
6J
,
•
.1:
J
'
7
~>'t
eqcore- ,
6;;
,
6;; ,
&e.
Jrfl n. (
D.
J .
)
01
ou.
~C ,
f.
m.
Comm. )
mefure des
lon~eurs
done. on
f~
fc rr dans le rO)'Jume de Siam . C'efl
la
dem1 -couMe . Deu
keubs fon r un
(ol;
do
ate
nions
font le keu b ,
&
cl1aque nion contiene huir grains de
riz non lt.lrru , c'efl-a-dire ncuf de nos
h~nes .
Au–
de(lus du
jol
font le kene, fe voua , le fen , le jod
&
le ro nung , qui C">ntienr
<leu~
mille vouas Oll co–
nis .
1/oyt::.
K
e!<, VouA ,
&e. Diélionnaire Je
Com-
~"f'
&
tÚ
TrQ;•--r .
·
SOL
SOKIO ,
(.
m.
¡
Hijl. nat .
Bottn~.
1
C'efl un
r:,.
g rand arbre du Japon , dont le
fé:u •lle Ione forc lon–
gu··~,
&
ont plufieurs lobes .
es branch
f
nt lon–
gu
& minces .
1
oempfer efl p rté
3
crotrc que c'cll
T'a•
re de la calle.
!
lL,
(. m. (
Archirt9
)
Ce
cerme , Mrivé dn
1
rin
(olum ,
rez
de-chJurr~c, li•~
1
lic
.1111 la courum
de
París,
••·t.
187 . la
proprih i
tlu
fondr
tfu,
hírir•~• ·
A1nfi
il efl die dans cecee .:oucume , que qlu
.1
le
fol
J le de(Tous & le delTus ,
' if n'y
n
riere courrai-
,
re . Ccux qui bl t11lent fur le fonds d'a,ltrUI pour en
l
·~:mir
un
~erra
in nombre d'années , n'onr que
le
def–
us .
Dav tltr . ( D.
J. )
OL ,
ou
'o
u ,
(.
m.
(
Mo11noie . )
Ce m t fi<>oi fie
rancbt une m nnoie réelle
&
couranre , & tanc6r une
monnoie imaginaire
&
de comnce . Le
fol
monnoie
courante , cflune perite el'pece faite de b!l lon , c'ell–
~-di re
de cuivre , reonnr un peu d'argenr, ntllis plus
ou moms , fuiva nr les lieux & les cems.
Le
.fo/
de
FrJnce
a
9'abord écé fdbriqué fi.J r le pré de douze de–
nier cournois :
il
fue appellé
tlouzai11 ,
n m qu' ll con–
fervc encore , quoiqu'il n'en a1t pas la valeur .
11
y
a eu aucrehis en France fou;
f~
prcmiere race
de nos rois, des
fo/1,
de<
dttnÍ jolr,
& des t1er's de
{otr
d'or, amfi que des
foir
d'
~rgcnc ~
la taille de
l.f
1
la
livr~.
•
11
y
a
en
1-J
>llande deux monnoies , l'une d'argenr,
l'aucre de billons, auxquelles on donne le nom de
fll ;
celle d' argent s• appelle
fil
de gror
&
1'
JUtrefll
commun,
die en hollandoisft,.yytr; lefo/ de gros vaut
1!
gro• ou un fch iling d'An rlccerre .
L~
(ol
frangois , monnoie de compre , appellé
(ol
totmroú
efl compofé de
q,u~cre
liard qui valent
u.
dc111ers tournois. Les
10
jolr
t urnois font une livre
tournni . L'R utre
fol
de compre , que l'on appelle
.fol
p11rljis
,
en d' tUl quarc en fus plus forc que le
.fo/
rour–
no• , & vaut
1
s
deniers.
Le
.fol
d' Angleterre fe nom
me
folj}trling ;
e' en la
v~ngtieme
parcie d' une livre flerlrng ,
&
le
Jol
flerlmg
vaur douze deniers flerlings , ou douze peni n•'
, c'en–
a-dire
vingc·quacr~
.foil
rouroois de Fra nc. (
D.
J.~
·o r.
o'
OR , (
Monno~e. )
m nnoie d' or. On s'efl fervt
en Francc penrlanr la
premi~re
race de nos rois , de
fllr ,
de
dtmi:folr ,
de
tÍtl'f
&
d1 fllr tf'or
fin .
Ces m nooies étoienr en ufage
ch~z
le
R mains
des
Co~namm ;
&
vrJillemblablemel1t les Prancs qui
s'emparerent de la Gaule, imicerenr les Rnmaim d4ns
la fabricacion de leurs monnoies ,
La
confurmité qu'll
y
a pnur le poids enrre nos
foir ,
nos
tlemi-folr,
&
les
eirrr dt foil,
&
oeur des empereun romJIOS qui
ont ré rné depuis le déolin de l'empire, oe permet
gucro d'on dourer. Leur
fll
& le notre pdbient éga-
lement chacun
Ss
grains
~
de grain ,
l~s
demi .fol¡
J
& les
tierr de fllr
~
proporcioq . Cela fe jufl•fie par
quantitt! de monnoies qu• nous rellene des un•
6t
des
aueres .
11
paroir par plulieurs paflJges de la
loi falique,
que le
fol
d'o~
des Francs vulo1r
~
deniers ( ma is cew
deroiers écuicnt d'argenr fin ,
&
pefoienr env1ron
t l
g rains J; le
dtmi-fol
en valoir
10 ,
6¡
le r1ers de
fol
IJ
~~
de deniers . Ce
(o/
J
or
vaudroir aujourd'hui de
J
narre monnoie couranre
1
s livres environ , le
thtlli–
fll
&
le ciers de
fll
~-proporcioo .
Ces troh
d
cces
d'or avoient orcflnatrement fur un de leurs có¡és la
t~te
ou le bulle de quelqu'un de nos rois ,
&
de l'au–
rre une oroi• , avec le nc..m du lieu oilla p1ece avoit
ét6 fabriquée.
ous la
r~conde
race. on fe fervit au
m de
folr d'or;
mais il s'en crouve
li
peu. qu'il n'en
r.aspouible de
pouvoir déterminer quel éco1t leur vennble poids.
M. le Blanc o'a vo qu'un feul de ces
flll d'or ,
qu'il
eroir
~ere d~
Louis fe Mbonnaire,
&
qui éro•r beau–
coup plus
for~
que le
.foil
d'or
de la pr,·m•ere race,
car il pe(oit
1
Jl
grains; ils valoienc roujours
-40
de–
niers d'argent , mais ils étoienr plus pcfans que ceux
done il efl
parl~
dans la loi falique .
Pendant le commencemenr de la troilieme raee ,
on fe fervoit encare en F111nce de
~h
d'or
fin ¡ maiJ
comme
il
n'cn rene aocun , on n en connote ni fe
potds ni la valeur . SouJ le regoe de
Ph~· li
pe
l.
il
y
avoir des francs d'or qtl'on nommoic aum
,;.,
ti
or '
lefquels «!roient peor-ltre la
m~me
cho e que
1~
fit
tfor,
qui avoit ene re cours en ce cems-U . A.,r
tour, que lefi/
tf•r
&
le fra nc d'or ne (oienr qn'une
m~me
monooie, ou que e'en foieor deux diffl!ren–
~s,
on en ignore le poidl
6c
l.a
valeun paree que
pcf-
















